LE PROJET NEUF
2023-08-15 / 2023-08-26 - Chantier du P barbizoné : résidence artistique et gentrification
.
.

Photographie modifiée par Jean-Claude Stervadze (a.k.a JJCS) pour son film “ZON”, réalisé dans le cadre de La Pébipologie.
.
Profitons de la citation dans un article précédent à propos de Virgile-Narcisse Diaz de la Peña pour faire une incise sur la question des “parcs” ou “réserves” et sur celle de la “gentrification”.
Pourquoi ?
.
Parce que plusieurs questions peuvent être prises en compte à propos de nos expérimentations sur le site du Pé (ou P) ‒ maintenant que le grand terre-plein de 8ha n’est plus accessible et est en train d’être entièrement modifié par les travaux de terrassement [2] et leurs nuisances, et que d’un autre côté les espaces jardins vont être compressés par une autre opération d’urbanisation à caractère immobilier (la destruction de trois maisons dont les jardins sont attenants à celui du “Projet Neuf” et du “Jardin des Mesures / PavÉ”, dont une que nous avions en usage (le 105) puisque l’espace du P9 est en train de passer d’un grand plateau quasi-cinématographique disponible à de multiples projets et projections à un ilôt enserré entre des constructions nouvelles liées à une croissance visiblement à caractère productiviste s’appuyant sur une valeur d'attractivité “marketée”, apparemment déliée de l’existant (les volontés des habitant.e.s actuel.le.s, les dynamiques “en process” sur le périmètre et au-delà, etc.) et semblant trop indifférente aux problématiques actuelles (écologiques, économiques, sociales, et leurs nouveaux patterns à mettre en action et en pratique) :
-
Est-ce que notre présence sur ce site urbain en transition ‒ sur lequel notre association est en “résidence artistique” (exonérée de loyer et de charges sous le couvert d’un bail d’occupation précaire de cinq années (01/2019-12/2024) et volontairement non pérenne sur ce lieu afin de faire entrer la mobilité dans notre expérimentation) ‒ profite inconsciemment et involontairement d'un enjeu qui dépasse ceux que nous avons mis en commun (les expérimentations artistiques dans un contexte non prescrit et délié de la programmation et de la diffusion artistiques) [1a] [1b] [2] [3] [4] ?
-
Est-ce que cet enjeu participe à un mécanisme de “gentrification” qui serait en filigrane (non explicite ni déclaré tout en étant très actif) des décisions d’urbanisation et culturelles des collectivités territoriales qui sont propriétaires et prescriptices sur les périmètres où l’association est présente et où elle développe selon ses propres axes (expérimentation ouverte à partir d’une ressource mutualisée, l’accessibilité à un commun entre espace public et espaces privés, exploration d’un “libre-lieu”, etc.) qui apparaissent différenciés de cet enjeu ?
-
Que deviennent (au-delà du projet urbain) les projets et les projections qui sont activées à partir du P9 ? Vont-elles disparaître d’un coup (ou par attrition, par une usure lente et externe), puisqu’elles ne se sont pas désignées comme “programmées”, “événements” ou “nouveautés” et sont plutôt nourries par des expériences répétées, refaites, reprises et continuellement pratiquées ?
-
Ou ont/auront-elles des suites conséquentes (à notre présence et à nos actions) qui vont perdurer sur le site et qui vont mémoriser ces interactions continuelles que nous avons avec lui ?
-
Quel argument demeurera valide à propos de notre présence artistique de cinq années sur ce site ? Présence (même symbolique) qui pourrait continuer même après notre départ permettant d’en autoriser d’autres à se développer et à tester ? Est-ce que ce site, via nos actions et nos projets, a dorénavant changé le cours de quelque chose ‒ sans espérer qu’il puisse modifier, interférer ou influencer le projet urbain et immobilier ‒ mais qu’il ait tout de même changé quelque chose dans l’art et dans les expériences des personnes qui regardent et écoutent l’art ‒ quelque chose à partir duquel des images et des artéfacts persisteront ‒ et le préserveront comme “site artistique” ‒ ?
-
En parallèle, n’y-a-t-il pas une réflexion à mener à propos de mécanismes récurrents et communs à plusieurs secteurs (écologie, social, politique, culture, etc. puis aux questions liées au genre, au décolonialisme, etc. ; intersectionnels, donc) qui auraient des “patterns” identiques ou similaires et qui pourraient faire dire ‒ puisque il ait à chaque fois question de temps et d’espace, d’accès et d’autorisation, de déploiement et de confiscation, etc. ‒ que les politiques culturelles fonctionneraient comme d’autres mécanismes qui produisent systématiquement des exclusions et des précarités (en tant que symptômes propres aux systèmes productivistes et néo-capitalistes) ?
.
Et toute cette réflexion va donner lieu, une fois n’est pas coutume, à l’article-le-plus-long-jamais-rédigé-sur-ce-blog. Il est abondant, gros-et-épais, et permet de creuser une hypothèse artistique qui va perdre son “hypo” (prédiction) pour devenir plus “thèse” (argument) puisque l’étude et le propos semblent avoir été assez riches et pertinents pour aller jusqu’à cette épaisseur.
Cela parle de forêts et d’arbres, d’espaces à parcourir et à maintenir (ou à garantir), ainsi qu’une certaine persévérance dans la recherche de formes et de positionnements qui se mettent à explorer des solutions et des situations actives face aux problématiques actuelles. Il y a longtemps que Vitara et John Rohmnyz s’interrogeaient sur la ou les raisons qui leur faisaient maintenir un cap ou qui, en tout cas, pouvaient interroger quant à leur persistance à vouloir sonder les puissances de l’art à partir d’expériences vécues (artistiques, esthétiques) et de souhaits de vivre encore des expériences d’œuvres telles qu’il avait déjà été possible d’en avoir (et ce n’est pas parce qu’on se tourne vers des choses vécues ou passées qu’on désire un retour en arrière, c’est tout simplement que, puisque cela avait été possible, d’aller aussi loin dans certaines expériences, il doit être encore possible d’en vivre d’autres, à de pareilles ou similaires intensités qui, même si elles ne seront pas les mêmes ni identiques, indiqueront que l’art se transforme toujours, transgresse continuellement, et donne sens à beaucoup de choses, même à nous-mêmes).
.
.
Menu :
- Suite de la série “Chantier”
- 1 ‒ Introduction
- 1a ‒ Gentrification et le rôle des artistes
- 1b ‒ Questions au Projet Neuf
- 1c ‒ Avant-garde ? et place de l’artiste dans la société
- 2 ‒ (S')Occuper (d')un espace est un projet (tout dépend comment on le fait et comment on se comporte)
- 2a ‒ Un projet ? du côté de l’art
- 2b ‒ Pourtant l’art est magique, non ?
- 2c ‒ Le projet du côté des urbanistes
- 2d ‒ Le projet artistique est moteur
- 3 ‒ Le P9 et le site du Moulin du Pé : une expérimentation de projets, un projet d’expérimentations
- 3a ‒ Une expérimentation de projets
- 3b ‒ Un projet d’expérimentations
- 3b ‒ Les problématiques, les risques
- 3d ‒ Comment contourner l’écueil ?
- 3e ‒ Des exemples
- 4 ‒ Une incise : Le P ne sera pas un musée
- 5 ‒ Une hypothèse
- 5a ‒ Le P : un site à destination artistique
- 5b ‒ Références
- 6 ‒ L’École de Barbizon
- 6a ‒ Un insert proustien
- 6b ‒ Les peintres de Barbizon, écoguerriers ?
- 6c ‒ La littérature avant la peinture
- Étienne Pivert de Sénancour
- George Sand et Alfred de Musset
- 6d ‒ La peinture, Camille Corot et L’école de Barbizon
- 6e ‒ Villages et colonies d’artistes
- 6f ‒ Aspects et caractères des colonies d’artistes
- 6g ‒ Les peintres de Barbizon, Théodore Rousseau
- 7 ‒ Site à destination artistique
- 7a ‒ Comité de protection artistique
- 7b ‒ Les soutiens de Victor Hugo et George Sand
- 7c ‒ Les débats et décisions politiques
- 7d ‒ Réserve artistique ; Site à destination artistique ; Série artistique ; Réserve biologique
- 7e ‒ Site artistique et fictions : “le simulacre du pourpre simultanément dans le ciel du P et celui de Fontainebleau”
- 7f ‒ Réserve, série, site artistiques entre “espace délaissé”, “wilderness”, et “lieu sublime”
- 8 ‒ Annexes
- 8a ‒ Définitions des parcs et réserves
- 8b ‒ Flaubert, la littérature retourne à la forêt, 1868
- 8c ‒ La photographie bellifontaine ou fontaineblesque, 1849
.
.
1
Introduction
.
.
1a
Gentrification et le rôle des artistes
Pour commencer d’éclairer toute cette série de questions, citons /[A] des extraits de l'article d’Elsa Vivant et d’Éric Charmes de l’Institut Français d’Urbanisme (Université Paris8), un article paru en 2008 dans la revue “Métropoles”, ainsi que d’autres tirés /[B] d’un second article de Caroline Helfter publié en 2014 dans la revue “Informations Sociales” à propos du livre de la géographe Anne Clerval, “Paris sans le peuple. La gentrification de la capitale” (Éditions La Découverte, 2013) :
-
[A] ‒ Ces deux chercheur.e.s se proposent « d’évaluer le rôle des artistes, et plus particulièrement des squats d’artistes, dans la gentrification. La littérature anglo-saxonne insiste en effet beaucoup sur le rôle déterminant de l’arrivée d’artistes plus ou moins marginaux (ceux de la scène dite off) dans le déclenchement de la gentrification d’un quartier. Ces artistes sont considéré.e.s non seulement comme des initiateurs de la revalorisation symbolique des quartiers qu’ils investissent, mais aussi comme des ferments d’un changement d’ambiance qui permettrait l’arrivée de gentrifieurs plus aisés. » ‒ (Référence : Elsa Vivant et Éric Charmes, « La gentrification et ses pionniers : le rôle des artistes off en question », Métropoles, 3, 2008, DOI : 10.4000/metropoles.1972)
-
[B] ‒ « Gentrification » est un néologisme formé à partir du mot « gentry » qui désigne péjorativement la « bonne société » (“anglaise” dans le contexte de la création du terme) et une forme d’embourgeoisement que l’on peut qualifier d’agressive. Un processus d’embourgeoisement urbain s’appuie généralement sur la démolition de lots de maisons et de bâtiments au sein d’une zone habitée suivie par la construction de logements neufs entraînant une revalorisation immobilière brutale et le départ des habitant.e.s les moins économiquement loti.e.s et conséquemment l’arrivée de nouveaux.elles propriétaires d’un niveau économique plus élevé ‒ (Source)
-
[B] ‒ « Les premiers nouveaux habitants à se distinguer nettement des classes populaires résidentes de ces quartiers sont souvent des artistes ou des personnes exerçant des professions culturelles ». C’est d’abord parce qu’ils étaient à la recherche d’espaces disponibles bon marché que ces « gentrifieurs » ont saisi l’opportunité de reprendre des locaux artisanaux et industriels. Rendus rapidement visibles par l’organisation d’événements attrayants, comme les opérations « Portes ouvertes » des ateliers d’artistes, ces découvreurs de quartiers encore méconnus de la bourgeoisie et de la petite bourgeoisie intellectuelle ont contribué à en changer l’image et à y attirer de nouvelles populations. ‒ (Référence : Caroline Helfter, « Contrepoint - Les artistes à l’avant-garde de la gentrification », in “Informations sociales” 2014/4 (n° 184), page 103)
-
[A] ‒ « Cette phase de la gentrification voit se développer les cafés et restaurants branchés, les boutiques de designers locaux, les librairies spécialisées, les galeries, autant de commerces qui transforment le quartier en lieu de ballade pour les citadins. Plus ou moins simultanément à ces processus, des investissements publics ou privés permettent une revalorisation immobilière du quartier (Smith, 2003), puis l’installation de ménages plus aisés. Peu à peu, le quartier acquiert une nouvelle image et devient pour les classes moyennes une zone conquise (ou reconquise). La hausse des valeurs immobilières pousse les habitants originels et parfois les pionniers à partir. Au terme du processus de gentrification, la plupart des logements ont été rénovés et le caractère populaire du quartier n’est plus qu’un souvenir plus ou moins mythifié. […] Ainsi, divers projets urbains récents montrent que la symbolique du squat d’artistes ou du lieu « alternatif » permet de retourner le stigmate de la friche industrielle en atout (Vivant, 2006b). » ‒ (Référence : Elsa Vivant et Éric Charmes, « La gentrification et ses pionniers : le rôle des artistes off en question », Métropoles, 3, 2008, DOI : 10.4000/metropoles.1972)
-
[A] ‒ « [L]a présence d’artistes ne serait-elle pas qu’un indicateur de la gentrification ? Les artistes jouent-ils vraiment un rôle spécifique dans les dynamiques de valorisation des quartiers ? Si certains gentrifieurs accordent un intérêt aux artistes, est-ce le cas de tous les gentrifieurs ? Tous les artistes sont-ils concernés ? En particulier, quel est le rôle des artistes pionniers, souvent associés à l’image de l’artiste d’avant-garde, de l’activiste de la contre-culture et des réseaux alternatifs ? » ‒ (Référence : Elsa Vivant et Éric Charmes, « La gentrification et ses pionniers : le rôle des artistes off en question », Métropoles, 3, 2008, DOI : 10.4000/metropoles.1972)
.
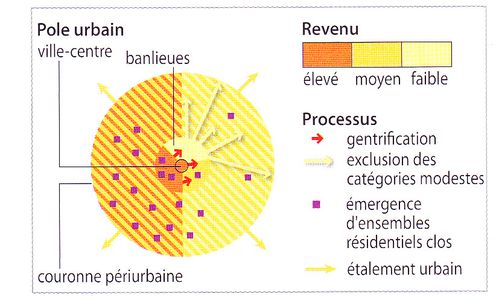
.
.
1b
Questions au Projet Neuf
Ces problématiques peuvent en effet se poser à propos du Projet Neuf puisque l’association collégiale formée et co-gérée sur place par les artistes est en “résidence artistique dans le cadre du projet urbain” (du Moulin du Pé à Saint-Nazaire) et en conséquence bénéficie de l’usage du bâtiment 89 [2] et des 4000m2 d’espaces jardins attenant (avec en complément, lors des premières années, l’usage de la Maison 105 ainsi que l’autorisation de pouvoir expérimenter sur les 8ha du large site en transition (nommé le P) ; et ce sur une durée de cinq années cadrée par un bail/convention d’occupation précaire [2].
Dans ce cadre, la relation au “projet urbain” peut être questionnante.
- N’est-elle pas assujettie à une opération urbaine, masquée et latente, de gentrification ?
- Et en parallèle, l’action <OFF> (= non-mainstream) et alternative d’artistes sur un pareil lieu (nommé par le P9 Libre-Lieu) n’annonce-t-elle pas un autre déplacement vers un projet <IN> (consensualisé par le monde de l’art ou bien, par un autre biais, en devenant “Tiers-Lieu” [2] [3] [4] avec l’arrivée d’autres artistes plus repéré.e.s et davantage présent.e.s dans les dispositifs artistiques institutionnels.
.

le terre-plein du Moulin du Pé en plein changement, août 2023.

le terre-plein du Moulin du Pé en plein changement, juin 2023.

le terre-plein du Moulin du Pé, juillet 2019.
.
.
1c
Avant-garde ? et place de l’artiste dans la société
L’article d’Elsa Vivant et d’Éric Charmes donne un éclairage historique à cette notion d’avant-garde et à la représentation de l’artiste dans la société. Citons-en ici de larges extraits :
-
« En réalité, l’avant-garde est aujourd’hui une figure peu opératoire pour appréhender la place de l’art contemporain dans la société. Sans nous aventurer trop loin en histoire de l’art, il faut rappeler que la notion d’avant-garde a été mise en cause dès les années 1960, en particulier par Harold Rosenberg qui a souligné la perméabilité alors déjà grande entre l’industrie culturelle et les artistes prétendument avant-gardistes (Rosenberg, 1972 : 212-222 ; Harold Rosenberg, “The De-Definition of Art”, University of Chicago Press, 1972). Aujourd’hui, la notion d’avant-garde a perdu de son prestige. Peu d’artistes s’en réclament, ne serait-ce que parce que l’idée d’avant-garde repose sur une conception datée du progrès et des hiérarchies entre valeurs et normes. »
-
« Si l’on s’en tient à la sociologie, divers travaux montrent également que la place de l’artiste dans la société a évolué. Le prestige social actuel de l’artiste trouve ses racines dans l’émergence du mouvement romantique au XIXe siècle, mouvement qui s’inscrit notamment dans le contexte de la naissance de la démocratie contemporaine et de la redéfinition des critères d’excellence sociale suite à la dévalorisation des critères aristocratiques (Heinich, 1998, 2005 ; Nathalie Heinich, “Le triple jeu de l’art contemporain”, Paris, Editions de Minuit, 1998 ; Nathalie Heinich, “L’élite artiste. Excellence et singularité en régime démocratique”, Paris, Gallimard, 2005). Depuis lors, les représentations sociales de la vie d’artiste sont structurées par la figure de la bohème, autour de laquelle les stigmates de la marginalité économique sont retournés en valeurs positives : l’artiste « choisit » une vie marginale et miséreuse parce qu’il privilégie l’accomplissement de sa vocation. Au cours des décennies récentes, ce choix s’est valorisé, et de marginal est presque devenu dominant (Wilson, 1999 ; E. Wilson, “The Bohemianization of Mass Culture”, International Journal of Cultural Studies, 2, pp. 11-32 [1]). L’activité artistique représente aujourd’hui une activité enviée voire idéalisée : la faiblesse de la rémunération qu’il est possible d’en retirer est compensé par le caractère choisi et non routinier du travail. Ce dernier est perçu comme épanouissant car l’artiste peut laisser libre cours à sa créativité et s’affranchir des contraintes extérieures. La figure de l’artiste rencontre donc deux valeurs essentielles du monde contemporain : celles de liberté et d’autonomie. »
-
« Mieux, au sein même du monde de l’entreprise, l’anticonformisme supposé des artistes a perdu son statut de valeur de rupture pour devenir une valeur dominante, surtout si par anticonformisme, on entend la capacité à décider par soi-même et à prendre des initiatives en s’affranchissant de la pression du contexte social. Ainsi, Luc Boltanski et Eve Chiapello ont bien montré comment le capitalisme a récupéré la « critique artiste » qui, après 1968, avait dénoncé l’aliénation de la vie quotidienne d’individus atomisés et interchangeables. Les arguments de la critique artiste de l’entreprise et de l’économie ont été incorporés dans les discours et les registres de justification des managers (si ce n’est dans leurs pratiques), notamment dans les entreprises dites « innovantes » ou « créatives » (Boltanski et Chiapello, 1998 ; Honneth, 2006 ; Luc Boltanski & Eve Chiapello, “Le nouvel esprit du capitalisme”, Paris, Gallimard, 1999 ; Axel Honneth, “La société du mépris”, La découverte, Paris, 2006). »
-
« Les pratiques, les valeurs et les normes portées par les artistes se sont donc assez largement diffusées dans la société. La convergence est telle que l’on peut se demander si les valeurs portées par les artistes ne sont pas devenues les reflets des valeurs dominantes, plus qu’elles ne précèdent ces dernières. Si on admet cette hypothèse, les choix de localisation des artistes pourraient être non plus des choix avant-gardistes, mais des indicateurs de tendance. Vu sous cet angle, l’artiste pionnier de la gentrification n’est plus qu’un élément d’évolutions urbaines et sociales qui le dépassent ; il est une modalité parmi d’autres de l’investissement d’un quartier par l’industrie culturelle et par une société dont les valeurs dominantes ont changé. Il participe à ce mouvement qui pose la culture au cœur de la création de nouvelles centralités urbaines. »
-
« Mieux, l’underground, le off et l’artiste marginal deviennent des éléments clés, non seulement dans les stratégies de revalorisation urbaine, mais aussi pour le développement économique. Selon l’expert consacré en la matière, Richard Florida, la création de richesses est aujourd’hui portée dans les sociétés occidentales par une nouvelle « classe créative » qui puise son énergie créatrice dans un rapport quotidien avec un milieu bohème et artiste via notamment la fréquentation de cafés et de lieux d’exposition plus ou moins off, puisque selon Richard Florida, « tout ce qui est intéressant se passe aux marges » (Richard Florida, “The Rise of the Creative Class : and How it’s Transforming Work, Leisure”, Community and Everyday Life, New York, NY, Basic Books, 2002). Ainsi, certains espaces autrefois perçus comme marginaux et opposés aux lieux productifs de la ville, sont aujourd’hui considérés et mis en scène comme des éléments-clés dans le régime d’accumulation du capital que d’aucuns qualifient de « post-industriel ». […] L’une des stratégies est d’attirer des artistes pour changer l’image d’un quartier que l’on souhaite régénérer [l'« effet squat »). Cette stratégie est relativement lourde et ne peut être mise en œuvre que par des acteurs puissants tels qu’un aménageur ou une collectivité locale (E. Vivant, “Le rôle des pratiques culturelles off dans les dynamiques urbaines”, Institut Français d’Urbanisme, Champs sur Marne, Université Paris 8, 2006). »
-
« Ceci place d’ailleurs les promoteurs de la gentrification devant une contradiction difficile : comment permettre le développement d’une force de travail « créative » qui se nourrit de modes de vie marginaux qui sont eux-mêmes écrasés par les investissements massifs qui accompagnent la valorisation d’un quartier ? Les artistes off sont en effet généralement victimes du processus qu’ils sont considérés avoir eux-mêmes (involontairement) provoqué et permis. Ceci peut d’ailleurs déboucher sur des conflits ouverts entre ceux qui produisent de la valeur symbolique (les pionniers de la gentrification) et ceux qui lui donnent une expression économique (les promoteurs immobiliers, et les nouveaux accédants à la propriété). » ‒ (Référence : Elsa Vivant et Éric Charmes, « La gentrification et ses pionniers : le rôle des artistes off en question », Métropoles, 3, 2008, DOI : 10.4000/metropoles.1972)
.
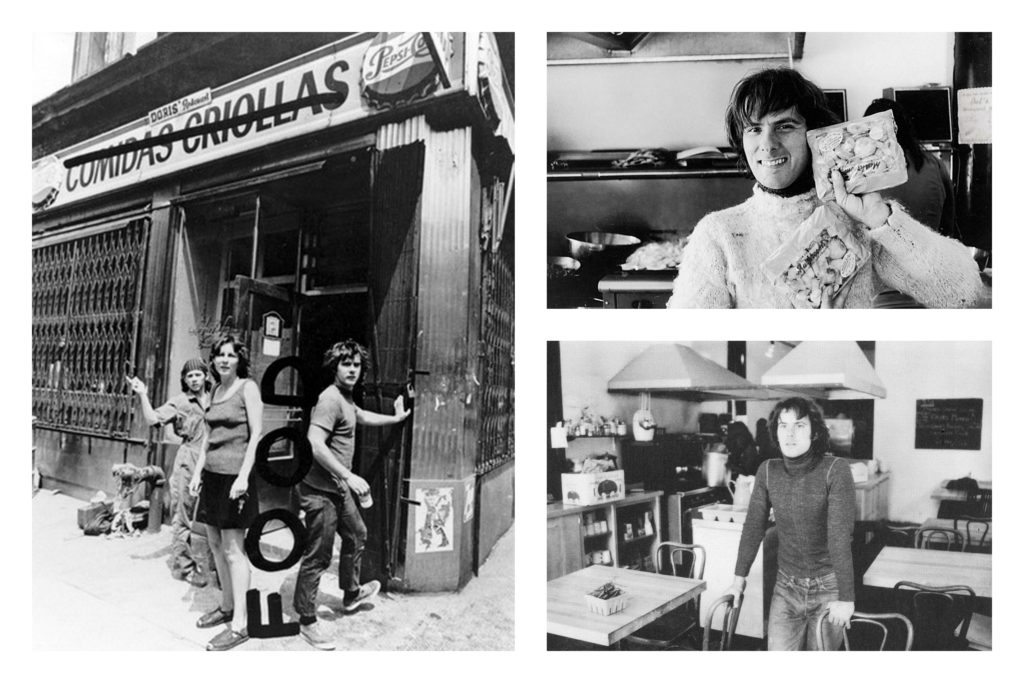
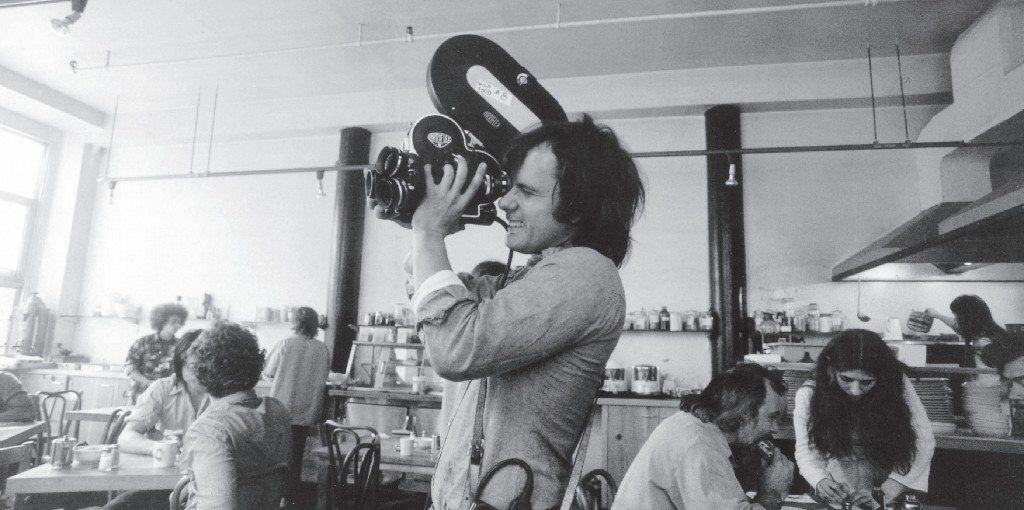
Le 25 septembre 1971, à l’angle de Prince Street et Wooster Street dans le quartier new yorkais de SoHo, l’artiste Gordon Matta-Clark et la photographe et danseuse Carol Goodden ouvrent le restaurant “Food”, conçu comme un soutien à la communauté artistique de Manhattan. (Voir ici sur ce blog une étude à propos de projets de Gordon Matta-Clark dont “Food” (1971-1974))
.
.
2
(S')Occuper (d')un espace est un projet (tout dépend comment on le fait et comment on se comporte)
.
.
2a
Un projet ? du côté de l’art
La notion centrale qui motive la résidence du P9 au P est celle de “projet” ; terme employé autant par l’équipe d’urbanistes (projet urbain) que par les artistes (projet artistique) et dont la première hypothèse mise sur la table par le dialogue entre artistes et urbanistes est celle d’expérimenter leurs conjonctions et leurs disjonctions.
Du côté artistique, il est à supposer que le projet est un moment d’expérimentation (tests, prototypes, intentions, hypothèses, séries de prises de décisions, retours et reprises, ratages, repentirs, retouches, etc.) dont l’issue est incertaine tout en employant des curseurs d’effectivité et d’efficacité (ou d’inefficacité si une cible ou un but a été nommé en préalable et sert de jauge et d’évaluation envers un résultat attendu).
Cette partie (en temps et en espace) de projet est perçue comme correspondre à 80 ou 90% du travail artistique et reste invisible (ou reste non cernée, non cernable et impalpable) dans la réalisation “visible” d’une œuvre. Et cette partie de “projet” est à la charge de chaque artiste et non des commanditaires, des prescripteurs ou du public. Et de manière générale, cette partie “atelier/projet/processus” est sujette le plus souvent à de l’indifférence et une action tournée vers ce processus et engagée sur des principes d’entraide et d’autonomie (trans-artistique et trans-générationnelle, notamment recouvrant une attention particulière auprès des tout jeunes artistes) est généralement ignorée, soit crée habituellement une certaine hostilité car qualifiée de “marginale” ou de “dissidente” (en bref = ne jouant pas le jeu).
Cependant, il semble qu’à la suite du XXième siècle, les artistes du XXIième siècle fondent leur pratique sur des “pratiques de projet” (et moins des pratiques d'objet comme cela est apparu au XXième siècle avec le marché de l’art et l’institionnalisation de la diffusion artistique). Et cela même si on peut travailler et expérimenter “sans projet” (ce qui est aussi conceptuel, voire plus conceptuel qu’il n’y paraît : car c’est alors l’intuition qui pilote et sans doute les patterns les plus courants et les plus assimilés), et même si l’art reste production d’objets (c’est simplement la définition de ceux-ci qui change). Et pour de telles pratiques de projet le plus souvent associées à des processus et à l’interaction essentielle avec des contextes et des environnements, il est nécessaire de disposer et d’accéder à “des espaces” : ressources et techniques (c’est le cas du P9 : une base-ressource-nœud de convergences ‒ voir à ce sujet cet article), d’atelier(s), forums, terrains d’essais, etc. ce qui requiert une économie appropriée pour formaliser de tels accès à des bâtiments et à des espaces vacants. Cet accès s’appuie sur une économie soit “privée”, soit “mutualisée” associativement, soit “allouée” (subventions, dispositifs de financement, etc.) (Se référer ici, en partie, à la recherche de Pierre-Michel Menger sur le travail créateur [1] [2] [3] [4]).
.
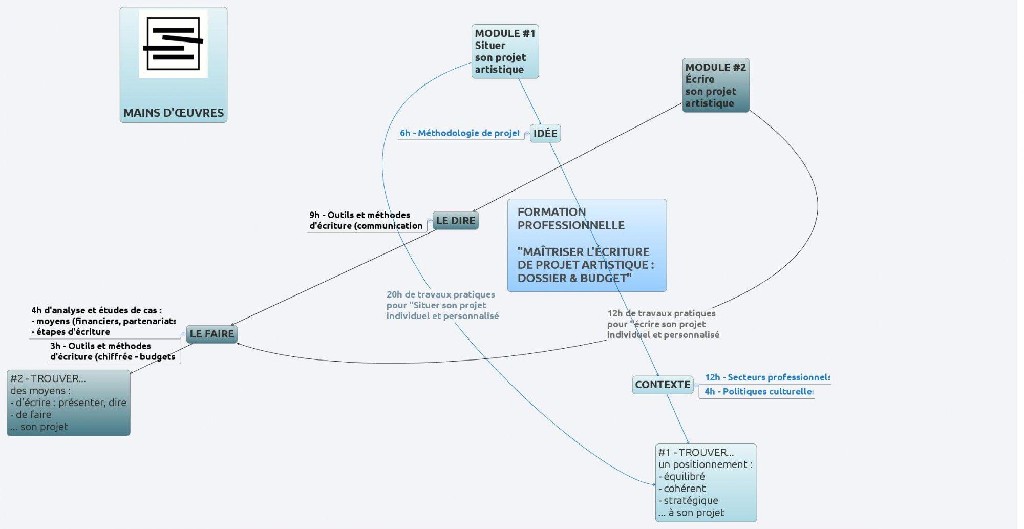
Documentation Mains d’Œuvres, Saint-Ouen, 2019 ; un exemple de pratique de projet (?). (Source)
.
.
2b
Pourtant l’art est magique, non ?
Dans la plupart des cas et des mentalités, le travail d’un.e artiste est vu à l’aune d’une certaine “magie” de l’art, voire de son “génie” : “des idées qui se réalisent” et qui “agrègent un public nombreux qui adhèrent ensemble à la “beauté” (esthétique, technique) de l’œuvre que l’on voit. Sa réception est consacrée, parfois même “ritualisée” (on la “vernit”, et quelquefois on la “finit” : vernissage, finissage) pour en démontrer l’exceptionnalité.
Mais il semblerait que les artistes soient dans une réalité plus concrète et davantage pragmatique que cela : car “il est impossible de programmer ses idées” (il n’y a pas de “recette”), “le travail artistique est apparemment lent et incertain dans ses aboutissements”, “l’économie (le financement) ne fait pas une œuvre”, qu’une œuvre soit “vue par un nombre important de public n’est pas un gage de son importance”, et que “la juste économie d’un tel travail par rapport à d’autres (activités, “travail(s)”, professions) n’est jamais ou n’est que très rarement atteinte” et pose durement la question d’accès à des moyens de réalisation. Ceux-ci sont en grande partie gérés et prescrits par les institutions sous des formes de sélection qui entraînent une compétitivité agressive (déloyale ?, non désirée ni gérée par les pairs ?), et l’autre partie par le(s) marché(s) et le privé (collectionneurs, commanditaires).
En contre-partie, du côté artistique, et au premier abord, vont de plus en plus primer des principes d’invisibilisation (le public ne voit que 10 à 20% du travail réel) et de précarisation (les moyens ne sont pas au service de l’expérimentation et de la recherche).
.
.
2c
Le projet du côté des urbanistes
Du côté urbanisme, le projet est le prélude à la réalisation technique d’un aménagement selon des conditions économiques et selon des règles de droit, de régulation et de marché. Néanmoins, dans ce second cas (à la suite du “projet” du point de vue artiste), le projet part également d’hypothèses ou de “variables” dont la conjonction aux valeurs les plus hautes sont recherchées et attendues :
- 1/ les conditions économiques sont favorables ;
- 2/ l’accroissement de population dans un bassin périmétré est prévu (voire est inéluctable si on prend un tel point de vue) et donne un retour positif d’attractivité et de développement croissant ;
- 3/ en conséquence des aménagements nouveaux sont nécessairement la solution (le comment n’est pas forcément posé : ériger de nouveaux bâtiments paraît le but premier).
- Pour ce faire la commande territoriale publique passe par des organisations privées (entreprises) selon des cahiers des charges, en passant, dans le cas du Moulin du Pé, par la vente de lots de terrain à des promoteurs qui exécutent les réalisations, peuvent les revendre, et en tirent profits et bénéfices.
.


Le nouveau quartier du Moulin du Pé (crédits : Florence Mercier, paysagiste et JBMN pour Sogeprom&Bremond) (publication décembre 2022). (Source)
.
.
2d
Le projet artistique est moteur
Sous cette notion de “projet artistique”, plusieurs axes sont pratiqués et continuellement interrogés :
-
1/ le projet comme moteur de visions (versus en urbanisme : prévisions et préconisations) (exemples par les artistes, suivez ces fils d’articles : [1], [2], [3], [4], [5], [6], etc.), et en poussant plus loin, le projet comme œuvre ;
-
2/ le projet comme révélateur d’interactions continues et ponctuelles entre artistes, réalisations et environnement(s) (pratiques de terrains [1] [2] [3] [4], trouvailles [1] [2], accueils [1] [2] [3], recherche [1], etc.) ;
-
3/ le projet comme cadre d’expérimentations (d’atelier et de terrain) et de sollicitations (excitations mentales, intellectuelles, visuelles, sonores, etc.) [1] [2], l’association (Projet Neuf) assurant l’accès libre à l’espace et aux ressources, et les garantissant ;
-
Le tout cherchant à révéler des facettes méconnues d’un environnement, et de soi-même dans cet environnement, à l’aide de prismes singuliers (artistiques) et d’instruments de perception (œuvres, actions, dispositifs, etc.) et ainsi à (en) modifier la perception et (y) provoquer des émotions (en offrant des expériences).
.
SOUS-BOIS
‒ « Je t’apporterai un jeune pavot, aux pétales de pourpre [2]. » (Théocrite, “Le Cyclope”)
« Nous n’avons rien à craindre mais beaucoup à apprendre de la tribu vigoureuse et pacifique des arbres qui produit sans cesse pour nous des essences fortifiantes, des baumes calmants, et dans la gracieuse compagnie desquels nous passons tant d’heures fraîches, silencieuses et closes. […] Notre esprit n’a pas, comme au bord de la mer, dans les plaines, sur les montagnes, la joie de s’étendre sur le monde, mais le bonheur d’en être séparé ; et, borné de toutes parts par les troncs indéracinables, il s’élance en hauteur à la façon des arbres. Couchés sur le dos, la tête renversée dans les feuilles sèches, nous pouvons suivre du sein d’un repos profond la joyeuse agilité de notre esprit qui monte, sans faire trembler le feuillage, jusqu’aux plus hautes branches où il se pose au bord du ciel doux, près d’un oiseau qui chante. Çà et là un peu de soleil stagne au pied des arbres qui, parfois, y laissent rêveusement tremper et dorer les feuilles extrêmes de leurs branches. […] Notre esprit n’a pas, comme au bord de la mer, dans les plaines, sur les montagnes, la joie de s’étendre sur le monde, mais le bonheur d’en être séparé ; et, borné de toutes parts par les troncs indéracinables, il s’élance en hauteur à la façon des arbres, Couchés sur le dos, la tête renversée dans les feuilles sèches, nous pouvons suivre du sein d’un repos profond la joyeuse agilité de notre esprit qui monte, sans faire trembler le feuillage, jusqu’aux plus hautes branches où il se pose au bord du ciel doux, près d’un oiseau qui chante. Çà et là un peu de soleil stagne au pied des arbres qui, parfois, y laissent rêveusement tremper et dorer les feuilles extrêmes de leurs branches. Tout le reste, détendu et fixé, se tait, dans un sombre bonheur. Élancés et debout, dans la vaste offrande de leurs branches, et pourtant reposés et calmes, les arbres, par cette attitude étrange et naturelle, nous invitent avec des murmures gracieux à sympathiser avec une vie si antique et si jeune, si différente de la nôtre et dont elle semble l’obscure réserve inépuisable. » ‒ (Marcel Proust, “Sous-bois”, in “Les Plaisirs et les Jours”, ], chap.7, “Les regrets, rêveries couleur du temps, XXVI. Sous-bois, (Petit-Abbeville (Dieppe), août 1895), Éd. Calmann-Lévy, 1896) [1]
.
Si nous reprenons l’étude d’Elsa Vivant et d’Éric Charmes, leur conclusion semble assez claire :
- « Comme d’autres gentrifieurs, les artistes recherchent avant tout la proximité des centres urbains et de leurs ressources culturelles. Simplement, les artistes sont peut-être plus désireux que les autres de bénéficier de ces ressources. Comme, en même temps, ils sont particulièrement mal dotés en capitaux économiques, les quartiers populaires centraux et péricentraux leur apparaissent facilement comme une terre promise. Cette spécificité est d’autant plus marquée que les artistes sont généralement à la recherche de grandes surfaces pour installer leur atelier et que, fort opportunément pour eux, les quartiers populaires péricentraux regorgent de friches industrielles à investir (éventuellement sous forme de squat). C’est essentiellement en ce sens qu’on peut considérer les artistes comme des pionniers. Il est plus difficile en revanche de les considérer comme un groupe social qui ouvrirait une voie nouvelle à d’autres, les artistes eux-mêmes étant parties prenantes d’évolutions qui les dépassent. Ce sont du reste d’autres acteurs du processus (promoteurs, aménageurs publics) qui les mettent en scène en tant que pionniers de la gentrification. » ‒ (Référence : Elsa Vivant et Éric Charmes, « La gentrification et ses pionniers : le rôle des artistes off en question », Métropoles, 3, 2008, DOI : 10.4000/metropoles.1972)
Donc, les artistes sont amené.e.s à accéder à des espaces en correspondance ou en adéquation avec leur propre régime économique dont on a vu plus haut qu’il est généralement très bas, irrégulier et précaire. L’accès à des espaces et des moyens “gratuitement” ou à des coûts très bas est le principal objectif ; comme également, la gestion collective de ces espaces et ressources amenant à plusieurs régimes de mutualisations et d’échanges.
Le paradoxe restant que dans les pratiques artistiques s’allient de façon complexe des aspects compétitifs individuels et des aspects coopératifs collectifs ; le but (notamment pour le Projet Neuf) est que ces aspects ne s’annulent pas ni ne s’excluent l’un l’autre.
Dans ce sens, ce type de projet est dans son fondement à la fois politique (ou politisé) et artistique : il reste centré sur la création artistique et sur l’action artistique en préservant et en animant un rapport conciliant et actif avec ses environnements et, on l’espérerait, avec ses voisinages (afin de ne pas faire dévier la recherche d’autonomie vers une certaine autarcie et isolement).
La question demeurant : comment contourner la tendance opératoire gentrificatrice ? Et par quels moyens ?
.
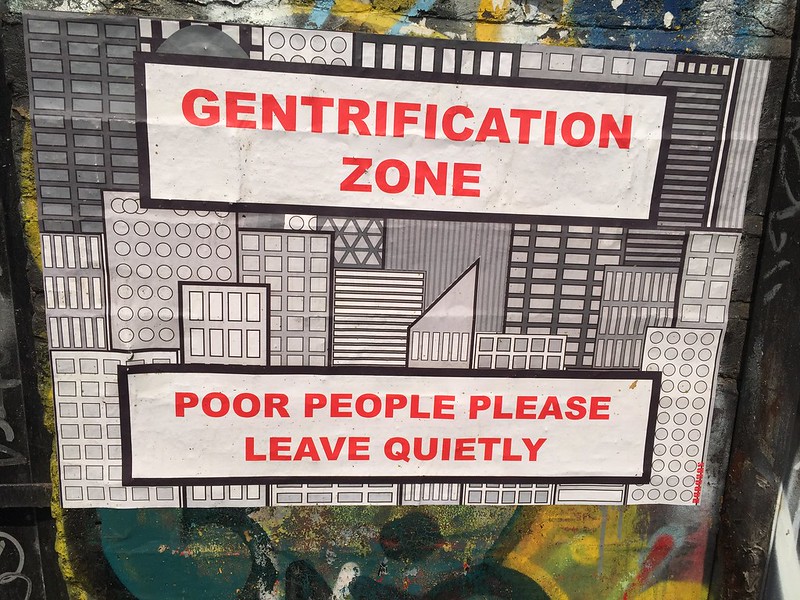
Street art à Londres / © Mat Brown (Creative commons – Flickr).
.
.
3
Le P9 et le site du Moulin du Pé : une expérimentation de projets, un projet d’expérimentations
.
.
3a
Une expérimentation de projets
Puisque le Projet Neuf se fonde sur une “expérimentation de projet” (commun) et sur un “projet d’expérimentation” (de présence sur un site urbain, social, géographique), il est intéressant de voir comment depuis juin 2019 (l’entrée de l’association dans le bâtiment 89, la maison 105) et depuis l’été 2018 (l’accès aux jardins), quels sont les projets et les attitudes qui peuvent favoriser ce type d’expérimentation et de laboratoire.
Nous pouvons en déceler plusieurs (ou quelques-uns) :
- le “Jardin des Mesures”, “La Pébipologie”, “les WAou” [2], les “Open Summer”, “Nomos Nomade”, “les soirées” (cycle des cinémas, cycle des performances), etc.
.

Le bâtiment 89, là où opère le Projet Neuf à Saint-Nazaire (Source Estuaire, Mireille Peña.
.
.
3b
Un projet d’expérimentations
Tous (ces projets) ont en commun l'exploration publique de formes expérimentales d’expériences d’œuvres (en cours de réalisation, en process, méconnues, spontanées, etc.) sans avoir à désigner un public ou à s’appuyer sur un “capital public” (le lieu n’est pas ERP (établissement recevant du public) et l’association ne s’est pas donné comme mandat et mission de programmer et de diffuser : ce n’est pas son travail et d’autres structures missionnées pour cela le font). L’association avait mené un travail antécédent (entre 2017 et 2019, avant d’avoir accès au bâtiment) par des actions de projets et d’infiltrations dans la ville : le “NEM experience”, “L’Héhodrome”, “Le Petit-Maroc-Île”, “L’Île de Sauvegarde des Échos” (LISE), etc. montrant ainsi d’autres formes possibles d’art dans l’espace public (voir la notion québécoise de “manœuvres” [2]).
Ces projets semblent avoir aussi comme dénominateur commun d'expérimenter le site sous différentes formes (même à l’échelle de la ville) et de montrer le site (sa configuration, son aspect de friche et d’espace en transition, etc.) comme espace d’expérimentation. En étant hors des murs habituels où “l’art se fait” ou où “l’art se montre”, le rapport au contexte est d’emblée posé. En phase de recherche, une problématique est cernée : “comment l’art se comporte dans des contextes” (a priori non dévolus à l’art) ? Ce qui amène à des questions d’écologie, de sociabilité, d’interactivité, d’économie, etc. par rapport aux milieux.
.

WAou, série de workshops artistiques (ou pas), convention P9 / Ensa Bourges. Document de l’exposition “Bisous WAou”, galerie La Box, janvier-février 2023 (le fil WAou sur ce blog.
.
.
3c
Les problématiques, les risques
Si la problématique “d’occuper” un site, de façon temporaire (squats, occupation précaire, etc.) est questionnante, d’une part politiquement (légalité, illégalité, autorisation), et d’autre part économiquement (en nature, subvention), il s’agit de voir si les enjeux de cette présence dans et sur un lieu et de cette “occupation” (s’occuper d’un espace) restent artistiques ou dépassent l’art au service d’un urbanisme et d’une économie galopante.
Le Projet Neuf en tant qu’association et regroupement d’artistes ne met-il pas ses dernièr.e.s en porte-à-faux ? Entre un travail gratuit (ou tellement peu onéreux) de gardiennage et de maintenance (celui-ci étant incomparable avec le coût réel d’un tel travail fait par une entreprise) et d’être une sorte de tampon “paisible”, “pacifiant”, “d’animation”, sur une période où un terrain est dans une période d’attente (et apparaît conséquemment délaissé et disqualifié) avant sa valorisation immobilière et la capitalisation de sa plus-value (voir citation ci-dessous).
-
Est-ce que cette présence et ce travail bénévole ne cachent pas ou maquillent une gentrification en cours qui ne fera qu’engendrer des inégalités plus grandes ?
-
Le deal est-il juste ? (entre bénéficier d’un espace et accepter une instrumentalisation)
-
La présence et l’occupation sont-elles automatiquement complices ?
-
Et les projets initiés sont-ils ou peuvent-ils être vus comme gentrificateurs ? (ce qui a provoqué une question récente : “La Pébipologie est-elle elle-même gentifricatrice ?”, par omission ou par défaut…)
-
« Ainsi, divers projets urbains récents montrent que la symbolique du squat d’artistes ou du lieu « alternatif » permet de retourner le stigmate de la friche industrielle en atout (Vivant, 2006b). Le rôle des artistes plus ou moins précaires dans la revalorisation symbolique des quartiers populaires a également été mis en évidence dans diverses études (Bidou et Poltorak, 2008). […] Ces travaux ne s’intéressent pas spécifiquement aux squats ou aux lieux « alternatifs », mais ils accréditent la thèse d’un rôle pivot des artistes (au sens large de la catégorie) dans la gentrification. » ‒ (Référence : Elsa Vivant et Éric Charmes, « La gentrification et ses pionniers : le rôle des artistes off en question », Métropoles, 3, 2008, DOI : 10.4000/metropoles.1972)
.

Jardin des Mesures et Projet Neuf, Fête des Mûres, mai 2022.
.
.
3d
Comment contourner cet écueil ?
Si on s’attache à La Pébipologie, il est peut-être intéressant de relater certains faits et exemples qui indiquent certaines formes de résistance que peut avoir un projet artistique par rapport à de tels enjeux (politiques, économiques, immobiliers).
En première instance, on tendrait à croire qu’un projet artistique ne fait pas le poids en face de tels enjeux (on dira qu’il est le plus souvent d’emblée décribilisé), et même qu’un projet d’art ne peut avoir d’impact sur eux tant les domaines sont volontairement disjointés et vus non équivalents.
.
1/
- Pourtant lorsque le MIP (Musée Invisible de la Pébipologie) est né, il a été présenté à des membres de l’agglomération (Communauté de communes), photos à l’appui (celles où l’on voit le MIP se poser sur le terre-plein), il y eut un certain émoi avant que la réponse ne tombe : “il est bien entendu impossible qu’une telle construction existe, il y a un projet urbain prévu” ; à laquelle nous avons répondu : “Pas de soucis, il s’agit d’un Musée invisible, il ne gênera en rien le projet urbain”. Néanmoins, le doute a persisté car la photographie montrait bien une réalité (= qui reste dans l’œil). Et puisque La Pébipologie apparaît comme un instrument optique de terrain et comme un projet de production peu additif d’œuvres physiques (des “contre-monuments” en quelque sorte si on essaie de répondre à la question de l’art dans l’espace public posée par les politiques culturelles) ‒ voire ne serait-il pas un projet de déproduction (en parallèle de la notion de décroissance) ? ‒. C’est un projet qui par l’empreinte mentale via la perception rétinienne des images (voir des images est faire exister), toutes prises sur le terrain lui-même, font exister automatiquement les œuvres à partir du moment que l’on repose le regard sur le terrain. Ce Musée en plein air existe maintenant et dorénavant de façon permanente (dans les regards et dans les esprits) et dématérialisée. Il sera difficile de défaire cette image du Musée de la réalité du site (tout du moins de son état capté avant les opérations d’aménagement). La ville n’avait pas de musée auparavant ; aujourd’hui elle en aurait un (sans le savoir). Pour le voir, il faudra pratiquer et feuilleter sur le terrain la publication des Tomes de La Pébipologie [1, paragraphe 8] [2].
.
2/
- À un autre moment, l’agent de la Communauté de communes en charge du projet urbain du Moulin du Pé a été interrogé par ses supérieurs : “que font ces artistes dans le bâtiment et sur le site ?”. Il a suffi à cette personne de poser sur la table le premier volume prototype de La Pébipologie (cette version faisait 800 pages) pour faire taire les suspicions ou les reproches éventuels. (fait raconté par l’agent)
On n’en fera aucune déduction (est-ce l’épaisseur et le poids qui ont fait peur ?, est-ce le titre “déclaratif” et “compliqué” qui a tout de suite dérouté ou convaincu ?, etc. etc.) mais effectivement par la suite l’association n’a pas été interrogée à propos de sa présence “utile” sur le site : le bail a été reconduit chaque année tacitement sans demande d’évaluation et de restitution des activités de l’association en contre-partie de la gratuité d’usage des lieux.
.
3/
- D’autre part, lorsque l’une des artistes de La Pébipologie, Sally Mara Closterwein, a démarré son projet des “Parcelles Délaissées” avec l’intention de poursuivre le projet inachevé “Reality Properties : Fake Estates” (1973-1974) de Gordon Matta-Clark, nous avons fait une réunion avec l’agent responsable du projet urbain. Le point de départ était que sur le cadastre du terre-plein du Moulin du Pé apparaissait une minuscule parcelle : la 0106 ; et que l’artiste était intéressée pour savoir si elle resterait accessible et en l’état dans le cadre du projet d’aménagement. Nous avons expliqué notre recherche sur les parcelles délaissées et l’intention de développer le projet sur toute la commune de Saint-Nazaire (et peut-être de l’agglomération). Après la surprise exprimée par l’agent, c’est l’intérêt qui a grandi mais que là, dans ce cas concret, les parcelles du terrain allaient être rassemblées pour créer les lots à vendre aux promoteurs. Donc cette parcelle n’existerait plus. Son exigüité si attrayante disparaîtra. Toutefois l’échange a continué au sujet d’un accompagnement pour d’autres parcelles délaissées de la collectivité territoriale. Le projet est resté ouvert et est encore aujourd’hui “potentiellement” réalisable.
La question a ressurgi lorsque des promoteurs candidats à l’achat du premier lot à construire sont venus rencontrer l’association. On se souvient de l’un d’entre eux avec lequel nous avons discuté de 1% et de la possibilité de réserver un ou des espaces pour des réalisations artistiques. Néanmoins, dans ce cas, nous ne sommes plus dans l’exemple d’une parcelle délaissée, mais “attribuée”, ce qui change complètement la donne.
Nous pourrions de même relater d’autres exemples touchant les autres projets : avec les jardins (Jardin des Mesures, les WAou, les Open Summer, etc.).
Mais ce que nous avons découvert avec ces premiers exemples, c’est qu’une façon de contourner les effets de la gentrification serait de s’appuyer sur “les puissances de l’art” ‒ et non sur l’organisation d’un “contre-pouvoir” des pouvoirs de l’argent, de la capitalisation, de l’accompagnement politique et des manipulations qui en découlent ‒. Ces puissances que nous évoquons sont à même de créer des vraies fictions (réelles) (car tout cela n’est jamais “pour du beurre”) pour contrer les mauvaises fictions (qui de leur côté maquillent ce qui se trame réellement aux dépens des personnes sur le site qui ne feront que subir ou être instrumentalisées ou être mises devant le fait accompli).
.
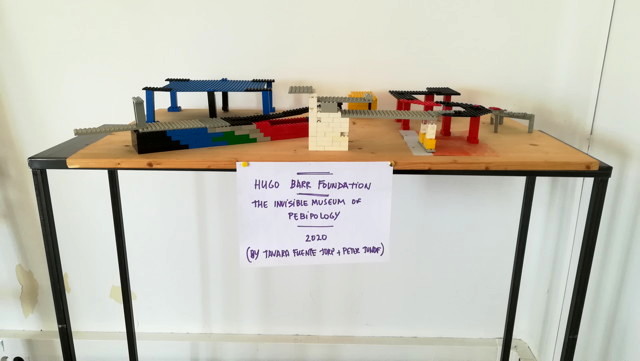
La Pébipologie, le Musée Invisible de La Pébipolie, MIP, juillet 2020.
.
.
3e
Des exemples
Pour cela des exemples historiques et actuels sont utiles à rappeler, autant pour leurs échecs, leurs défections que pour leurs succès (ce qui sans doute donnera lieu à d’autres études plus tard) :
-
les centres autogérés au Québec (et les artist-run spaces : [1 [2 [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]) (la littérature à ce sujet est abondante)
-
Le projet de “Fluxhouse Cooperatives” (1966-1975) mené par George Maciunas à New York [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
-
le dispositifs de commandes dans l’espace public en Angleterre (Arts Council England / Creative People and Places), en Irlande (The Arts Council Ireland / Artist in the Community Scheme) et en France (les Nouveaux Commanditaires). À titre d’exemples : les études menées par Estelle Zhong-Mengual dans son ouvrage “l’art en commun” à propos des artistes Jeremy Deller, Marcus Coates et le duo Lone Twin) (là, il y a beaucoup à aller chercher, à trier, pour bien différencier les dispositifs)
-
les films et projets d'Andrew Kötting se basant sur des faits historiques revisités et sur la psychogéographie comme moyen d’exploration d’un espace [1] [2] [3] [4] [5] [6] (un petit article là-dessus ce serait pas mal ‒ ici une interview de 2017)
-
Le Land Art américain (étudier comment les projets des artistes américains du Land Art (Earthworks) ont pu être réalisés sur des terrains à l’aune des questions de propriété, d’usage, de pérennité, de signalisation, etc.) (voir les images ci-dessous) (sur ce point, beaucoup de travail encore à faire)
-
Comme également des initiatives et des recherches actuelles et historiques que nous commençons à étudier : La Foncière Antidote ; La redirection écologique et les communs négatifs ; les questions de l’art et l’argent et la pensée de Karl Polaniy à propos de ce qui est non-monnayable ; celle de Günther Anders face à la stupeur ; le positionnement de la psycho-géographie (la dérive) par rapport à l’art ; choisir le silence et l’invisibilité ? ; etc. (tout cela est à trier et à articuler pour arraisonner les questions posées au sein du Projet Neuf via l’espace de recherche)
.
-
et ce que nous allons voir plus bas : l'École de Barbizon
-
etc.
.
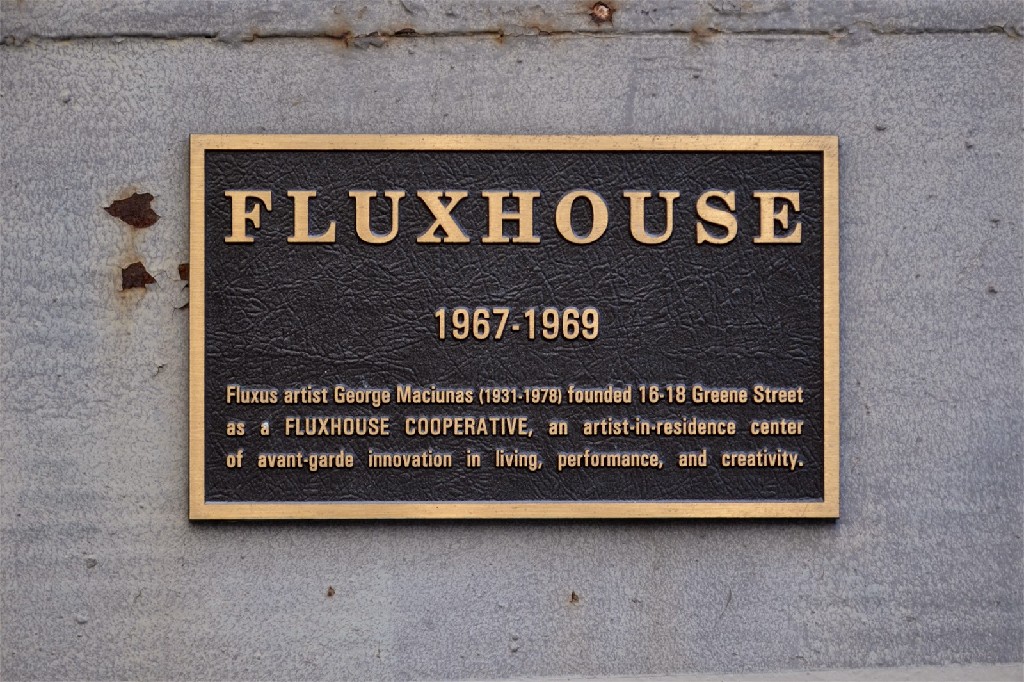
Fluxhouse Cooperatives, George Maciunas, Soho, New York.
.
.
4
Une incise
.
.
Le P ne sera pas un musée
- « Vous voulez exposer des objets ? Alors, construisez un musée et si vous voulez que ça devienne une attraction qui mette votre ville, votre pays, sur la carte mondiale, prenez un.e architecte star, gentrifiez l’environnement, ajoutez des boutiques de design, une librairie, des restaurants, pensez à des animations et surtout n’oubliez pas un emplacement iconique pour les selfies. »
(Françoise Vergès, Entretien avec Johan Faerber, revue en ligne Diakritik, 13 mars 2023)
.

Nancy Holt, “Sun Tunnels”, Great Basin Desert, Utah, 1976.

Robert Smithson, “Spiral Jetty”, Great Salt Lake, Utah, 1970.

Michelle Stuart, “Niagara Gorge Path Relocated”, Lewiston, NY, 1975.

Richard Long, “Dusty Boots Line”, the Sahara, 1988.
.
.
5
Une hypothèse
.
.
5a
Le P : un site à destination artistique
-
Et si par les projets activés sur place ‒ par La Pébipologie, par Le Jardin des Mesures et le PavÉ [2], par les WAou, par les Open Summer, ou encore, de façon plus large, par LISE L’Île de Sauvegarde des Échos, etc. ‒, l’ensemble du site géographique ‒ le bâtiment 89, les jardins, le 105], le terre-plein en friche ‒ avait pris durant ces quatre-cinq années (2018-2019/2023) une qualité nouvelle qui serait devenue reconnaissable et qui permettrait au site de demeurer et de se maintenir tel un espace d’expérimentations artistiques (= un libre-lieu) et une œuvre-milieu ?
-
Les opérations en cours du chantier d’aménagement et de terrassement pour le futur projet urbain remplace dorénavant par d’autres vues, plus classiques, moins expressives et moins énigmatiques, les aspects visuels de ce qui suscitait jusqu’à présent les projets et les projections ‒ les buttes du [P], la sierra du ouesterne, le lac et le promontoire, les jardins du sanatorium, les distances et les profondeurs cinémascopiques, etc. ‒ et qui enclenchait des nouvelles méthodes de fictions et de fabrications d’images et de récits ‒ notamment celles “trouvées” dans le cadre de La Pébipologie : la stratégie du filet, la tactique du déguerpissement, le principe des trous et des buttes et ses corollaires de la chapologie et de ses formes coloradaho, son côté flanc du Vésuve, lande maritime de Montauk, Trouville / Holetown / Charlestown et lande de Lunebourg (au passage : qui fut la première réserve naturelle d’Allemagne créée en 1910), la géopoétique de la lémancolie, la paisabilité du sanatorium, le jumelage avec des doubles tel le site angevin du Vaujou (sur la couverture des Tomes de La Pébipologie) et celui espagnol de Berrocal, etc. etc. ‒. Le “site” du P a-t-il disparu, annulé et remodelé par les machines du BTP ?
.

L’espace du P, juillet 2020.

Août 2022.
.
-
Et si, en prenant l’exemple des procédés optiques qui fondent La Pébipologie ‒ ceux entoptiques (images et visions internes, dans l’œil), paréidoliques (qui permet de distinguer des formes dans d’autres formes), kaléidoscopiques (des faisceaux de réfractions et de réflexions), hypnagogiques (visions et images flottantes), d’où l’importance du rôle des lentilles de Spinoza Spinola ‒ combinés et associés aux questions de la véracité et de la capacité imageante du réel que démontre la reproduction photographique et à celles, davantage transportantes, des images mentales produites par la lecture ‒ André Malraux parlait à propos du “Musée Imaginaire” de « contagion » et de « fiction sérieuse », Maurice Blanchot ajoutera d’un « apparent désordre », par le biais et le double-moyen de l’écriture (la “praxis” littéraire et l’expérience “affective” que décrit Marielle Macé) et de la « création par la photographie » (Source)) ‒, le site ne pouvait disparaître et ne pouvait que perdurer, et qu’à présent, maintenant que les images sont créées et établies et qu’elles sont imprimées dans nos esprits et nos expériences ‒ à l’image de celles de l’existence du MIP le Musée Invisible de La Pébipologie, existence qu’on ne peut plus dénier, comme celle encore à l’état de potentiel, d’une cartographie des échos dans la ville réactivables par les cris des habitant.e.s (LISE) et d’infiltations hypothétiques rendant le quotidien et le hasard dans leur propre magie respective ‒, il serait impossible de les faire disparaître, La Pébipologie, notamment, étant leur instrument optique de visibilité.
-
Ne pourrions-nous pas déclarer le site du P comme “site à destination artistique”, tel un “Shangri-La”, un “Yoknapatawpha”, un “Balbec, une “Terremer”, un “riverrun” ? C’est-à-dire un espace à la fois physique, virtuel et imaginaire, qui, à l’instar d’un “parc”, d’une “réserve” (termes qui ne font pas partie du bon vocabulaire à employer mais qui donnent le “ton” de la proposition), et du premier “site artistique” préservé qu’en son temps l'École de Barbizon a pu initié par l’obtention d’un décret officiel en 1853 qui a permis de mettre hors exploitation et de soustraire à tout aménagement tout un espace de “production d’images” en plein air et sur le motif (les membres de cette École étaient peintres) dans la forêt de Fontainebleau ? (voir paragraphes suivants)
-
La reconnaissance d’une telle entité aurait l’avantage d’être peu coûteuse et peu onéreuse (en tout cas à une échelle non équivalente à celle d’un projet immobilier) et le bénéfice de laisser imaginer comment librement la représenter et la signaler sans qu’elle ne capture et ne capte un espace ni ne participe d’un mécanisme d’attractivité, d’urbanisation et de croissance productiviste. Elle serait un “moins” parmi des “plus”, un “moins” beaucoup plus intensif, discontinu, troublant et émotionnel, davantage affectée, tolérable et désirable, que toute chose ajoutée et érigée.
.

Peintres à Barbizon, fin du XIXième siècle.

Camille Corot, “Paysanne en forêt de Fontainebleau”, vers 1830-1832 ©Senlis, musée d’Art et d’Archéologie - (crédits : C.Schryve).
.
5b
Références
« L’intuition artistique ressemble en effet aux hallucinations hypnagogiques − par son caractère de fugacité, − ça vous passe devant les yeux, − c’est alors qu’il faut se jeter dessus, avidement. Mais
le plussouvent aussi l’image artistique se fait lentement – pièce à pièce – comme les diverses parties d’un décor que l’on pose. »
(Gustave Flaubert, “Correspondance (1829-1880)”, Lettre de Flaubert à Hippolyte Taine, Croisset, 20 novembre 1866, Bibliothèque nationale de France, NAF 28420, f°12-13. Et inLa Pléiade, t. III, p. 561) (Source1 ; Source2 ; Source3 ; Source4)
« Nous distinguerons donc les images dont la matière est empruntée au monde des choses (images d’illustration, photos, caricatures, imitations d’acteurs, etc.) et celles dont la matière est empruntée au monde mental (conscience de mouvements, sentiments, etc.). Il existe des types intermédiaires qui nous présentent des synthèses d’éléments extérieurs et d’éléments psychiques, comme lorsqu’on voit un visage dans la flamme, dans les arabesques d’une tapisserie, ou dans le cas des images hypnagogiques, que l’on construit, nous le verrons, sur la base de lueurs entoptiques. » (Jean-Paul Sartre, “L’Imaginaire”, Gallimard, 1940, p.44)
« Dans le demi-sommeil, nous avons affaire à des consciences imageantes. Reste à savoir quelle est leur matière (…). Pour beaucoup d’auteurs, cette matière est fournie par les lueurs entoptiques. »
(Jean-Paul Sartre, “L’Imaginaire”, Gallimard, 1940, p.59)
« L’image hypnagogique ne se donne pas comme étant quelque part (…), elle n’est pas entourée d’un univers imaginaire. Au contraire, le personnage du rêve est toujours quelque part. […] Ainsi l’image hypnagogique est une apparition isolée, « en l’air », pourrait-on dire, le rêve est un monde. »
(Jean-Paul Sartre, “L’Imaginaire”, Gallimard, 1940, p.214)
« Je ne fais pas non plus allusion à ce qu’on appelle “muscae volitantes” – ombres projetées sur les bâtonnets de la rétine par des atomes de poussière dans l’humeur vitrée, qui sont perçus sous l’aspect de filaments transparents s’en allant à la dérive à travers le champ visuel. Ce qui se rapproche le plus, peut-être, de mes mirages hypnagogiques, c’est la tache colorée, le coup de poignard d’une image persistante, dont la lampe, que l’on vient juste d’éteindre, blesse la nuit palpébrale. »
(Vladimir Nabokov, “Autres rivages”, 1951, traduction de Yvonne Davet, in “Œuvres romanesques complètes”, t. II, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2010, p.1168)
« Pour assurer un arrière-fond complètement lisse, il faut éliminer les gargouilles hypnagogiques et les essaims entoptiques qui tourmentent la vision fatiguée résultant d’une satiété d’étude d’une collection de pièces de monnaie ou d’insectes. »
(Vladimir Nabokov, “L’Original de Laura” (posthume), 1940, p.59)
« Si vous regardez tous les murs tachetés de diverses taches ou avec un mélange de différents types de pierres, si vous êtes sur le point d’inventer une scène que vous serez en mesure de voir une ressemblance avec divers paysages différents ornés de montagnes, rivières, rochers, arbres, plaines, vallées larges et divers groupes de collines »
« Je ne manquerai pas de mettre, parmi ces préceptes, une invention qui, bien que petite et ridicule est utile pour exciter l’imagination. Regarde sur un mur barbouillé de taches ou de pierres mélangées, tu y verras des paysages, des montagnes, des fleuves, des batailles, des groupes ; tu y découvriras d’étranges airs de paysages que tu pourras ramener à une bonne forme. Il en est de ce mur comme du son de la cloche où tu entendras ton nom ou un vocable que tu imagineras. » (Leonardo da Vinci, “les 14 manuscrits de l’Institut de France”, Manuscrit n°2038 italien, de la Bibliothèque Nationale, acquisition 8070, folio 22 v., traduction Joseph Péladan, Paris, Bibliothèque internationale d’édition, E. Sansot et Cie Éditeurs, 1910, p.64) (Source)
« […] dans le nom de Balbec, comme dans le verre grossissant de ces porte-plume qu’on achète aux bains de mer, j’apercevais des vagues soulevées autour d’une église de style persan. »
(Marcel Proust, “À la recherche du temps perdu”, Tome 1, “Du côté de chez Swann” (1913), vol. 2, troisième partie, “Nom de pays: le nom”, p.231) (Source)
.



La lande de Lunebourg en Allemagne si chère à l’écrivain Arno Schmidt. (référence
.
.
6
L’École de Barbizon
.
6a
Un insert proustien
- ‒ « Ce n’est pas seulement une forêt que je voudrais voir, c’est Fontainebleau… Un endroit unique, vivant, personnalité qui ne se retrouve à nul autre endroit du monde, faite de l’âge de ses rues, de leur ouverture sur la forêt, des traits des collines, de la figure de la plaine, cette chose unique qu’est un lieu, individualité symbolisée par son nom qui n’est en effet à aucun autre : Fontainebleau, nom doux et doré comme une grappe de raisin soulevée. Ce lieu auquel je pense tant, que je désire tant voir, existe […] »
(Marcel Proust, “Jean Santeuil”, 1895-1900, cité par Anne Vallaeys dans “La Forêt Des Passions” (2000), histoire littéraire et artistique de la forêt de Fontainebleau)
.
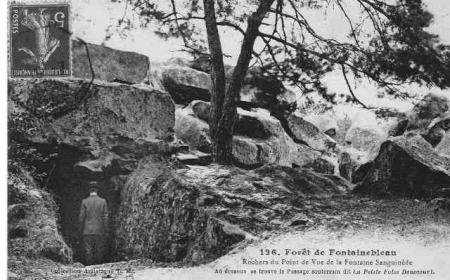
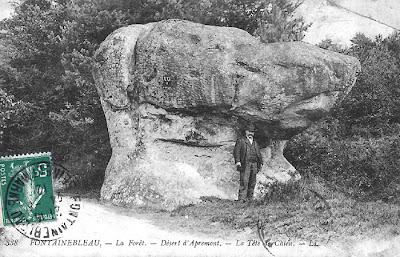
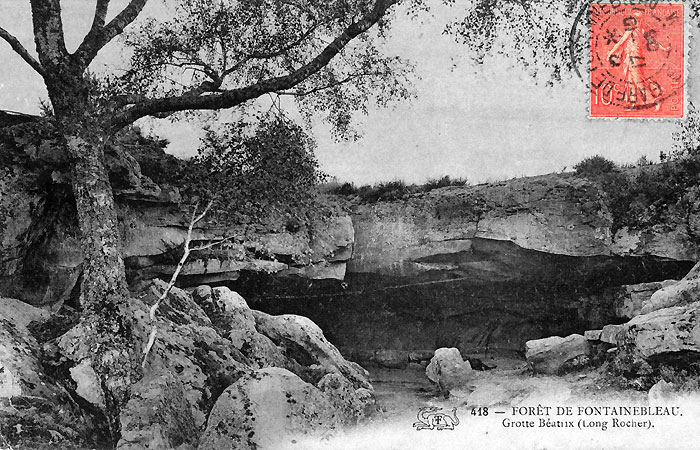
Vues en forêt de Fontainebleau.
.
.
6b
Les peintres de Barbizon, éco-guerriers ?
Alors en effet nous avons cité le peintre Diaz de la Peña dans un article précédent. Nous mettions ses peintures de sous-bois en relation avec nos visions sur le P afin de maintenir et soutenir ces dernières à présent que le chantier d’aplanissement du terrain est en cours éliminant une à une les scènes vues [1]. Et en creusant un peu, on a découvert progressivement le lien entre ces questions de gentrification et le mouvement de l’École de Barbizon.
Tout cela en partant de Narcisse Diaz de la Peña qui était un peintre français de paysages et de figures, membre fondateur important et influent de l'école avant-gardiste de Barbizon.
Pour la plupart des chercheur.e.s, les peintres de Barbizon furent des pionniers de la protection de la nature. Émus par la beauté et la fragilité de la forêt de Fontainebleau, ils réclamèrent à Napoléon III la création de réserves paysagères sur le site. Leur combat fut à l’époque relayé par George Sand, vue également comme précurseuse de l’éco-féminisme (Source).
‒ « Grâce à eux [les peintres de Barbizon], cette forêt a été le premier site naturel à avoir fait l’objet de mesures de protection. La création, en 1861, d’une réserve artistique a servi de référence pour la création du premier parc national au monde, celui de Yellowstone, aux Etats-Unis, en 1872 ». Occupant 25 000 hectares, dont 80% sur la commune du même nom, Fontainebleau constitue la plus grande forêt de plaine d’Europe, offrant une extraordinaire mosaïque de milieux naturels, forêts, dunes, zones humides, etc. et un massif au carrefour d’influences climatiques atlantique et continentale, d’où une juxtaposition d’espèces et d’habitats, avec une végétation quasi méditerranéenne. (Source).
Les peintres de Barbizon firent aboutir cette première initiative de protection de la nature dans le monde : étaient-ils ainsi les premiers “écoguerriers” [2] [3 tels qu’on a commencé à appeler les défenseurs écologistes dans les années 70-80 ?
Replongeons-nous dans cette histoire.
À cette fin, nous allons opérer en mosaïque par “coupures aux ciseaux” et “collage” de différents textes et articles glanés sur Internet.
.

.
.
6c
La littérature avant la peinture
.
Étienne Pivert de Sénancour
En 1804 parait “Obermann”, un roman épistolaire d'Étienne Pivert de Sénancour (1770-1846). « Promeneur solitaire » dans la lignée de Jean-Jacques Rousseau, son héros Obermann se livre à de sombres rêveries tout en parcourant « les rochers stériles et les bois de Fontainebleau » (Source). La reconnaissance de l’œuvre est tardive, et doit beaucoup aux éloges de Sainte-Beuve (1832) et de George Sand (1833). C’est le commencement de la vue de la forêt de Fontainebleau comme site de mises en récit. (Source2, p.83)
- ‒ « Il faut que je vous parle davantage de ce lieu un peu étranger au milieu de nos campagnes. Vous comprendrez mieux alors comment je m’y suis fortement attaché. […] je parcourus avidement ces solitudes ; je m’y égarais à dessein, content lorsque j’avais perdu toute trace de ma route, et que je n’apercevais aucun chemin fréquenté. Je me retournais aussitôt, je m’enfonçais dans le plus épais du bois ; et, quand je trouvais un endroit découvert et fermé de toutes parts, où je ne voyais que des sables et des genièvres, j’éprouvais un sentiment de paix, de liberté, de joie sauvage, pouvoir de la nature sentie pour la première fois dans l’âge facilement heureux. Je n’étais pas gai pourtant : presque heureux, je n’avais que l’agitation du bien-être. Je m’ennuyais en jouissant, et je rentrais toujours triste. »
-
(Étienne Pivert de Sénancour, “Obermann”, Lettre XI, 1804, pp.70-71) (Source)
.
George Sand et Alfred de Musset
C’est plus tard en 1833 que Sand et son amant Alfred de Musset, alors âgés de 29 et 23 ans, partent en excursion à Fontainebleau. À cette occasion, les deux romantiques décident d’aller se promener dans les gorges de Franchard, à la pleine lune.
Dans ce lieu va se dérouler une scène peu habituelle que George Sand décrira dans un roman autobiographique, paru en 1859 et intitulé « Elle et lui ».
‒ remarquons la coïncidence avec notre Er et Sie sur lequel nous nous étions appuyé dans cet article et on pensera également à un autre roman de Sand, Indiana, un roman féministe et anti-raciste, titre d’un épisode du ouesterne spinoza) ‒,
et que relatera également Alfred de Musset dans son ouvrage « La Confession d’un enfant du siècle » (1836) [2] [3], puis Paul de Musset, frère d’Alfred, dans « Lui et Elle » (1859) et de Louise Colet dans « Lui » (1859), et l’affaire sera commentée en parallèle par Adolphe de Lescure dans son livre « Eux et Elles » (1860) sous-titré “histoire d’un scandale” (Elleux ? scandaleux ?).
Alors que les amants sont séparés de quelques mètres, Alfred de Musset a une hallucination et pousse un cri effrayant. En plein cœur de la forêt, le jeune homme affirme avoir vu apparaitre son double de façon hideuse.
Cet épisode est souvent relié à ce qui allait s’appeler le « mal du siècle », un mélange d’ennui et de désenchantement existentiel propre aux Romantiques, et que sans doute nous relierons à ce que La Pébipologie appelle la lémancolie que nous avons fait démarrer par la lecture de Proust et ses remarques à Beg-Meil en Bretagne : « Ce lac qui est devant moi […] » « […] avec un fond de décor tout à fait lac de Genève » (Source).
(Source1 ; Source2 ; Source3)
Ainsi Louise Colet évoque-t-elle à travers le regard de l’avatar de Musset le paysage qui va préluder au moment de crise :
- « Vers le soir, nous arrivâmes au milieu d’un amas de rocs géants et bouleversé qui était le but de notre excursion. C’était quelque chose de grandiose et de sinistre à la fois que ces énormes blocs recouverts de mousses et de végétations, et qui semblaient avoir été disjoints par quelque lointain tremblement de terre. […] Le crépuscule disparaissait et faisait place à la nuit ; quelques étoiles se levaient, et le disque de la lune se dessinait pâle sur l’étendue des cimes vertes ; devant moi les dernières bandes de pourpre du soleil couchant s’étendaient en lignes enflammées ; elles projetaient sur ma tête des lueurs d’incendie. »
(Louise Colet, “Lui, roman contemporain”, Paris, Michel Lévy Frères, 1863, pp. 141-142.)
Ajoutons une remarque : à propos des “dernières bandes de pourpre” qui sans équivoque relie au pourpre et à ses lambeaux chers à Horace que nous avons convoqué dans le récent vingtième épisode et les commentaires du ouesterne spinoza : “mirages et paréidolies…” ‒ (référence : Horace, “De Arte poetica”, 1-9).
De son côté, Alfred de Musset dans son ouvrage décrit :
- « La soirée était superbe ; la lune se levait derrière nous ; je la vois encore à ma gauche. Brigitte la regarda longtemps sortir doucement des dentelures noires que les collines boisées dessinaient à l’horizon. À mesure que la clarté de l’astre se dégageait des taillis épais et se répandait dans le ciel, la chanson de Brigitte devenait plus lente et plus mélancolique. »
(Alfred de Musset, “La Confession d’un enfant du siècle”, Paris, Félix Bonnaire éditeur, 1836, p. 226.)
Et George Sand précise :
- « Il avait eu une hallucination. Couché sur l’herbe, dans le ravin, sa tête s’était troublée. Il avait entendu l’écho chanter tout seul, et ce chant, c’était un refrain obscène. Puis, comme il se relevait sur ses mains pour se rendre compte du phénomène, il avait vu passer devant lui, sur la bruyère, un homme qui courait, pâle, les vêtements déchirés, et les cheveux au vent. »
(George Sand, “Elle et Lui”, Paris, Louis Hachette, 1859, p. 85.)
(Source pour ce paragraphe) : Sébastien Madriasse, “Alfred de Musset et l’épisode de Fontainebleau : une poétique de la forêt romantique entre merveilleux, sacralisation et ironie”, in “La forêt romantique”, PUB Presses Universitaires de Bordeaux, collection Eidôlon | 103, 2013, pp. 119-132.
.
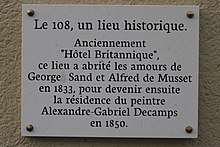
.
.
6d
La peinture, Camille Corot et L’école de Barbizon
Bref, après la littérature c’est l’art de la peinture qui va prendre le relais. Fontainebleau semble un microcosme : une forêt aux reliefs inattendus, propices aux effets surprenants, et d’une grande variété avec ses rochers, ses sables et ses arbres pluricentenaires. Et les peintres : « Les peintres de Barbizon / Ont des barbes de bisons », dit une chanson composée à l’auberge du père Ganne, QG de la révolte contre l’inspection des forêts qui va être lancée par la cohorte des artistes peintres, et futur lieu de l’actuel Musée des Peintres de Barbizon : “L’Illustration” n’hésite pas en 1858 à comparer Rome à Barbizon : “Ce village est presque une succursale de l’École de Rome dont l’auberge Ganne peut passer pour la Villa Médicis” (“L’Illustration”, 1858, 1er semestre, col. 31, n°796).
L’école de Barbizon désigne, de façon informelle, et sur une période d’activité de 1820 à 1875, à la fois le centre géographique et spirituel d’une succession de colonies de peintres paysagistes établies autour de Barbizon, et le désir de ceux-ci de travailler « en plein air et d’après nature » dans la forêt de Fontainebleau, une sorte de nature sauvage en réduction, loin de l’urbanisme étouffant de la capitale parisienne.
Alors que ses membres fondateurs s’étaient déjà tous éteints, le terme d'école de Barbizon est apparu a posteriori dans les années 1890 dans l’ouvrage du critique d’art écossais David Croal Thompson intitulé “The Barbizon School of Painters”. En réalité, il n’y a jamais eu d’école à Barbizon, mais bel et bien un groupe de peintres aux styles divers et aux techniques différentes qui se sont côtoyés entre 1830 et 1875 aux abords de la forêt de Fontainebleau. Sans doctrine, sans théorie, rejetant en bloc l’académisme d’une peinture considérée comme impressioniste, les peintres de Barbizon ont bénéficié de l’évolution des techniques pour s’exprimer en plein air. L’invention des tubes en étain, commercialisés en France dès 1840, offre aux peintres la possibilité d’une approche de la nature plus libre et des déplacements hors de leurs ateliers toujours plus longs. (Source1) (Source2 : Véronique Goudinoux, “Œuvrer à plusieurs: Regroupements et collaborations entre artistes”, collection Esthétique et sciences des arts, Presses Universitaires du Septentrion, Université de Lille, 2015, p.80)
Le premier à se rendre régulièrement de ce côté de la forêt de Fontainebleau fut sans aucun doute Camille Corot qui explore ce lieu dès 1822. Le Salon de Paris de 1824 marque un tournant car y sont exposés les maîtres anglais du paysage, tels que John Constable.
.

(Camille Corot, “Fontainebleau, en forêt”(vers 1823-1824), Bristol Museum & Art Gallery, Gallery 2).
.
Par la suite, l’invention du tube de gouache en 1840-1841 donc, l’ouverture d’une ligne de chemin de fer en 1849, sont autant de facteurs qui accélèrent le processus : de plus en plus de peintres vont à Barbizon, à Chailly-en-Bière, à Bourron-Marlotte, au point que la mode est lancée, qu’on les appelle les « plein-airistes », que la presse s’en amuse sous la forme de caricatures, montrant des dizaines de peintres massés devant leurs chevalets, chacun sous un parapluie (L’Illustration, n°352, vol. XIV 24 novembre 1849, “Les peintres de paysage dans la forêt de Fontainebleau” (Source2) (Source3 : Véronique Goudinoux, “Œuvrer à plusieurs: Regroupements et collaborations entre artistes”, collection Esthétique et sciences des arts, Presses Universitaires du Septentrion, Université de Lille, 2015, p.80) . Cette affluence et l’arrivée du train provoquent bien entendu l’ouverture de nombreuses infrastructures : restaurants, hôtels, épiceries, permettent aux peintres de séjourner plus longuement. Aujourd’hui l’auberge est devenue musée : le Musée des Peintres de Barbizon. Même si la forêt reste un domaine de chasse et de production de bois, son rôle récréatif et culturel devient de plus en plus important avec le développement du tourisme bellifontain. (Source)
.
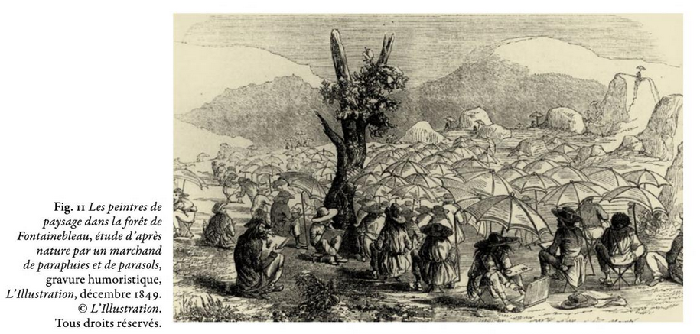
.
Pour mettre cela en contexte, appuyons-nous sur la description publiée par la galerie gantoise Chastelain & Butes spécialisée dans l’art des XIXe et XXe siècles et qui commente le travail du peintre Virgile-Narcisse Diaz de la Peña : « Avant le XIXe siècle, les artistes dessinaient mais peignaient rarement en plein air. Au milieu du siècle, la peinture de petites études en plein air est commune à Corot et à l’école de Barbizon. Bien que les méthodes et les concepts individuels des peintres de Barbizon diffèrent considérablement, ils ont en commun une dévotion totale à la nature et un désir d’être fidèles à leurs observations. Diaz s’est spécialisé dans les intérieurs boisés sombres dans lesquels les taches de lumière ou les bandes de ciel qui brillent à travers les branches créent des contrastes dramatiques ». À partir des sites qu’il affectionne particulièrement à Fontainebleau, le peintre se sert par ailleurs de la nature comme toile de fond, dans un style tantôt romantique et orientalisant, ou tantôt barbizonnien, pour y introduire des figures allégoriques, mythologiques ou proches du réel selon certains principes : « ne peindre que sur nature », « utiliser des couleurs plus vives » (conseils qu’il donna à Pierre-Auguste Renoir en 1863-1864) (Source).

(Théodore Rousseau (1812-1867), “Les chênes d’Apremont” (1850-1852), Paris, Musée du Louvre).

(Théodore Rousseau (1812-1867), “Le grand chêne”, vers 1840, Londres, Victoria and Albert Museum) (Source).

(Théodore Rousseau (1812-1867), “Étude de troncs d’arbres”, vers 1833, Strasbourg, musée des Beaux-Arts) (Source).

(Théodore Rousseau (1812-1867), “Étude de rochers”, vers 1829, Strasbourg, musée des Beaux-Arts) (Source).
*(Travail de peinture qu’on est tenté de rapprocher de celui d'Adalbert Stifter (1805-1868), écrivain, poète et peintre autrichien, notamment dans ses “Felsstudie” et “Steinstudie”)
.
.
6e
Villages et colonies d’artistes
(Selon le livre de Véronique Goudinoux, “Œuvrer à plusieurs: Regroupements et collaborations entre artistes”, collection Esthétique et sciences des arts, Presses Universitaires du Septentrion, Université de Lille, 2015, dont nous reprenons ici quelques passages)
-
*Quelles sont ces modalités différentes de travail, de “collaboration”, d'“association”, de “coopération” [1] que les artistes vont chercher ?
-
« À partir des années trente du XIXième siècle, certains artistes choisissent […] (il s’agit bien d’un choix, non d’un exil) de quitter les grandes villes et les systèmes des Beaux-Arts en place (avec leurs écoles, leurs ateliers, leurs académies, leurs commandes et leurs salons) pour travailler dans de petits village tels que Barbizon en France ou, à la fin du siècle, Worpswede en Allemagne. Pour la plupart, ce sont des peintres de paysage, le paysage n’étant pas pris comme un motif par les uns et les autres mais plutôt comme le cadre d’un “retour à la nature” qu’ils recherchent et pour les sensations que la fréquentation de la nature induit. Peindre à la campagne […] est donc pleinement à situer dans la continuité du lien intense qui s’instaure […] entre la nature et l’invention du sentiment du moi […]. [L’historien de l’art et conservateur des Musées] Vincent Pomarède dans son analyse de l’école de Barbizon appelle la décision individuelle et collective d’un tel mouvement : “un militantisme fondé sur une énergie vitaliste” ("L’École de Barbizon”, RMN Réunion des Musées Nationaux, Musée des Beaux-Arts de Lyon, Paris, 2002) (Nota : qu’on pourra pousser jusqu’à l’exemple de “Monte Verità” fondée en 1899 par Ida Hofmann et Henri Oedenkoven, espace de cures de bains d’air, de soleil et d’eau installé dans un ancien sanatorium). On notera […] que dès le milieu du siècle, les critiques ont décrit ce phénomène en mettant l’accent sur les liens d’amitié entre les artistes et sur l’émulation professionnelle qui y régnait. »
-
« […] La forêt de Fontainebleau est alors considérée comme un lieu où l’on fait ses gammes, où l’on s’exerce ; comme une école de la nature. Sous l’impulsion de ses professeurs, la première génération de peintres se rend à Fontainebleau vers 1820 pour préparer le Grand Prix de Rome du Paysage Historique créé en 1817 car la grande diversité des espèces présentes leur permet de s’exercer en vue de la redoutable épreuve dite de “l’arbre” lors de laquelle, sans modèle ni document, ils doivent reproduire une essence d’arbre donnée par le jury. C’est le début de la fréquentation de la forêt per des artistes qui, dans les générations qui suivirent, y firent des séjours de plus en plus longs et finirent pour certains par décider d’y vivre. Dans les termes qui sont [rapportés] par “L’Illustration”, le mot d'école […] désign[e] au milieu du siècle non seulement le lieu géographique et pédagogique qu’est la forêt pour les peintres de paysage […] mais aussi ce que Vincent Pomarède appelle avec une grande pertinence “une communauté de pensées et de combats collectifs” (note : l’histoire de l’art retiendra plutôt une communauté de style, parfois de pensée, moins de combats, comme le montre le terme construit “a posteriori” “École de Barbizon” par David Croal Thompson dans son ouvrage “The Barbizon School of Painters") (1890). »
-
« Le mode de vie rurale choisi par certains artistes, leur décision de vivre dans de petits hameaux austères et beaucoup moins pittoresques qu’on se plaît à dire, leur profond intérêt pour des métiers dont ils comprennent qu’ils sont sans doute voués à disparaître, tout ceci indique que les artistes s’engagent autrement que sur un plan stylistique dans une relation intense avec la nature qui s’appuie sur une contestation lucide des traits de la modernité industrielle et urbaine. […] Réduire, ainsi qu’on le fait couramment, le choix de travailler dans la forêt de Fontainebleau à des raisons esthétiques ou, plus prosaïquement, purement économiques, empêche de bien comprendre comment l’un des premiers regroupements d’artistes français, s’il n’en résulta pas d’œuvres réalisées collectivement, s’appuya, pour les plus lucides des peintres, sur une critique des effets du “progrès” qui trouve alors des formulations variées et nombreuses. Les peintres de Fontainebleau sont résolument méfiants à l’encontre de la modernité urbaine, et, de manière paradoxale, ouvrent la modernité artistique par une critique de la modernité industrielle, politique et sociale. »
-
« L’histoire de la modernité artistique a donné peu de place à ces pratiques singulières du XIXième siècle des villages de peintres à la recherche d’un mode de vie non transformé par l’industrialisation et l’urbanisation en cours, sauf en leur reconnaisant une part dans l’invention du “pleinairisme”. Se développe alors ce qui fut désigné du nom de “colonie”, en tant que forme typique des regroupements d’artistes à la fin du XIXième siècle jusqu’à la première guerre mondiale environ (référence : 1/ Nina Lübbren, “Rural Artists' Colonies in Europe, 1870-1910”, Manchester University Press, 2001 [1] ; 2/ “Arts in Rural Areas”, IETM publication, Creative Europe programme, 2020). Leur expansion, pourtant, est significative puisqu’on en compte au moins une quarantaine en Europe vers 1880 composées d’artistes […] de nationalités différentes, y compris nord-américaines, comme en témoignent par les exemples les colonies d’artiste en Bretagne qui virent se côtoyer Américains et Français durant de nombreuses années. »
-
« C’est ainsi, d’ailleurs, que l’on peut comprendre ce terme, quelque peu étrange à nos oreilles d’aujourd’hui, de “colonie”, qui renvoie en effet à une pratique exogène au monde de l’art, celle, elle-même typique du XIXième siècle, de la colonisation, de la fondation de colonies par des émigrants quittant volontairement leur pays pour s’installer en terre étrangère. On pourrait trouver abusif l’emploi de ce terme, sauf à faire remarquer que la colonie d’artistes emprunte à son modèle politique le départ volontaire de ses membres et la venue en terre “étrangère”, soit que des citations s’installent à la campagne, soit que des artistes fréquentent des colonies hors de leurs frontières propres. Leurs objectifs, en revanche, diffèrent du modèle politique alors en pleine expansion : il n’est fort heureusement nullement question, à Honfleur, Pont-Aven, au Pouldu ou à Concarneau, à Grez sur Loing ou à Barbizon, à Worpswede, en Allemagne, mais aussi dans les colonies qui se créent en Écosse, Hongrie, Russie ou Pays-Basn d’occuper pour se les approprier un village et un arrière-pays que les artistes ont choisis en espérant vivre en bonne intelligence avec la population locale, qui, bien souvent, les accueille volontiers et les aides par le crédit qu’aubergistes ou hôteliers n’hésitent pas à faire à ces artistes souvent impécunieux. »
-
(Nota : Nous pourrions tester d’autres termes que celui de “colonie” pour distinguer ces regroupements qui vont opérer et s’intaller dans d’autres contextes que ceux prescrits par le champ de l’art : des “phalanstères” ? même si ce terme aussi recouvre des aspects pas trop appropriés… ou encore : trajectoires et lieux d’exode, thébaïde, refuge, gîte, asile, terrier, havre, vagabondage, “hedge-schools”,… La chose est à creuser, le vocabulaire ne manque pas… La Pébipologie de son côté parle de “sanatorium” [1]…) (Marielle Macé à ce propos évoque : « le sanatorium de “La Montagne magique” (Thomas Mann, 1924), le labyrinthe du “Satyricon” (Pétrone), la tentative de “Construire un feu” chez Jack London (1902), l’île de “Robinson Crusoe” (Daniel Defoe, 1719), » etc. à la suite de ce que décrit Roland Barthes par des “formes subtiles de genres de vie” dans son cours “Comment vivre ensemble” (Cours et séminaires au Collège de France (1976-1977), [extraits]).)
.
.
6f
Aspects et caractères des colonies d’artistes
(Ibid. : selon le livre de Véronique Goudinoux, “Œuvrer à plusieurs: Regroupements et collaborations entre artistes”, collection Esthétique et sciences des arts, Presses Universitaires du Septentrion, Université de Lille, 2015)
« La colonie d’artistes est sous-tendue par un mode d’organisation d’ordre collectif : même si les artistes continuent, la plupart du temps, de produire des œuvres en solo, même si, souvent, ils louent des logements particuliers et s’installent en famille, le contact recherché avec d’autres artistes, la discussion entre pairs et le travail sur le motif à plusieurs, l’organisation de fêtes ou d’événements singuliers, montrent que sont aussi souhaitées des formes variées de mise en commun et de sociabilité allant jusqu’à l’aide économique ponctuelle. Si les uns et les autres quittent villes et ateliers citadins pour ce nouvel atelier commun qu’est la nature, seule capable, mieux que tout autre maître, de leur donner l’impulsion qu’ils attendent, on aurait tort, comme l’effectuent si souvent les études des colonies d’artistes, de les réduire à d’agréables regroupements de peintres bohèmes n’ayant d’autre ambition que de pouvoir peindre hors de toute contrainte académique. D’autres données peuvent avoir suscité ce que Franck Claustrat (écouter la conférence), auteur d’une intéressante synthèse sur la question désigne comme un véritable “phénomène de délocalisation de la production artistique au XIXième siècle”. L’exemple des préoccupations singulières de Théodore Rousseau et de Jean-François Millet l’aura montré : la recherche d’une vie simple à la campagne et la production d’œuvres en résonance intense avec cette même campagne s’accompagnent dans ce cas précis d’une réflexion d’ordre elle-même sociale et politique : il n’est pas hasardeux par exemple que Courbet, aux convictions politiques décidées, proche de Proudhon, ait lui-même effectué des séjours dans des colonies d’artistes. »
.
“Colonies d’artistes et modernité 1848-1914”, par Frank Claustrat, maître de conférences en histoire de l’art contemporain, université Paul-Valéry, Montpellier 3, ven. 27 mai 2011, Musée d’Orsay. (Source)
.
« Par ailleurs, trois traits, généralement peu soulignés, caractérisent, ces colonies d’artistes [et ces micro-scènes artistiques].
-
Le premier est leur caractère pluridisciplinaire. Là où on pense bien souvent qu’elles ne sont le fait que de peintres, nombre de ces colonies, notamment celles de la Forêt de Fontainebleau, où se rendent fréquemment les frères Goncourt ou Robert Louis Stevenson, sont le lieu de rendez-vous entre artistes, écrivains et musiciens qui partagent non seulement un goût profond pour la nature mais également des idées et des convictions.
-
Le second est l’égalitarisme qui parfois y préside, en particulier entre hommes et femmes, ces dernières ayant elles aussi choisi de fréquenter des colonies d’artistes quand les portes de l’Académie des Beaux-Arts sont encore fermées.
-
Le dernier, peu étudié, est l’internationalisme de ces colonies, qui, selon Franck Claustrat, repose sur un modèle précis, celui qui fait circuler les artistes entre les colonies, qu’il décrit comme des pôles périphériques, et les villes, centres principaux de l’activité artistique, dans un moment défini par l’ouverture et l’internationalisation de la sphère culturelle, en particulier grâce aux expositions universelles (références : Franck Claustrat, “Villes / centres / périphéries / rivalités”, in “Conditions de l’œuvre d’art de la Révolution française à nos jours”, Université de Paris 1, 2001, pp. 238-242). »
« Avec une grande pertinence, Claustrat fait remarquer que cette internationalisation, à partir de 1900, prend à Paris en particulier une autre forme, puisque c’est dorénavant dans la capitale que se créent des colonies d’artistes, devenues quant à elles davantage sédentaires. Au XIXième siècle, les colonies rurales ne sont que rarement des lieux de résidence fixe. Ce qui les qualifie, bien au contraire, est d’une part le caractère temporaire (saisonnier) des séjours qu’on y effectue, d’autre par le fait que les artistes circulent abondamment de l’une à l’autre en Europe, créant ainsi une oscillation typique de la géographie du siècle entre pôles périphériques fluctuants et centres artistiques forts, mais aussi ce que Franck Claustrat, à juste titre, décrit comme une sorte de vagabondage à grande échelle d’une partie de la population artistique d’où émerge une figure d’artiste entre nomade et voyageur, héritière de l’artiste voyageur de l’Ancien régime, mais dont le voyage, pour certains, excédera largement le temps de formation qui lui était alors dévolu. »
-
(Autres références : Véronique Goudinoux, “mayonnaise - (H)all over 17 – Archipel #2 : deux expositions ‘laboratoire’ des pratiques collaboratives contemporaines”, Centre d’arts plastiques et visuels de Lille, du 9 juin au 7 septembre 2019 ; Claire Bishop, “The Ethical Turn”, “The Social Turn: Collaboration and Its Discontents,” Artforum, February 2006, 178–83) ; Claire Bishop, “Le Tournant éthique”, [1] [2 Participa(c)tion MAC/VAL, 2014] ; Céline Poulin, Marie Preston, “Co-Création”, Les Presses du Réel, 2019)
-
« Comment, donc, éviter le piège de la confiscation des voix singulières par la production d’un récit unificateur (et par là-même séducteur) sur une expérience pourtant plurielle ? S’il est facile d’énoncer cette difficulté, la résoudre n’est pas chose aisée. Les pratiques à plusieurs se sont particulièrement développées depuis [le début des années 2000] et ont justement suscité nombre d’interrogations quant à leur traitement critique (voir l’ouvrage “Co-création”, Brétigny, CAC / Editions Empire, 2019 (sous la direction de Céline Poulin et Marie Preston)). Certaines de ces pratiques ont été envisagées sous le régime de ce que la critique Claire Bishop a appelé “The Ethical Turn”. Dans un article éponyme, cette dernière s’interroge par exemple sur l’objectif que Reinaldo Laggada donne à ces pratiques participatives, qui n’est « pas simplement d’offrir une expérience intellectuelle et esthétique à un public extérieur mais de faciliter la création d’une communauté temporaire engagée dans le processus d’une série de résolutions de problèmes pratiques » (Reinaldo Laggada cité par Claire Bishop, « “Le tournant éthique” », dans “Participa(c)tion”, Vitry-sur-Seine, MAC/VAL, Musée d’art contemporain du Val-de-Marne, 2014, pp. 54). En d’autres termes, c’est la composante « sociale » de ces projets qui est retenue ici, ou, plus exactement, et comme l’observe Claire Bishop, ce sont des critères relevant de l’éthique, et non plus de l’esthétique, qui sont choisis pour qualifier et apprécier ces pièces. D’autres commentateurs désignent ces pratiques comme relevant d’un registre désigné comme « politique » [et en complément d’un levier « économique » : “Dans le cadre de ce type de projet collaboratif, comment adapter l’économie générale du projet au nombre des artistes, dont le travail, [dans ces organisations], relève d’une forme de bénévolat ? Cette question est au croisement de deux autres : celle, plus large, du financement du travail des artistes, non réglée aujourd’hui et, tout autant, celle des conditions de travail des artistes œuvrant dans le cadre de projets collaboratifs”]. Ainsi par exemple pourra-t-on relever dans de nombreux articles un intérêt très marqué pour les diverses formes de renforcement de la capacité d’agir des acteur.e.s qui participent à ce type de projet (voir l’usage dans de nombreux textes du terme anglo-saxon d’“empowerment”, qui lui-même a suscité une abondante littérature critique). […] Œuvrer à plusieurs permet d’une part de déplacer des pratiques, des manières de créer, d’ouvrir à des possibles ; d’autre part que puissent s’élaborer, se dire, se montrer, d’une manière parfois elliptique ou discrète, quelque chose de soi, fragile ou privé, un sujet en acte, en devenir, quelque chose qui serait protégé, d’une certaine manière, par le « collectif » éphémère qui s’est ainsi créé – mais aussi, parfois, mis en danger par ce même collectif. »
‒ (Véronique Goudinoux, “mayonnaise - (H)all over 17 – Archipel #2 : deux expositions ‘laboratoire’ des pratiques collaboratives contemporaines”, Centre d’arts plastiques et visuels de Lille, du 9 juin au 7 septembre 2019) (Voir aussi : https://ilcea4.univ-grenoble-alpes.fr/sites/ilcea4/files/Mediatheque/2021/a5_colloque_arts_visuels_2021.pdf ; et aussi : https://www.peren-revues.fr/demeter/273 ; et : https://pro.univ-lille.fr/veronique-goudinoux/publications ; complété par : https://ceac.univ-lille.fr/axes-et-programmes/programmes/oeuvrer-a-plusieurs-recherches-sur-les-collaborations-entre-artistes ; et : “Rite, jeu et fête. Pierre Huyghe et Jeremy Deller” (2018) )
.
Références “colonies d’artistes :
‒ https://masmoulin.blog/2021/11/20/colonies-dartistes-artists-colonies-generalites-peinture-sur-le-motif-plainairisme-paysage-billet-n-1/
‒ https://fr.wikipedia.org/wiki/Colonie_artistique_d%27%C3%89taples ‒ https://fr.wikipedia.org/wiki/Colonie_artistique_de_Stone_City
‒ https://fr.wikipedia.org/wiki/Colonie_artistique_d%27Old_Lyme
‒ https://artistes-grezsurloing.fr/les-colonies
‒ https://presqu-ile-de-crozon.com/camaret-sur-mer/artistes-001.php
‒ https://visitmuseum.gencat.cat/fr/museu-d-art-de-cerdanyola/domaine/la-colonia-noucentista
‒ https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/raoul-brothier-de-rolliere-decede-oublie-en-fevrier-1917
‒ https://masmoulin.blog/2023/01/26/colonie-dartistes-en-floride-st-augustine-billet-n155/
‒ https://fr.wikipedia.org/wiki/Artel_des_artistes
‒ https://patrimoinemondialallemagne.com/mathildenhoehe/
‒ https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/c4r6BAy (La Ruche, colonie d’artistes dans le 18ème arrondissement, Paris)
‒ https://www.guggenheim-bilbao.eus/fr/exposition/colonies-et-collectifs-dartistes-worpswede-et-die-brucke-expressionnisme-et-surrealisme-salle-307
‒ https://booksenstock.forumactif.com/t182-worpswede-la-colonie-des-artistes
‒ https://masmoulin.blog/2022/03/22/colonie-dartistes-en-allemagne-worpswede-billet-n-55/
‒ https://books.openedition.org/psorbonne/435 ‒ (Lʼarrière-garde de lʼavant-garde : la colonie artistique polonaise à paris 1905-1914)
‒ Véronique Denolf, « Regards sur la colonie artistique d’Étaples. 2. Walter Gay, Novembre, Étaples, ca. 1885 », Chronica Stapulensis, mis en ligne le 11 août 2022, https://chronista.hypotheses.org/10904
.

(Un artiste peignant un paysage. Photographie en noir et blanc, Stone City, Iowa, 1932).
.
.
6g
Les peintres de Barbizon, Théodore Rousseau
La forêt de Fontainebleau est présentée par Théodore Rousseau (1812-1867), un jeune peintre passionné de paysages avec un activisme prémonitoire des combats de notre siècle et l’un des premiers artistes à s’établir sur place, comme un véritable musée à ciel ouvert, avec ses arbres comme équivalent aux « modèles qui nous ont été laissés par Michelange, Raphaël, Corrège, Rembrandt et tous les grands maitres des temps passés » et rompant avec la tradition du paysage historique jusque-là réalisé en atelier. Il sera suivi par beaucoup d’autres artistes-peintres : Camille Corot, Jules Dupré, Charles Le Roux puis Jean-François Millet, etc. En abandonnant l’idéalisation au profit de la sensation, Rousseau et ses compagnons ont certainement influencé en profondeur le futur groupe des Impressionnistes. En opposant une résistance à la mise en lambeaux des forêts françaises, les peintres de Barbizon se sont placés comme écologistes influents avant l’heure.
En 1836, comme la plupart des peintres se reconnaissant à Barbizon sont des exclus ou des rejetés du Salon. Le jeune Théodore Rousseau voit son dernier tableau refusé par le jury du Salon, alors qu’il s’y était déjà fait remarqué au Salon de 1831, et y avait reçu une médaille en 1834, avant d’y être refusé entre 1836 et 1841. Le jury conservateur du Salon n’a que mépris pour ses arbres et ses prés. En 1836, âgé de 24 ans, il s’exile dans le petit hameau de Barbizon, à l’orée de la forêt de Fontainebleau. (Source1) (Source2)
Et au même moment, Achille Marrier de Bois d’Hyver, inspecteur de l’Administration générale des forêts de son état [1), a pour mission de rénover les forêts françaises selon les normes imposées par la jeune Ecole nationale des eaux et forêts de Nancy (créée en 1824) : “détruire les vieilles futaies, abattre les arbres trop vieux et combler les landes en y plantant des résineux” [1] [2]. La révolution industrielle fume à plein régime et le bois d’œuvre ne doit pas manquer. En 1830, alors que les villes s’agrandissent, se drapent de pollution, les routes commencent à strier les forêts et les usines à assécher les rivières, la bourgeoisie entre dans une ère de toute puissance. L’apparition du mouvement du paysage dans la peinture française à cette époque constitue un phénomène d’une puissance encore insoupçonnée, trouvant des sources d’inspiration infinies dans la peinture paysagiste hollandaise du XVIIème siècle et du paysage anglais contemporain. Au nom de ce musée vert, les peintres de Barbizon vont entrer en résistance pour sauver ces derniers oasis de futaie naturelle. (Source)
Protéger la forêt est entendu par “protection” sans correspondre à ce que l’État commence d’entreprendre pour conserver ses biens (artistiques ou “naturels”). Toutefois il y a sur ce point, un degré de radicalisation qui peut différer, entre “ouvrir” et “fermer”. La protection de la forêt que demande Théodore Rousseau s’effectue au nom de la préservation de la grandeur d’un lieu, et entraîne la restriction de son usage, l’argument recevable, étant que sa fréquentation par une population insoucieuse de sa beauté et de sa grandeur pourrait irrémédiablement l’abîmer. Protéger la forêt est donc, aussi, la protéger du public : la fermer, si possible, à ce public qui, par son nombre et l’ignorance dans laquelle il se trouve de sa fragilité, pourrait la détruire. Théodore Rousseau refuse ainsi, sur un plan politique, le grand mouvement de démocratisation auquel appellent les écrivains romantiques qui lui sont contemporains (qui de leur côté, opposent le symbole royaliste du domaine de la chasse à celui de la démocratisation).
(Source)
.
.
7
Site à destination artistique
.
7a
Comité de protection artistique
À Paris, les campagnes de presse que Théodore Rousseau, devenu en quelque sorte lobbyiste, inspire se succèdent à partir de 1839. Sur le terrain, il reçoit le renfort de dizaines de jeunes rapins (= peintres apprentis) qui s’exercent aux « portraits d’arbres » et se transforment en “éco-guerriers” pour décapiter les jeunes plans de pins sylvestres préconisés dans la missions de Marrier de Bois d’Hyver. Et si les vieux arbres de Fontainebleau ont été sauvés, c’est en grande partie grâce à la vogue des « intérieurs de forêt » qui, ces années-là, s’exposent par dizaines au Salon et que les amateurs se disputent poussés par le soutien de critiques influents.
(Source)
.
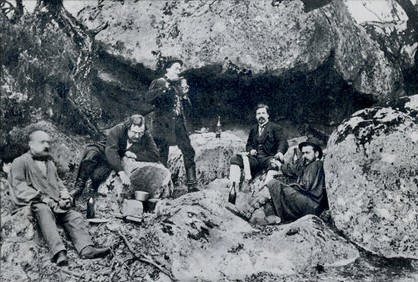
Peintres à Barbizon.
.
En 1839, sous la monarchie de Juillet, dans “L’Artiste”, le critique littéraire Jules Janin supplie l’intendant général de la liste civile Camille de Montalivet « d’arrêter la tendance anti-artiste des agents placés sous ses ordres à Fontainebleau » afin de « conserver à la France, et même à l’Europe, un monument naturel qui n’a pas d’égal ».
(Source)
.
En 1853, 624 hectares de bois sont exemptés des coupes règlementaires.
Cette grande première sera officialisée et étendue par le décret impérial du 13 août 1861 : 542 hectares de vieilles futaies et 555 hectares de rochers « à destination artistique » se voient « soustraits à tout aménagement ».
Une politique qui s’inscrit dans la droite ligne des « monuments historiques » créés en 1830 pour sauver le patrimoine architectural (et dont le second « inspecteur général » fut l’écrivain Prosper Mérimée, un autre amant de George Sand !). La « réserve artistique » de Fontainebleau devient ainsi le premier parc naturel au monde, et comme nous l’avons remarqué, bien avant celui de Yellowstone, aux États-Unis (1872) et avant le “Yosemite Grant Act” signé par le président Lincoln le 30 juin 1864. Étant l’une des plus anciennes parmi les lois modernes de protection de la nature (le premier espace protégé en Allemagne est le Drachenfels en 1836, le Parc National de Yellowstone, donc, en 1872, les lois de protection spécifique du chamois et de la marmotte dans les montagnes polonaises Tatras en 1869), elle aurait pu servir de modèle.
.
Le 7 octobre 1872, par une pétition adressée à la presse, un Comité de protection artistique de la forêt de Fontainebleau [2] est créé (autorisé par un arrêté du 21 mai 1873 et constitué d’artistes peintres, d’écrivains, de professionnels du tourisme et de simples promeneurs [1]) suite aux coupes jugées abusives et causées par la crise économique après la guerre franco-prussienne perdue de 1870 (et de la chute du Second Empire et la mise en place de la Troisième République). Leur première assemblée générale annuelle a lieu le 1er mai 1876, date de l’ouverture du Salon, ce qui confirme la forte connotation artistique de ce Comité [1]. Le Comité poursuit trois objectifs allant tous dans un sens conservatoire car c’est l’objet de sa création :
- « Que la forêt de Fontainebleau doit être assimilée aux monuments nationaux et historiques qu’il est indispensable à tout prix de conserver à l’admiration des artistes et des touristes ; et que sa division actuelle, en parties artistique et non artistique, ne doit être acceptée que sous toutes réserves. »
Ce comité est donc l’ancêtre de toutes les associations de sauvegarde de la forêt. Parmi les premiers succès de ce mouvement de la protection, signalons l’abandon en 1904 du projet de voie ferrée Melun-Bourron suite à la pétition des Artistes français au Ministre des Travaux Publics contre un projet de voie ferrée susceptible de traverser la forêt de Fontainebleau. Remarquons aussi qu’ils furent les premiers dans toute l’histoire de l’écologie à défendre et protéger le bois mort. Aujourd’hui, son important rôle écologique est une évidence. Pourtant à l’époque le bois mort était considéré comme une nuisance à l’économie forestière (voir aussi : Karl Marx, “Débats sur la loi relative au vol de bois”, 1842).
(Source1)
(Source2 : Piotr Daszkiewicz, SPN, Muséum national D’Histoire naturelle, “La protection de la forêt de Fontainebleau et son contexte historique - de la création des séries artistiques au Premier Congrés International pour la protection de la nature”, conférence donnée le 24 mars 2013)
.
.
7b
Les soutiens de Victor Hugo et George Sand
Victor Hugo y adhère par ces mots :
- « Il faut absolument sauver la Forêt de Fontainebleau. Dans une telle création de la nature, le bûcheron est un vandale. Un arbre est un édifice : une forêt est une cité ; et entre toutes les forêts, la Forêt de Fontainebleau est un monument. Ce que les siècles ont construit, les hommes ne doivent pas le détruire. »
Le 13 novembre 1872, George Sand fait paraitre dans le journal “Le Temps” un texte capital, « La forêt de Fontainebleau » (version pdf ; version BNF ; podcast France Culture ; commentaire France Culture), un des premiers textes écologistes parus en France appuyant la création du Comité de protection artistique de la Forêt de Fontainebleau (Source1).
Citons-là :
- « Le domaine de l’homme devient trop étroit pour ses agglomérations. Il faut qu’il l’étende, il faut que des populations émigrent et cherchent le désert. Tout va encore par ce moyen, la planète est encore assez vaste et assez riche pour le nombre de ses habitants ; mais il y a un grand péril en la demeure, c’est que les appétits de l’homme sont devenus des besoins impérieux que rien n’enchaîne, et que si ces besoins besoins ne s’imposent pas, dans un temps donné, une certaine limite, il n’y aura plus de proportion entre la demande de l’homme et la production de la planète. Qui sait si les sociétés disparues, envahies par le désert, qui sait si notre satellite que l’on dit vide d’habitants et privé d’atmosphère, n’ont pas péri par l’imprévoyance des générations et l’épuisement des forces trop surexcitées de la nature ambiante ? […] Quand la terre sera dévastée et mutilée, nos productions et nos idées seront à l’avenant des choses pauvres et laides qui frapperont nos yeux à toute heure. Les idées rétrécies réagissent sur les sentiments qui s’appauvrissent et se faussent. L’homme a besoin de l’Eden pour horizon. Je sais bien que beaucoup disent : « Après nous la fin du monde !». C’est le plus hideux et le plus funeste blasphème que l’homme puisse proférer. C’est la formule de sa démission d’homme, car c’est la rupture du lien qui unit les générations et qui les rend solidaires les unes des autres. »
(George Sand, “La forêt de Fontainebleau”, chap.XX, in “Impressions et souvenirs”, Paris, Michel Levy frères, 1873)
Et encore :
- « La rage de la possession individuelle doit avoir certaines limites que la nature a tracées. Arrivera-t-on à prétendre que l’atmosphère doit être partagée, vendue, accaparée par ceux qui auront le moyen de l’acheter ? Si cela pouvait se faire, voyez-vous d’ici chaque propriétaire balayant son coin de ciel, entassant les nuages chez son voisin, ou, selon son goût, les parquant chez lui […] ? »
- « La forêt de Fontainebleau n’est pas seulement belle par sa végétation ; le terrain y a des mouvements d’une grâce ou d’une élégance extrêmes. Ses entassements de roches offrent à chaque pas un décor magnifique, austère ou délicieux. Mais ces ravissantes clairières, ces chaos surprenants, ces sables mélancoliques deviendraient navrants, peut-être vulgaires s’ils étaient dénudés. Les sciences naturelles aussi ont le droit de protester contre la destruction des plantes basses que ferait bientôt disparaître le dessèchement de l’atmosphère avec 1a chute des grands végétaux. Le botaniste et l’entomologiste sont gens sérieux qui comptent autant que les peintres et les poètes ; mais au-dessus de toute cette élite, il y a, je le répète, le genre humain qu’il ne faut pas appauvrir de nobles jouissances […] »
- « Irons-nous chercher tous nos bois de travail en Amérique? Mais la forêt vierge va vite aussi et s’épuisera à son tour. Si on n’y prend garde, l’arbre disparaîtra et la fin de la planète viendra par dessèchement sans cataclysme nécessaire, par la faute de l’homme. N’en riez pas, ceux qui ont étudié la question n’y songent pas sans épouvante. […] Encore un été comme celui de 1870 en France, et il faudra voir si l’équilibre peut se rétablir entre les exigences de la consommation et les forces productives du sol. Il y a une question qu’on n’a pas assez étudiée et qui reste très mystérieuse : c’est que la nature se lasse quand on la détourne de son travail. Elle a ses habitudes qu’elle quitte sans retour quand on les dérange trop longtemps. Elle donne alors à ses forces un autre emploi ; elle voulait bien produire de grands végétaux, elle y était portée, elle leur donnait la sève avec largesse. Condamnée à se transformer sous d’autres influences, la terre transforme ses moyens d’action. Défrichée et engraissée, elle fleurit et fructifie à la surface, mais la grande puissance qu’elle avait pour les grandes créations elle ne l’a plus et il n’est pas sûr qu’elle la retrouve quand ou la lui redemandera. »
(George Sand, ibid.)
.
.
7c
Les débats et décisions politiques : de site artistique à site touristique
Le 3 avril 1876, Louis Foucher de Careil, ancien préfet de Seine-et-Marne (1872-1873) élu sénateur du département le 30 janvier, dépose une proposition de loi visant à augmenter de 1000 hectares la réserve délimitée sous le Second Empire. Il argumente les motifs ainsi :
- « Lorsqu’en 1861, […] la commission [reconnaissait que la forêt de Fontainebleau est] « un musée d’arbres gigantesques, de sites sauvages, de souvenirs historiques » qui demande un traitement à part. […] Il faut y voir la plus précieuse collection de grands végétaux qu’il soit possible de contempler dans nos climats, et conserver, dans sa forme primitive, ce monument de la nature à notre école de paysagistes qui est célèbre dans le monde entier. […] On le voit, le principe de protection artistique de la forêt était reconnu par le décret du 13 août 1861, mais le principe seulement. […] Le sentiment de, la nature a pris, de nos jours, une importance considérable dans la vie de toutes les classes de la société, et la forêt de Fontainebleau, située à une heure de Paris par les trains rapides, peut et doit devenir pour tous une source féconde d’émotions morales et de douces jouissances. […] [Une telle considération] devrait être considérée en réalité comme une subvention permanente à l’art. Or, une telle subvention ne se justifierait-elle pas facilement, en dehors des considérations précédentes, par les motifs de la nature la plus positive ? Le produit du travail de nos peintres est une part importante de la richesse nationale. Ne serait-ce pas une grave faute économique que de les priver de cet admirable atelier naturel, situé aux portes mêmes de la capitale ? »
(Louis Foucher de Careil, argumentation de la proposition de loi, Journal officiel de la République française, 15 avril 1876, p. 2734) (Source)
.
Dans la discussion du projet (14 juin 1876), Louis Foucher de Careil reprend les arguments des artistes et rappelle que le Congrès des États-Unis n’a pas hésité à légiférer en la matière. En 1870, de retour d’un voyage outre-atlantique (1869), il avait publié dans “La Liberté” un article sur la protection des sites naturels américains et donné une traduction du “Yosemite Grant Act”. Sa proposition, restant trop caricaturale et sans considération vis-à-vis de l’action des forestiers et règles de la sylviculture (voir ci-dessous), est rejetée après avis défavorable de la première commission d’initiative parlementaire. Les artistes sont qualifiés de “grands enfants” par le Directeur Général des Forêts qui argumente sur une gestion nécessaire et un coût de la “réserve artistique” trop élevée (300.000 francs de subvention ; en comparaison l’école de Rome coûte 100,000 francs ; l’école d’Athènes, 100,000 fr. ; l’école des beaux-arts, 300,000 fr.).
Lisons ses arguments :
- « Cette forêt, elle est le domicile de nos artistes ; notre école de paysagistes, qui est la première du monde, y a établi ses colonies ; elle est entourée de leurs campements. Cette école est une de nos gloires nationales ; c’est à elle que nous devons d’occuper le premier rang dans les arts. […] Évidemment, d’une part, elle doit continuer à faire partie du domaine forestier ; j’ai dit moi-même, dans le sein de la commission, les mobiles qui me faisaient agir, en exposant que nous ne prétendions à aucune ingérence, à aucune immixtion dans le domaine forestier. Mais à côté de cet intérêt bien petit pour le Trésor, comme vous le verrez, nous réclamions une protection dans l’intérêt de l’art et de cette école de paysagistes qui, je le répète, est une de nos gloires. […] Que redoutons-nous donc pour la forêt de Fontainebleau ? Des dangers qui ne sont que trop réels |…] [:] qu’une coupe extraordinaire allait faire tomber treize mille des plus beaux chênes, c’est-à-dire des arbres plus que centenaires ! Les plus belles futaies allaient être attaquées. […] Je vous ai prouvé que, sous le régime des décrets, les réserves étaient quelque peu fictives ; que l’administration restait absolument maîtresse d’en disposer comme elle l’entendait, et que, par conséquent, les artistes se plaignaient de ne pas avoir de garanties suffisantes. […] [J]e rappellerai ce que j’ai vu en Amérique. J’y ai vu le sénat et le congrès des États-Unis ne pas trouver au-dessous de leur dignité le soin de classer les grands parcs naturels du Colorado, dont on venait de faire la découverte, certaines vallées merveilleuses dans le sein de la Nevada, — ces montagnes qui produisent l’or et l’argent, et dont nous parlait tout à l’heure M. le ministre des finances, — et, enfin, les beaux geysers de l’Idaho et du Montana. […] Le sénat américain ne craint pas de déclarer, en classant ces grands parcs du Colorado, qu’il entend « les réserver et les affecter à toujours aux délices du peuple américain ; que personne ne pourra en devenir propriétaire, et qu’ils resteront à la disposition même de la nation. » Eh bien, vous le voyez, c’est par des lois que le sénat américain croit devoir classer ces beautés naturelles qu’on découvre chaque jour dans le Far-West. Qu’y aurait-il donc d’étonnant à ce qu’il en fût de même en France ? […] Il y a certainement là un grand intérêt de moralité. Mon Dieu ! on m’a dit que nous mettions en avant des raisons de sentiment. Sans doute, le sentiment de la nature a fait de grands progrès à notre époque, et c’est un élément de moralité pour les masses. […] On nous parle du budget de la forêt de Fontainebleau ! Savez-vous ce que produit notre école de paysagistes par année ? Une somme de plusieurs millions. Ses tableaux sont exportés, nous dit-on, dans toutes les parties du monde. Eh bien, tant mieux ! C’est là une source de revenus, et je doute fort que le directeur des forêts puisse établir que la forêt de Fontainebleau est capable de lutter, sous le rapport économique, avec notre école de paysagistes français. »
(Louis Foucher de Careil, discussion à propos de l’aménagement de la forêt de Fontainebleau, Journal officiel de la République française, 15 juin 1876, p. 4184) (Source)
.
Le 16 décembre 1876, le député de Seine-et-Marne Horace de Choiseul prie la Chambre « de juger entre l’école de Fontainebleau et l’administration des forêts » afin de « ramener le calme entre ces deux puissances de la forêt de Fontainebleau ». Ses arguments sont posés :
- « Cette réunion de grands artistes se plaint que l’administration des forêts, dans un intérêt, excellent certainement au point de vue forestier, veuille convertir la forêt de Fontainebleau en une vaste sapinière ; elle peut prévoir que d’ici à quelques années tous les sites qui n’ont pas été compris dans les réserves artistiques, les sites les plus intéressants, verront remplacer leur végétation actuelle, d’un aspect si artistique, par de monotones sapins. Ils craignent, si vous ne venez pas aujourd’hui exprimer votre sentiment sur cette question, que l’administration des forêts, continuant à faire ce qu’elle appelle son devoir, ne soit la cause d’une véritable ruine pour les arts. Enfin, messieurs, si l’école de Fontainebleau s’est émue pour l’avenir, c’est qu’en 1872, il n’y a pas longtemps comme vous le voyez, dans une même année, l’administration des forêts fit couper 13,200 chênes de 140 à 300 ans, c’est que l’administration des forêts, cette même année, fit encore couper 4,800 hêtres de 90 à 200 ans, et elle redoute que ce qu’on a appelé, à cette époque, un acte de vandalisme ne se reproduise dans la suite. M. le directeur général des forêts prétend, quant à lui, qu’il est plein de soins pour l’avenir des beaux-arts, et permettez-moi de vous répéter son dire. « Les artistes, dit-il, sont de grands enfants ; les artistes ne calculent pas, ils ne songent pas qu’à un moment donné ces richesses de la nature vont périr et que rien ne les remplacerait si nous, administration, nous ne veillions pas pour les beaux-arts. Aussi, nous nous occupons de l’avenir, nous plaçons là où il le faut des sapins qui viendront amender le sol et permettre à la végétation de se développer. » Ainsi parle M. le directeur général des forêts. L’école de Fontainebleau remercie beaucoup l’administration de ses soins, mais elle n’a pas la même manière de penser sur ce sujet que M. le directeur général des forêts. Et c’est à vous, messieurs, de décider entre eux. Aujourd’hui, ajoute l’école de Fontainebleau, toutes les magnifiques futaies qui ont inspiré Corot, Rousseau et tant d’autres illustrations, ce ne sont pas les prédécesseurs de M. le directeur des forêts qui en assuraient la croissance, c’est la nature qui nous les a données, c’est à la nature seule et non aux hommes que nous demandons d’assurer l’avenir des beaux-arts. Pour arriver à ramener le calme entre ces deux puissances de la forêt de Fontainebleau, nous vous demandons de faire la part des beaux-arts et celle de de M. le directeur général des forêts. Le décret d’août 1861 a donné 1,100 hectares ; nous venons vous demander d’y ajouter 500 hectares que vos prédécesseurs avaient accordés aux tirés de la couronne. […] Quant à la demande si considérable que nous faisons, en quoi consiste-t-elle ? […] ce que nous recherchons, ce sont des sites pittoresques ; des rochers couverts de fougères et certaines futaies où la hache de l’administration des forêts ne saurait avoir la prétention de s’abattre sans commettre de nouveaux actes de vandalisme. […] [O]n appelle donner 300,000 fr. à l’école de Fontainebleau le revenu du vieux matériel de la forêt de Fontainebleau. Le vieux matériel, ce sont les vieux arbres plusieurs fois séculaires de la forêt. Par imagination, on les a abattus, puis débités en bûches, rangés en stères de bois, et on calcule que si on les vendait on en retirerait 6 millions. Par conséquent, dit-on, nous donnons 300,000 fr. par an à l’école de Fontainebleau. […] Ne serait-ce pas aussi impossible, aussi coupable, que si vous vouliez fondre les statues de nos musées pour en vendre le bronze ? Il est des choses qui, dès qu’elles sont entrées dans le domaine des arts, n’appartiennent plus à la génération vivante, et cette génération est tenue de les respecter. […] »
- [Intervention de M. le commissaire du Gouvernement :] « La forêt de Fontainebleau a couru un bien autre danger que celui dont on vous a parlé. Le ministère de la guerre a demandé d’établir à travers la forêt un polygone d’artillerie, — et vous savez quel est le développement d’un polygone ; — il a demandé, dis-je, l’établissement d’un polygone qui devait traverser tous les massifs de la série artistique. Par l’intervention de qui ce danger a-t-il été écarté ? Par l’intervention de l’administration des forêts, qui, aussi soucieuse des intérêts artistiques que de l’intérêt des forêts de l’État, a demandé au ministre de la guerre de concilier l’intérêt supérieur de la défense nationale avec les intérêts de l’art. Le polygone existe, et la forêt n’a pas été atteinte. Le comité artistique est-il venu nous aider pendant la bataille ? […] »
- [Nouvelle intervention de M. Horace de Choiseul :] « Tout ce que nous désirons, c’est que ce soit la nature elle-même qui se charge du soin de préparer l’avenir. Nous n’avons pas, — et c’est sans doute notre tort, — la même manière de comprendre l’art que M. le directeur général des forêts. Nous ne cherchons pas le baliveau qui file bien, l’allée qui est bien élaguée ; nous demandons, au contraire, la nature laissée à elle-même, les endroits, en un mot, et les sites où la main de l’homme n’a pas pénétré. […] En se plaçant, maintenant, comme on a voulu le faire, au point de vue économique spécial et purement financier, il serait bien difficile d’établir que nos magnifiques futaies coupées en bûches et vendues puissent rapporter davantage que tous les tableaux qui ont été inspirés par ces magnifiques futaies. […] La querelle qui subsiste depuis longtemps, c’est que le domaine des forêts ne veut donner aux artistes que ce que le domaine des forêts veut donner, tandis que l’école de Fontainebleau veut pouvoir faire son choix. […] Ce que nous voulons demander, c’est précisément ce qui n’est pas aujourd’hui en exploitation : ce sont des rochers et des terrains couverts de fougères, ce sont quelques massifs de vieilles futaies. Là nous limitons nos prétentions, et nous ne demandons pas les taillis qui sont aujourd’hui en exploitation, il ne faut pas qu’il y ait méprise à cet égard. […] Ce que nous demandons, nous, c’est que l’on donne à l’école de Fontainebleau un terrain où elle soit chez elle et à l’abri de toutes les coupes de l’administration […]. »
(Discussion à propos de l’amendement mis au vote par Mr Horace de Choiseul, Journal officiel de la République française, 17 décembre 1876, pp. 9425-9426) (Source)
L’amendement proposé par de Choiseul est rejeté à la demande du directeur général des forêts, commissaire du Gouvernement. (Source)
.
En 1907 est créée “la société des amis de la forêt de la Fontainebleau” sous l’impulsion d’artistes peintres, de notables et d’intellectuels possédants des propriétés dans la région de Fontainebleau. En 1913, des scientifiques et des naturalistes amateurs fondent l’association des naturalistes de la vallée du Loing (ANVL) dont l’objectif principal est de développer et de diffuser le savoir naturaliste sur la région de Fontainebleau. L’association organise plusieurs excursions en forêt de Fontainebleau et dans la vallée de Loing et diffuse un bulletin présentant les derniers travaux scientifiques. Contrairement au “Comité de protection artistique de la forêt de Fontainebleau”, lancé en 1873, la “société des amis de la forêt de Fontainebleau” s’investi activement dans l’entretien de la forêt (voir ci-dessous, chapitre 7d, paragraphe sur Émile Sinturel (période de 1913 à 1920 et au-delà). En 1911, la société crée une section de « secouristes » pour aider les gardes des Eaux-et-Forêts à la surveillance et à la lutter contre les incendies. À cette époque, les forestières considèrent les incendies comme le fléau majeur de la forêt de Fontainebleau. La lutte contre les incendies fait consensus.
.
(Extraits de la Thèse de Rémi Salaün, “L’héritage touristique. Trajectoire d’un lieu périurbain : trajectoire d’un lieu périurbain : la forêt de Fontainebleau”, 2017 [1])
Après-guerre, les artistes sont moins nombreux à venir en villégiature à Fontainebleau, préférant des destinations plus lointaines comme la Côte d’Azur. Néanmoins, la forêt reste un lieu d’excursions privilégié des parisiens lors des fins de semaine. En 1969 et 1999, des estimations affichent une hausse importante de la fréquentation annuelle de la forêt de Fontainebleau. Dans le même temps, l’ensemble des services touristiques disparaissent en forêt. Avec la création de l’Office national des forêts en 1966, les missions des gardes forestiers se recentrent sur la sylviculture et la gestion du patrimoine forestier, ce qui provoque l’arrêt des services touristiques rendus par les forestiers, telle que l’offre de restauration légère dans les maisons forestières. Dans les années 1970, la plupart des buvettes de la forêt ferment faute de repreneurs. Suite à un conflit financier entre son concessionnaire et l’Office national des forêts, propriétaire de la concession, le restaurant de Franchard ferme dans les années 1980. Entre 1968 et 1999, le nombre de résidences secondaires diminue d’un tiers dans les communes du Pays de Fontainebleau. Dans le même temps, le nombre de résidences principales connaît une forte croissance de l’ordre de 54%. La forêt de Fontainebleau connaît une situation paradoxale où le nombre de services touristiques diminue malgré une hausse de la fréquentation. Peut-on toujours considérer la forêt de Fontainebleau comme un espace touristique ? Ce paradoxe peut-il être expliqué par une évolution des pratiques en forêt ? Ce paradoxe de la forêt de Fontainebleau interroge les interactions entre le lieu touristique (la forêt) et le territoire dans lequel il s’inscrit (le Pays de Fontainebleau). Auparavant, ressource touristique du territoire, la forêt de Fontainebleau reste un espace investi ayant une dimension symbolique forte pour les élus locaux et des groupes d’habitants à travers la mise en œuvre de projets présentés comme touristiques. L’offre touristique du Pays de Fontainebleau s’adresse principalement à une clientèle métropolitaine venant sur le territoire pour des courts-séjours. La trajectoire de l’offre touristique nous montre que le territoire est dorénavant pratiqué par des populations de la métropole parisienne comme un espace de récréation (Weaver, 2005). Néanmoins, l’offre touristique du Pays de Fontainebleau se distingue de celle du nord du département de la Seine-et-Marne dont Disneyland Paris constitue la polarité. Cependant, contrairement au nord Seine-et-Marne, l’offre de tourisme-loisirs du pays de Fontainebleau n’a pas été construite à partir d’investissements d’acteurs privés internationaux comme ce fut le cas avec la Walt Disney Company au Val d’Europe. Dans le Pays de Fontainebleau, la construction des bases de loisirs de Bois-le-Roi et de Buthiers dans les années 1970 constituent les deux derniers projets ludico-touristiques à avoir été pensé comme structurant pour le territoire. En cela, la forêt de Fontainebleau constitue un cadre privilégié pour questionner les théories de nouveaux régimes touristiques comme le recreational turn marqué par l’hybridation entre la résidence permanente et la résidence temporaire (Stock, 2007). Ce tournant récréatif engendre une nouvelle perception du tourisme. La rupture entre loisir et tourisme tend à se brouiller. Le tourisme, qui induit un « ailleurs », constituant un hors quotidien a tendance à s’immiscer dans un cadre quotidien. L’expérience d’ordre touristique est recherchée pour créer le dépaysement dans un espace-temps similaire ou proche du quotidien (Équipe MIT, 2008). Le touriste laisse place à un « récréatif » à la fois résident et visiteur permanent (Lajarge, 2006). L’installation croissante de résidents permanents dans des espaces touristiques questionne la disparition du tourisme dans ces espaces et donc l’hypothèse d’un après-tourisme (Bourdeau, 2009). Le cas de la forêt de Fontainebleau ne montre pas une disparition nette du tourisme. Il interroge l’idée d’un héritage touristique. La sortie du tourisme de la forêt de Fontainebleau n’est pas une désaffectation, et encore moins une désaffection du lieu, mais il traduit davantage une évolution du tourisme.
.
Mais comme bien souvent, l’intérêt artistique ou scientifique ne suffira pas à ne pas faire déclasser ces zones ou à détourner l’autoroute A6 (surnommée “autoroute du Soleil et qui sera ouverte fin 1963 début 1964), ni les nationales N6 et N7, ni la ligne Paris-Lyon-Marseille. Si l’avenir de la forêt de Fontainebleau restera à jamais incertain, son passé est lui éternellement marqué par ces peintres qui révolutionnèrent leur Art mais aussi et surtout leur société. (Source)
.
- Les contestations lors de l’établissement de l’autoroute A6 (1955-1963)
- En 1955, lors de l’établissement du tracé de l’autoroute A6, des séries de constestations se sont déclarées afin d’étudier d’autres tracés et de préserver la forêt de Fontainebleau. En août 1955, ils adressent une pétition au ministère pour demander que la bretelle d’autoroute ne touche pas à la plaine située entre Arbonne et Barbizon, “qui est l’un des plus beaux paysages de l’Île-de-France et dont les lignes harmonieuses risquent d’être détruites”. Ces protestations sont relayées par la Société des Amis de Fontainebleau. Pour les Amis de la Forêt, le projet va à l’encontre des intérêts touristiques et économiques de la région puisqu’il va augmenter le trafic routier dans une zone qui devrait être considérée comme une zone de silence et de repos et donc être préservée. Le véritable tracé d’une autoroute vers Lyon devrait être recherché soit en rive droite de la Seine, soit dans le contournement complet par l’Ouest du massif forestier. Au début de 1956, la contestation prend encore de l’ampleur. Successivement entre février et mars le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Académie des Sciences puis l’Académie des Beaux-Arts émettent des vœux appelant au contournement complet du massif forestier. Un avant-projet sera soumis à une première enquête d’utilité publique menée par le Secrétaire d’État aux Travaux Publics du 18 février au 27 mars 1957. Les opposants à l’autoroute mènent une très vive campagne. Elle est animée par le directeur du Muséum d’Histoire Naturelle, membre de l’académie des Sciences, qui a écrit à de nombreuses organismes scientifiques et touristiques pour attirer leur attention sur le fait que “la pression des ingénieurs et de certains milieux politiques risque de faire aboutir un projet désastreux pour l’ensemble du massif”. Sous son impulsion, l’Académie des Sciences et l’Académie des Beaux-Arts réitèrent de façon solennelle le vœu qu’elles avaient émis l’année précédente. Le 29 mai 1957 un projet modificatif, un complément d’enquête est lancée sur la base d’une modification du tracé initial. Comme lors de la première enquête, les principaux opposants à l’autoroute multiplient les observations sur le registre d’enquête et la commission des sites émet formellement un avis négatif. Le 10 septembre 1958, les représentants du ministère de l’Agriculture (en l’occurrence l’administration centrale des Eaux-et-Forêts) et ceux du ministère de la Culture (l’administration centrale des Beaux-Arts, intervenant au titre des sites classés) tentent à nouveau de soutenir la modification proposée par les sociétés savantes mais le point de vue des Ponts-et-Chaussées est catégorique. Néanmoins après avis favorable du Conseil d’État en séance du 30 septembre, le tracé est déclaré d’utilité publique le 3 octobre 1958 par décret signé par le Président du Conseil, Charles de Gaulle. Au début de 1960, l’Institut de France organise un recours auprès de la Présidence de la République. Le 30 mai 1960, leur académie émet “une fois encore, en toute conscience et avec une particulière insistance, le vœu que le projet établi par les services publics tienne compte de la proposition formulée et précisée par les naturalistes et les groupements scientifiques français et internationaux”, le projet des Ponts-et-Chaussées “compromettrait gravement l’intégrité d’un massif considéré comme un des sanctuaires naturels les plus riches au monde”. Le 1er juin, les Secrétaires Perpétuels de l’académie le transmettent au chancelier de l’Institut pour qu’il soit soumis aux quatre autres académies en leur proposant, si elles l’adoptent, de le présenter ensuite à Monsieur le Président de la République. Le 7 juin 1960, conformément à leurs attentes, le vœu est adapté à l’unanimité des cinq académies à l’occasion de l’assemblée générale de l’Institut de France. Après avoir recueilli les différents argumentaires, le chargé de mission remet finalement une note de synthèse de 4 pages au directeur de cabinet de la Présidence le 28 février 1961. Son analyse est très claire : “Les objections faites à la traversée de la forêt de Fontainebleau par l’autoroute du Sud sont nettement exagérées”. La réponse du directeur de cabinet lui est donnée le soir même : “M. Mallet, Le Général de Gaulle n’a pas d’objection”. L’analyse des documents conservés aux archives montre que les services des Ponts-et-Chaussées ont particulièrement étayé leur argumentation, contrairement à l’ensemble des “opposants”, membres de l’Institut et services des Eaux-et-Forêts, qui s’en sont tenus à des critiques d’ordre général, exprimées en deux ou trois pages et basées sur le fait qu’on allait détruire l’unité d’un espace vert remarquable. Les Ponts-et-Chaussées ont constitué un dossier volumineux et illustré de nombreux documents et montages photographiques pour démontrer qu’il n’y avait pas d’autre choix possible pour le tracé que celui qui avait été légalement déclaré d’utilité publique, sauf peut-être un tunnel sous la forêt. Parmi les arguments posés : “Les ouvrages d’art vont-ils saccager un site grandiose ? Les deux principaux ouvrages prévus, les viaducs sur la vallée des Cavachelins et la Vallée Chaude, feront l’objet d’un concours et l’aspect esthétique sera une des bases d’appréciation du projet à retenir. On tiendra compte du fait que ces viaducs seront surtout faits pour être vus par en-dessous, par les promeneurs en forêt. Les aménagements paysagers et les nombreuses plantations prévus modèleront un paysage plus varié et plus attrayant que celui qu’offre actuellement la zone traversée. Le site retenu pour le passage de l’autoroute est manifestement assez pauvre et, si on lui reconnaissait le titre de grandiose, on manquerait d’épithètes pour la forêt domaniale proprement dite. Le verbe “saccager” employé par l’Institut paraît donc très exagéré.” L’ouverture définitive de l’autoroute est intervenue après son’inauguration le 23 mars 1963.
(Source : Autoroute française A6 (Historique) / Région Parisienne (1956-1962)
.
Compléments : “L’art de la contestation : pour introduire le concept de désobéissance artistique”, 2019 “Art et contestation”, 2009
“La contestation dans l’art”, 2016
“Pourquoi les militants écologistes utilisent l’art pour mener leur action”, 2022
“De la performance dans les arts. Limites et réussites d’une contestation”, 2013
.

Camille Corot, “Artiste passant dans un chaos de rochers à Fontainebleau”, 31,5cm x 40cm, 1829, Musée d’Art et d’Histoire MAH de Neuchâtel (Source).
.
.
7d
Réserve artistique ; Site à destination artistique ; Série artistique ; Réserve biologique
VENT DE MER À LA CAMPAGNE
‒ « Je t’apporterai un jeune pavot, aux pétales de pourpre. » (Théocrite, “Le Cyclope”)
« Au jardin, dans le petit bois, à travers la campagne, le vent met une ardeur folle et inutile à disperser les rafales du soleil, à les pourchasser en agitant furieusement les branches du taillis où elles s’étaient d’abord abattues, jusqu’au fourré étincelant où elles frémissent maintenant, toutes palpitantes. […] Ce pêle-mêle de vent et de lumière fait ressembler ce coin de la Champagne à un paysage du bord de la mer. Arrivés en haut de ce chemin qui, brûlé de lumière et essoufflé de vent, monte en plein soleil, vers un ciel nu, n’est-ce pas la mer que nous allons apercevoir blanche de soleil et d’écume ? » ‒ (Marcel Proust, “Vent de mer à la campagne”, in “Les Plaisirs et les Jours”, ], chap.7, “Les regrets, rêveries couleur du temps, XIX. Vent de mer à la campagne, (1896), Éd. Calmann-Lévy, 1896) [1]
.
- À l’origine des parcs naturels nationaux (PN, PNR), des “séries artistiques” de Fontainebleau sont sauvegardées pour raison esthétique et sous une forme juridique au 19e siècle en France, par les peintres paysagistes de l’École de Barbizon et un cortège d’intellectuels pétitionnaires, dont Victor Hugo et Georges Sand. En 1853, ils obtiennent la mise hors d’exploitation de près de 624 hectares. Le décret du 13 août 1861 (n°11701), de Napoléon III (qui au passage n’aimait pas la chasse et préférait les promenades en forêts [1), à la suite d’une bataille d’argumentations entre le “point de vue forestier” et celui des “Beaux-Arts”, classe 1097 hectares de la forêt de Fontainebleau (542 hectares de vieilles futaies et 555 hectares de rochers), périmètre de protection contre toute exploitation, “soustraits à tout aménagement” en créant des “sites à destination artistique” (Source). Décision qui prend à contre-pied les aménageurs et que l’historien Jean-Claude Polton replace dans son contexte, celui de « la protection du patrimoine esthétique » dont Prosper Mérimée, inspecteur général des Monuments historiques, est le promoteur depuis 1834 ; « Ce sont les artistes et non les scientifiques qui ont été en France à l’origine de l’idée de protection de la nature », constate Jean-Claude Polton.Cette jurisprudence, première politique de sauvegarde de la nature au monde, bénéficiera à d’autres forêts en France. La mort de Théodore Rousseau en 1867 voit Michelet, George Sand ou même Victor Hugo faire tour à tour campagne contre ces destructions annoncées.
- En 1861, un décret impérial institue sur le plan juridique la création d’une « réserve artistique » de 1 097 hectares. Le mot « réserve » est intéressant d’un point de vue sémantique. Le verbe « réserver » veut dire garder, retenir quelque chose d’un tout. Il est synonyme du mot « ménager ». L’idée de la naturalité comme sanctuaire de la modernité prend son sens, puisqu’on la met en réserve de l’exploitation sylvicole, c’est-à-dire de l’industrie et donc de la modernité.
- Toutefois il ne faut pas négliger les différends de position et de conviction entre les artistes et les écrivains : en 1853 les peintres vont défendre le “caractère d’antiquité et de grandeur” qu’ils attribuent à la forêt (contre donc le développement naissant du tourisme : le dressement des cartes, l’ouverture de sentiers, etc. œuvrant à rendre la forêt accessible et ainsi à la dégrader), alors que les écrivains (Nerval, Hugo, Musset, Gauthier) soutiennent que ce type de lieu ne peut être que “public”, donc ouvert, car la forêt n’est plus au milieu du XIXième siècle le pur espace dans lequel ils éprouvent le sentiment de la nature et de celui de leur moi, mais, dorénavant, un lieu devenu lui aussi “politique” au sens d’un bien qu’il s’agit pour l’État à la fois de protéger et de rendre accessible.
(Source : Veronique Goudinoux, “Œuvrer à plusieurs: Regroupements et collaborations entre artistes”, p.82)
- Par ailleurs, et même si les artistes à l’origine des “séries artistiques” ont été continuellement ridiculisés (dans la presse et les prises de paroles) (« MM. les peintres qui prétendent que la forêt de Fontainebleau n’est pas destinée à produire des bois mais des modèles pour les paysagistes. » (anonyme, in La Revue des Eaux et des Forêts, 1873) (Source) parce qu’ils avaient osé défier tant les forestiers que les enjeux économiques de l’État, il ne s’agissait pas d’un geste capricieux de quelques dandys, mais bien de l’une des plus importantes mobilisations sociales en France du XIXième siècle, impliquant l’opinion publique et les plus hautes sphères de la politique du Second Empire, et, en conséquence au changement de la perception de la forêt et de la nature, mais aussi du rôle de l’artiste dans la société. (Fritsch, 1995)
.
- Dans l’amendement d’Horace de Choiseul déposé le 16 décembre 1876, les réserves artistiques sont définies ainsi : « On entend, vous le savez, messieurs, par réserves artistiques, les vieilles futaies et les sites pittoresques de la forêt de Fontainebleau, qui ont inspiré et inspirent chaque jour l’école de peinture de Fontainebleau. » (Source). En 1876*, l’année de la mort de Sand, une proposition de loi sera bien déposée pour augmenter de 1000 hectares la superficie des “*réserves artistiques*”. Sans succès. Ce n’est qu’**en 1892** qu’un décret augmente légèrement les « *réserves artistiques* », portant leur surface à 1616 hectares. Puis à 1692 hectares **en 1904**. Elles sont rebaptisées « *réserves biologiques* » après la seconde guerre mondiale ; **en 1953**, des parcelles sont déclassées et exploitées ; et la forêt entière est classée pour sa valeur paysagère **en 1965**. L’appellation « *série artistique* » disparaît en 1967. Trois ans après, un nouveau plan d’aménagement remet à l’ordre du jour coupes rases et plantations de pins. En février 2011, à Bois-le-Roi, pour cause de « dépérissement » dû à la tempête de 1999 et au réchauffement climatique, 1 500 chênes sessiles sont tronçonnés.
.
- L’expansion des réserves artistiques est le résultat de décisions politiques auxquelles l’administration forestière s’adapte. La nomination d’Émile Sinturel comme inspecteur adjoint à Fontainebleau le 7 mars 1913 puis comme inspecteur principal après la Première Guerre mondiale marque un tournant dans le positionnement des cadres forestiers vis-à- vis du tourisme. Émile Sinturel, inspecteur des Eaux et Forêts, devient en 1920, le premier président du syndicat d’initiative de Fontainebleau. En 1923, face au “Congrès International pour la Protection de la Nature, faune et flore, sites et monuments naturels”, dans un de ses exposés de présentation de la “liste actuelle des Séries Artistiques et Sites Artistiques Assimilés”, Émile Sinturel tentait de clarifier les différentes catégories des espaces protégés, et plus particulièrement la “série artistique”. Il mettait aussi l’accent sur le caractère “faible”, donc facilement acceptable, de ce type de protection, ainsi que sur la volonté d’intégrer plus largement la “valeur esthétique” dans la politique forestière française :
- « D’autre part, les Séries Artistiques ‒ “parties de forêts, remarquables par la beauté de leurs peuplements, ou par le pittoresque de leurs sites, véritables “musées de la Nature”, protégés par des règlements spéciaux, maus accessibles au public”. Ces définitions du Parc National (réserve biologique) et de la Série Artistique (Musée de beautés naturelles) méritent d’être retenues […]. Elles suffisent d’ailleurs à expliquer que si les Parcs Nationaux ne sauraient être constitués qu’en nombre très limité, et dans les régions pauvre où les terrains ont peu de valeur, les Séries Artistiques, au contraire, peuvent devenir nombreuses dans toutes les parties de notre pays, si riche en paysages forestiers, et plus particulièrement dans les forêts domaniales, où l’État n’a pas à craindre l’objection d’atteinte au droit de propriété, que les propriétaires de bois particuliers ne manquent pas de lui adresser à chaque projet de classement. »
- « Le type d’aménagement à généraliser serait, à notre avis, celui de la Série Artistique de la forêt de Fontainebleau, la 21ième Série. Ses directives sont d’ailleurs fort simples. Le procès-verbal approuvé par décret le 22 avril 1904 se limite en effet à indiquer : « Que la Série Artistique, dont la superficie est de 1,692ha 70, comprend ce que la forêt contient de plus remarquable tant au point de vue de la végétation ligneuse que de la beauté des sites, et que cette série peut être considérée comme le domaine exclusif des promeneurs et des artistes ; Que pour lui conserver son caractère esthétique, on continuera, comme par le passé, à n’asseoir sur toute cette surface aucune exploitation régulière ; Que toutefois pour permettre au service forestier de suivre l’évolution des vieux massifs complètement abandonnés à eux-mêmes, la section a été partagée en 40 parcelles, dont le matériel a été inventorié, et ces parcelles réparties en 7 groupes correspondant à un même nombre d’années d’une rotation fictive […] ». Il est bien difficile de s’élever contre ce règlement, où la technique forestière s’efface devant les considérations d’esthétique. Mais il serait également exagéré de prétendre résoudre toutes les difficultés par un texte administratif, même le plus heureux. »
- « C’est donc moins à ce texte qu’à l’application qui en a été faite depuis 1904 que l’on doit porter attention. Or, si des polémiques ont pu, vers 1913, s’engager sur l’opportunité de certaines “opérations culturales”, notamment celles qui visent le retrait d’arbres morts, il semble qu’aujourd’hui l’ère des conflits doive être close, le Service Forestier acceptant de conserver ou d’enlever tous les arbres morts suivant la décision prise par les groupements des artistes : décision qui cependant, naturellement ne va pas toujours sans d’assez longs débats préalables, car en matière d’art, les goûts varient à l’infini. En fait, si un sujet en ruine se signale encore par sa beauté tourmentée, il est réservé, mais, si rien ne le distingue, il cède la place à l’arbre d’avenir, une réserve de santé devant rester préférable à une réserve de mort. »
- « Nous nous limiterons donc à proposer au Congrès d’émettre le vœu que, dans la plupart des forêts domaniales, les cantons se distinguant par la beauté de leurs sites ou de leurs peuplements soient distraits de l’aménagement ordinaire pour être classés comme “Séries Artistiques” et soumis par là, à un règlement spécial de protection. » Vœu adopté par le Congrès International pour la Protection de la Nature, faune et flore, sites et monuments naturels, Paris, du 31 mai au 3 juin 1923.
.
- En 1933, dans la Revue d’Écologie (La Terre et La Vie), A. Granger publie un article sur les “séries artistiques” : “Les Séries forestières artistiques” :
- « On appelle “série artistique” une partie de forêt où, soit en raison de la beauté des arbres, soit à cause du site, on renonce, dans un but artistique, aux règles habituelles de la gestion forestière et qu’on laisse par conséquent en dehors de toute exploitation régulière. Ceci ne veut pas dire en dehors de toute exploitation, car la forêt, il ne faut pas l’oublier, est un organisme vivant. […] Il existe, dans les forêts des environs de Paris, de nombreuses séries artistiques. Parmi les plus connues, il convient de citer celles des Beaux-Monts à Compiègne, celle des Cascades à Rambouillet, les Parcs de Compiègne, St-Cloud, Versailles, Marly, Rambouillet, les abords de ces cités foretières. Quant à la forêt de Fontainebleau, elle est traitée sur ces bases dans de nombreux sites pittoresques (Long Rocher, Goerges de Franchard, Mare aux Fées, etc.). [Suivent d’autres listes de lieux] […] Dans la conservation de Rennes, on trouve des séries artistiques en forêt de Rennes, à Mi-Forêt ; de Fougères, à la Verrerie ; de Carnoët, aux bords de la Laïta ; du Huelgoat, entre la grotte d’Artus et le gouffre d’Argent. Il en existe dans les conservations de Rouen, de Dijon, d’Amiens, de Bar-le-Duc, en plaine, comme en montagne, dans celles de Chambéry (à proximité d’Aix-les-Bains), d’Épinal (contre Gérardmer), de Besançon, de Grenoble (Grande Chartreuse), de Pau (les Eaux-Bonnes, Barèges, Bagnères), de Nice (île Sainte-Marguerite, et la Sainte-Baume), de Carcassonne, de Digne, etc. […] [I]l apparaît que les considérations esthétiques prennent une importance de plus en plus grande [que la valeur du bois lui-même] dans l’aménagement des forêts, au moins de celles qui, grâce à leur situation géographique, sont de plus en plus visitées par les touristes. […] Il semble qu’il y ait là une action d’ordre moral à exercer, quand un de ces classements est désirable et ce peut être, en partie, le rôle de groupements tels que la Société d’Acclimatation. En outre il ne faut pas perdre de vue que le respect de ces réserves boisées qui contribuent à la beauté de la France a une action indirecte, mais certainement favorable, sur la prospérité du pays, par le mouvement touristique auquel donnent lieu ces séries artistiques. L’État en particulier peut ainsi concilier, semble-t-il, le souci de son propre intérêt avec celui du bien public, et même avec des considérations esthétiques. »
(Source : A. Granger, “Les Séries forestières artistiques”, in Revue d’Écologie (La Terre et La Vie), Année 1933, 3-8, pp. 479-480 482-483)
.
- En France, on cite la création de la “réserve artistique” de la forêt de Fontainebleau en 1861, mais cette mesure reste une exception pendant plusieurs décennies. Le 21 avril 1906, la loi Beauquier relative à la protection de l’environnement est une première en France. Le député radical-socialiste Charles Beauquier fut l’un des fondateurs de la Société de protection des paysages et de l’esthétique de la France. Au début du XXème siècle, la question esthétique était très présente dans les débats environnementaux. En 1913, la proposition de classement de la forêt de Fontainebleau en parc national sous la tutelle du ministère des Beaux-Arts montre l’importance de l’esthétique dans le jugement des espaces naturels à cette époque (Polton, 2005). On perçoit un changement de paradigme après la Seconde Guerre Mondiale avec la loi du 1er juillet 1957 introduisant la notion de « réserves naturelles » puis avec la loi du 22 juillet 1960 relative à la création des parcs nationaux. Ces deux lois montrent la prégnance de l’intérêt scientifique sur l’intérêt esthétique. […] Le tourisme promeut un usage contemplatif de l’environnement, compatible avec sa construction moderne. Le touriste contemple les espaces naturels protégés pour leurs qualités esthétiques qui leur sont attribuées voire pour l’intérêt biologique qu’il y trouve. Il ne regarde pas cet environnement comme un réservoir de ressources utiles pour ses conditions de vie. De fait, le tourisme est souvent considéré comme la seule activité pouvant valoriser économiquement ces espaces.
.
- D’ailleurs il est intéressant de rappeler les “séries artistiques” comme une étape de l’histoire de la protection de la nature ; soulignons également que même si les valeurs esthétiques ont longtemps joué un rôle de facteur de la protection dans diverses parties de l’Europe, la création des “séries artistiques” est une exception française. Aujourd’hui, un rôle si important des artistes dans de semblables décisions administratives peuvent nous étonner. Cependant, l’avancée d’une époque peut devenir le retard d’une autre.
.
- En 1967, les “réserves artistiques” de la forêt de Fontainebleau sont supprimées au profit des “réserves biologiques”. Certaines des parcelles forestières sont classées en réserves biologiques intégrales (RBI) ou en réserves biologiques dirigées (RBD), mesures créées en 1958. Les RBI sont des zones mises hors aménagement pour permettre aux scientifiques d’étudier des espaces forestiers en libre évolution. Les RBD sont des zones où les forestiers veillent à préserver un état écologique défini. À La différence de la “réserve artistique” qui avait vocation de permettre aux artistes et aux touristes de pouvoir jouir d’une forêt offrant des paysages de qualité d’un point de vue esthétique établis selon des codes construits par la peinture de paysage moderne et les descriptions romantiques, la réserve biologique a vocation à devenir un terrain d’étude pour les naturalistes pour faciliter leurs recherches sur l’évolution naturelle des milieux forestiers. Les réserves biologiques sont délimitées selon des critères scientifiques. À la différence des réserves artistiques, les visiteurs n’ont pas le droit d’entrer dans les réserves biologiques intégrales. L’intervention forestière a pour but de maintenir le milieu écologique. Bruno Latour voit dans ce que sont devenus les espaces naturels des lieux où les seuls humains tolérés sont les scientifiques (Latour, 2005 : Bruno Latour, “Nous n’avons jamais été moderne : essai d’anthologie symétrique”, Ed. La Découverte, 2005, première parution, 1991).
.
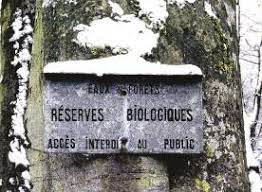
.
.
7e
Site artistique et fictions : “le simulacre du pourpre simultanément dans le ciel du P et celui de Fontainebleau”
(Extraits de la Thèse de Rémi Salaün, “L’héritage touristique. Trajectoire d’un lieu périurbain : trajectoire d’un lieu périurbain : la forêt de Fontainebleau”, 2017 [1])
- Le concept d’écotourisme s’est diffusé mondialement à partir des années 1990. En 1976, Geraldo Budowski évoque la nécessité de trouver une nouvelle voie de développement touristique pour concilier les deux objectifs antithétiques que sont la préservation de l’environnement et le développement économique des territoires par le tourisme. Cette volonté de trouver une nouvelle forme de tourisme plus consensuelle est à l’origine de ce concept d’écotourisme, même si Budowski n’utilise pas cette terminologie (Budowski, 1976 : Geraldo Budowski, “Tourism and Environmental Conservation : Conflict, Coexistence or Symbiosis ?”, in “Environmental Conservation”, vol. 31, no 1, 1976 p. 27-31). En 1990, est fondée l’association Société Internationale de l’Écotourisme, comptants 500 membres dans une centaine de pays. En 2002, l’Organisation des Nations-Unies institue l’année internationale de l’écotourisme dont le point d’orgue est l’organisation du sommet mondial de l’écotourisme de Québec. En 1991, La Société Internationale de l’Écotourisme définit le concept d’écotourisme comme : « un voyage responsable dans des environnements naturels où les ressources et le bien-être des populations sont préservés. ». Cette première définition traduit davantage des intentions que des actions. En cela, elle donne peu d’informations sur les orientations de cette forme de tourisme. « L’écotourisme se veut une réponse « durable » à l’inquiétante montée d’un tourisme de masse insuffisamment conscient des menaces qu’il fait peser sur l’environnement. Le développement d’un tourisme tourné vers une consommation de plus en plus rapide et « rentable » des voyages, où chacun pense avoir le droit de découvrir jusqu’à la parcelle la plus reculée du monde, participe à la menace qui pèse sur le renouvellement des ressources naturelles telles que l’eau douce, les forêts et les récifs coralliens, et met en péril la survie de nombre d’espèces vivantes, trop souvent exposées à la curiosité de touristes s’imaginant dans des zoos à ciel ouvert » (Francesco Frangialli, secrétaire général de l’Organisation Mondiale du Tourisme de 1997 à 2008, lors de la Journée mondiale du tourisme de 2008). Dès les années 2010, le concept d’écotourisme a trouvé un certain succès dans les politiques touristiques locales, notamment à Fontainebleau. Le centre d’écotourisme de Franchard a ouvert ses portes en mai 2011. Le centre est bâti sur l’emplacement d’un ancien restaurant fermé dans les années 1980. À cette époque, Franchard est considéré comme le site le plus visité de la Forêt de Fontainebleau.
.
-
Depuis les années 1970, le débat intellectuel s’interroge sur une possible sortie de la modernité. On peut ajouter la prise de conscience de la finitude de la Terre, à travers le rapport du club de Rome en 1972, comme l’une des causes de la postmodernité (Bourg et Papau, 2010 : Dominique Bourg et Alain Papaux, “Écologie, 1980-2010: de l’exception française à la normalisation”, in Le débat, n° 160, 2010, pp. 94-114). Ainsi, on peut concevoir la postmodernité comme un ensemble de réflexions, de réserves et de critiques vis-à-vis de plusieurs aspects de la modernité tels que la faillite des grandes idéologies, la perte de confiance aux idéaux des Lumières, la décrédibilisation des forces structurantes dans le champs politiques et la décélération du rythme d’amélioration du bien-être (Tapia, 2012 : Claude Tapia, “Modernité, post-modernité, hypermodernité”, in Connexions, n°97, 2012, pp.15-25). La postmodernité annonce la fin de la modernité. La “french theory”, dont on nomme les travaux de chercheurs américains inspirés par la pensée structuraliste, a ouvert la géographie à de nouveaux objets d’études traitant des minorités tels que les “gender studies” ou les “post-colonial studies”. La postmodernité en géographie peut être perçus comme l’ensemble de discours critique sur les dégâts de la modernité, celle-ci étant vue comme une association des innovations technologiques, de la mondialisation, du capitalisme et du pouvoir étatique (Brunet, 2004 : Roger Brunet, “Le postmodernisme en géographie”, L’Espace géographique, tome 33, 2004).
-
Dans son ouvrage “The Tourist Gaze : Leisure and Travel in Contemporary Society” (1990), John Urry constate un brouillement des frontières entre l’espace-temps ordinaire (celui du travail) et l’espace-temps extraordinaire (celui du tourisme). Pour J. Urry, cette postmodernité culturelle conduit à un “post-tourisme” (Urry, 1990). Le sociologue parle d’une hybridation entre quotidien et exotisme. La rupture entre loisir et tourisme tend à se brouiller. On voit émerger des pratiques hors quotidiennes dans le quotidien. L’expérience touristique est recherchée pour créer le dépaysement dans un espace-temps similaire ou proche du quotidien (Équipe MIT, 2008 : Équipe MIT, “Tourisme 2. Moments de lieux”, Belin, Coll. Mappemonde, Paris 2005 ?). Une autre interprétation est celle de Jean Viard. Pour ce dernier, le post-tourisme désigne : « les activités et les migrations humaines qui sont attirées par certaines régions touristiques mais sans que ces activités et ces hommes aient directement à voir avec le tourisme. » (Viard, 2000 : Jean Viard, “Le sacre du temps libre. La société des 35 heures”, Éd. de l’Aube, Coll. Monde en cours, Série intervention, 2002 ; et Jean Viard, “Éloge de la mobilité : essai sur le capital temps libre et la valeur travail”, Éd. de l’aube, 2011). Nous pouvons concevoir le post-tourisme de Jean Viard davantage comme un héritage de la villégiature que comme un héritage du tourisme.
-
On peut s’interroger sur la place du rêve dans les pratiques touristiques. Bertrand Lévy distingue “le voyageur” du “voyagé”. “Le voyageur” est actif, indépendant qui doit chercher et parfois souffrir avant de découvrir le lieu qui le comble. Il opère une rupture avec le rythme et la manière de vivre sédentaire. Tandis que, “le voyagé” est pourvu d’un plan de voyage. Il se laisse guider par un interprète qui les prend en charge ou par l’intermédiaire d’un guide-papier voire d’un smartphone (Lévy, 2004 : Bertrand Lévy, “Voyage et tourisme. Malentendus et lieux communs”, in Le Globe, t. 144, 2004, pp. 121-134). Bertrand Lévy induit l’existence d’un médiateur. Celui-ci sert pendant le voyage, il permet au touriste de respecter son plan de voyage. Il existe aussi une médiation avant le voyage, celle qui donne envie au touriste de visiter une destination. De cette manière, le touriste n’arrive pas « vierge » dans un lieu. Il en a déjà un imaginaire et, de fait, des attentes.
-
Certains lieux touristiques deviennent des marques déposées à l’Institut National de la Propriété Intellectuelle. Le concept de “disneylandisation” résonne avec le récit de voyage d’Umberto Eco, “La guerre du faux”, paru en 1985. Dans les années 1980, Umberto Eco entreprend un voyage aux États-Unis pour rechercher la « chose vraie », ou plutôt ce qui est présenté comme tels aux visiteurs, c’est-à-dire la « vraie réalité » qui pour U. Eco constitue l’expérience ultime. Les objets qu’ils fréquentent essaient tous, chacun à leur manière d’« améliorer » la réalité. Par exemple, U. Eco décrit une reconstitution de la “Vénus de Milo” où celle-ci a des bras pour paraître plus réelle. Il fait alors le récit d’une expérience troublante dans laquelle la poursuite d’une réalité idéale entraine sa propre contradiction en ce que le « complètement réel » se confond avec le « complètement faux ».
-
Dans “Simulacre et simulation”, publié en 1981, Jean Baudrillard théorise le concept d’hyperréalité. Ce phénomène, venant d’une volonté d’améliorer la réalité, engendre une confusion entre l’imaginaire et la réalité. L’hyperréalité ne se retrouve pas uniquement dans le domaine du divertissement touristique, il touche aussi le tourisme culturel avec la diffusion des reconstitutions historiques et des spectacles de chevalerie dans les châteaux médiévaux. Ainsi, nous revenons au rêve. L’objectif des promoteurs des lieux « hyperréels » est de proposer à leurs hôtes de réaliser leurs rêves, ou du moins en partie. C’est pourquoi, il faudrait davantage parler d’hypermodernité dont les caractéristiques sont l’individualisation croissante des rapports aux autres, aux objets, aux pratiques et à l’espace-temps. L’accélération du temps permise par les innovations technologiques est aussi une marque de l’hypermodernité (Lipovetsky, 2004 : Gilles Lopovetsky, “Les temps hypermodernes”, Grasset, 2004). Le phénomène touristique de disneylandisation peut être perçu comme une hybridation de l’économie et la culture introduisant une esthétisation de l’économie, ce que G. Lipovetsky et J. Serroy nomment le “capitalisme artiste”. Cette esthétisation est visible dans la théâtralisation des lieux de vente, mais aussi on peut aussi la percevoir à travers la marchandisation des sites culturels avec l’implantation d’espaces de consommation telle que des hôtels, des restaurants et des boutiques (Lipovetsky et Serroy, 2013 : Gilles Lipovetsky et Jean Serroy, “L’esthétisation du monde : vivre à l’âge du capitalisme artiste”, Paris, Gallimard, 2013).
-
Pour Alain Girard, il est préférable de parler d’“hypertourisme”, celui-ci désignant : « l’extension de la mise en tourisme des territoires sous toutes ses formes cumulatives plutôt qu’alternatives, l’expansion des pratiques touristiques dans leurs diversités qui vont avec une montée des éclectismes touristiques et le réinvestissement, socialement sélectif, de l’espace-temps habité par l’esthétique touristique serait plutôt à comprendre comme une accentuation de la rationalisation restreinte dans le modèle civilisationnel de croissance. » (Girard, 2013 : Alain Girard, “Faut-il raccorder à une théorie à moyenne portée du post-tourisme à une théorie générale du post-modernisme ?”, in Bensahel L., Bourdeau P., François H. (dir.), “Fin ( ?) et confins du tourisme”, L’Harmattan, 2012).
-
Signalons, le concept de “transmodernité” proposé par Jean Corneloup prend en compte la critique écologiste de la modernité. À la différence de la postmodernité, la transmodernité n’induit pas l’idée d’une rupture avec la modernité mais la volonté d’individus à constituer une alternative à la modernité. Dans le champ touristique, J. Corneloup intègre la transmodernité dans le tournant récréatif avec la discussion de la dichotomie tourisme/loisirs. Davantage récréative que touristique, la pratique transmoderne s’inscrit dans la production d’un art de vivre écologique et donc dans une volonté de s’investir dans la protection des lieux pratiqués (Corneloup, 2011 : Jean Corneloup, “La forme transmoderne des pratiques récréatives de nature”, in “Développement durable et territoire”, vol 2 n°3, 2011).
-
Dans “La planète disneylandisée : Chronique d’un tour du monde” (2012), Sylvie Brunel s’attache à décrypter les mises en scène utilisées dans des lieux de naturalité pour les rendre plus accessibles aux touristes. Ces mises en scène peuvent engendrer une tension vis-à-vis des valeurs modernes d’authenticité de la naturalité puisque ces lieux sont voués au simulacre. D’ailleurs, les publicités pour ces lieux continuent de vanter l’authenticité et naturalité. Dans l’ensemble, les mises en scène de ces publicités figurent un touriste ou un groupe de touristes seuls dans l’immensité d’un espace naturel. Le motif du “voyageur contemplant une mer de nuages” du célèbre tableau de Caspar David Friedrich est souvent repris dans les photographies touristiques des lieux de naturalité. L’anecdote du geyser de Lady Knox en Nouvelle-Zélande, jaillissant chaque jour à 10h15 raconté par Sylvie Brunel est un exemple frappant du simulacre offert par les formes hypermodernes du tourisme. La raison du jaillissement régulier de ce geyser est l’application de produits lessive dans la fente par des agents du site touristique, créant ainsi une réaction chimique. Le phénomène « naturel » devient un spectacle. Les touristes achètent leurs billets la veille pour voir le jaillissement, ils viennent pour le jaillissement du geyser et repartent une fois le spectacle terminé. L’anecdote de Lady Knox montre une acceptation du simulacre de la part des touristes. Certes, c’est une acceptation qu’on ne va pas certainement mettre en avant dans son récit de voyage. La vérité du moment sera peut-être omise dans le discours des touristes. Mais sur le moment présent, le touriste accepte le simulacre. La cause de cette acceptation, c’est que la vue d’un geyser jaillissant reste pour les touristes un phénomène « naturel » extraordinaire.
-
Du fait de l’éloignement (le déplacement exceptionnel touristique à un endroit), les touristes fréquentent le lieu en pensant qu’ils n’y retourneront pas. Avec le tourisme mondialisé, les possibilités de destinations touristiques sont tellement nombreuses que l’on peut circuler sans forcément revenir sur ses pas. Dans le langage courant, il est commun d’entendre : « On a fait la Nouvelle-Zélande. » ou « On a fait Fontainebleau. », ce qui sous-entend que nous n’y reviendrions plus dans un lieu puisqu’on y déjà allé et que nous y avons vu tous ce qu’il fallait voir. Nous pouvons dire qu’il y a une unicité de la visite dans un lieu de naturalité extraordinaire. De cette manière, la mise en scène permet de répondre à ce désir puisqu’elle assure la réalisation des rêves touristiques.
-
Contrairement à la naturalité extraordinaire, le recours au simulacre dans un lieu de naturalité ordinaire comme la forêt de Fontainebleau est moins accepté. La répétition des visites (ou leur répétabilité et la facilité d’accès ; Paris et Fontainebleau ne sont des lieux éloignés en distance) modifie les perceptions et les pratiques des usagers. Dans le texte “La forêt et moi” (2002), l’écrivain Anne Vallaeys raconte les sorties dominicales en famille dans la forêt des Trois-Pignons quand elle était adolescente : « nous repoussions, dimanche après dimanche, les limites de notre terra incognita. […] Mon attraction pour la forêt de Fontainebleau, sans doute mon père n’y est-il pas étranger. L’intérêt qu’il montrait pour elle a prit l’allure de la passion. Il entreprit très tôt de l’explorer, d’en reconnaitre les parcelles les plus reculées, les cantons les moins visités. Il l’a parcourue dans tous les sens, par tous les temps, en toutes les saisons. Il s’est peu à peu construit une collection de circuits « personnels » parmi lesquels il choisit, au gré de son humeur et de la couleur du temps, celui que suivront ses pas. ». Ce récit montre l’impact de la répétition sur la pratique des lieux. Contrairement à la naturalité extraordinaire où l’on souhaite que l’évènement se déroule pendant l’unicité de notre visite. La répétitivité des visites induit une certaine patience vis-à-vis des temporalités du lieu voire une disponibilité aux incidents du hasard.
-
L’unicité de la visite fait que le désir de voir l’évènement rêvé prend le pas sur le désir d’authenticité. Au contraire, dans un lieu de naturalité ordinaire, le passage à un régime de la répétitivité des visites entraine un rejet du simulacre car l’attente de l’évènement est moindre ou du moins il doit avoir lieu dans un contexte de sérendipité. Ainsi, la dialectique entre l’ordinaire et l’extraordinaire nous semble être une voie d’analyse pour comprendre les tensions qui animent le touriste dans les lieux de naturalité. La répétitivité des visites peut entrainer une sortie du tourisme, en tant que pratique culturelle. On peut définir le tourisme, dans sa définition première, comme une pratique culturelle basée sur la découverte. Être touriste, ce n’est pas seulement être dans un endroit qui n’est pas chez soi. Être touriste, c’est regarder l’espace en touriste, c’est-à-dire avec une curiosité suscitée par la découverte. Or avec la répétition des visites, on ne regarde plus l’espace en touriste. Cet espace devient un lieu de rituel car il est approprié et devient familier pour le visiteur. Par conséquent, nous pouvons définir la récréation comme une évolution ritualisante du tourisme. Sans la découverte pionnière du touriste, il n’y a pas de récréation. Celle-ci se construit dans une répétitivité des pratiques.
.
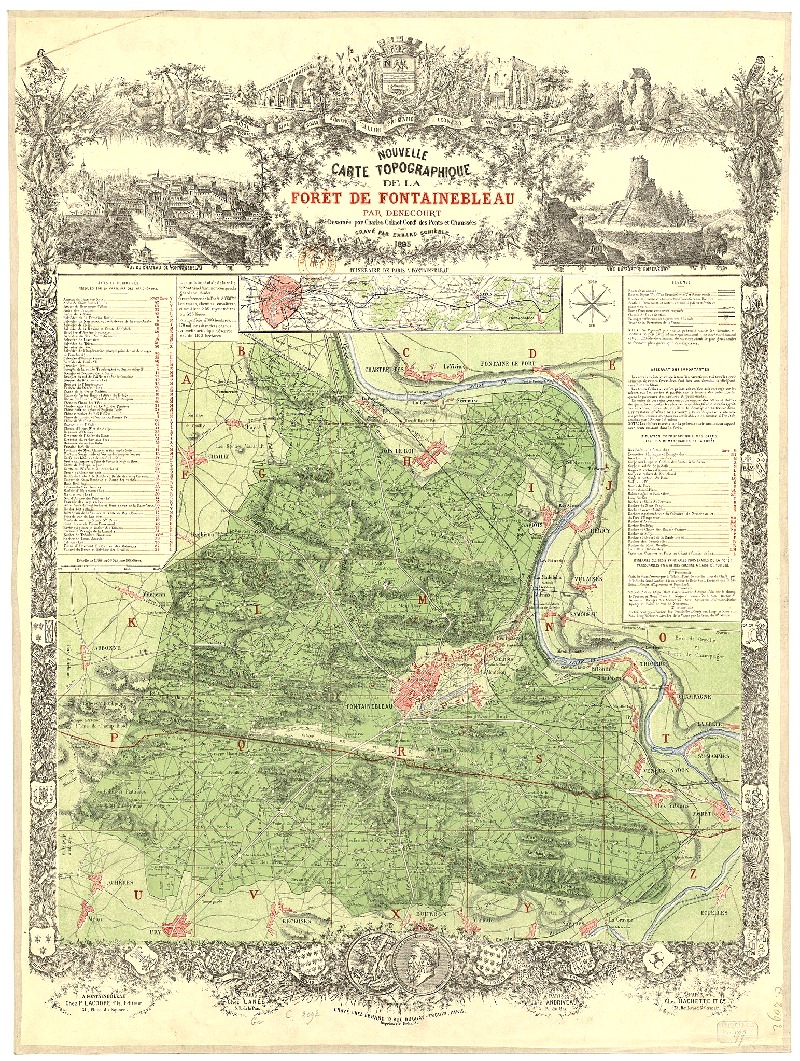
Nouvelle carte topographique de la forêt de Fontainebleau, par Denecourt, 1895 (téléchargement grand format, 1,2Mb).
.
.
7f
Réserve, série, site artistiques entre “espace délaissé”, “wilderness”, et “lieu sublime”
(Extraits de la Thèse de Rémi Salaün, “L’héritage touristique. Trajectoire d’un lieu périurbain : trajectoire d’un lieu périurbain : la forêt de Fontainebleau”, 2017 [1])
- une “réserve artistique” est-elle un “espace délaissé” et un espace “ménagé” ? Le concept de “tiers-paysage”, introduit par le paysagiste français Gilles Clément, revisite la notion de naturalité. Pour Gilles Clément, le “tiers-paysage”, ce sont ce que l’on peut nommer les “délaissés”, c’est-à-dire les espaces qui n’ont pas ou plus de fonction définie (Clément, 2003). Par exemple, une voie ferrée désaffectée peut être considérée comme un tiers-paysage. De fait, les tiers-paysages ne sont pas seulement des espaces vierges de l’activité humaine, mais davantage des espaces où les humains se sont en quelque sorte retirés. Gilles Clément fait le constat que la biodiversité y est plus présente, car les tiers-paysages constituent des espaces d’accueil privilégiés pour certaines espèces. Contrairement aux villes, aux espaces agricoles et forestiers exploités qui sont des espaces maitrisés par l’activité humaine où celle-ci sélectionne la diversité environnementale (Clément, 2004). Gilles Clément met en application sa théorie sur le tiers-paysage par le biais de commandes publiques dans lesquels le paysagiste privilégie le ménagement des espaces à l’aménagement.
-
une “réserve artistique” est-elle un “wilderness” ? Le “Wilderness Act”, voté par le parlement états-unien en 1864, définit le wilderness comme : « un lieu où la terre et sa communauté de vie ne sont point entravées par l’homme, où l’homme lui-même n’est qu’un visiteur de passage. ». Implicitement, ce visiteur de passage est le touriste, qui a vocation à fréquenter temporairement le lieu. Le “Wilderness Act” américain établit le “National Wilderness Preservation System” dont la mission est de créer des zones de naturalité, c’est-à-dire des espaces où la nature et la vie sauvage sont protégées. De quoi cette naturalité est protégée ? Parmi les menaces, figurent l’urbanisation, l’industrialisation par l’exploitation des ressources naturelles disponibles dans ces espaces. Dans ces espaces protégés, l’exploitation forestière et minière, la construction de routes destinées aux véhicules motorisés et toutes formes de constructions humaines sont généralement interdites sur un plan légal. Le tourisme est dès lors une des seules activités économiques admises dans ces espaces naturels protégés (Source)
-
une “réserve artistique” est-elle un “lieu sublime” ? Par le mot « sublime », il ne faut pas retenir sa signification contemporaine que l’on pourrait décrire par le plus haut degré de l’élévation et de la beauté, en parlant de choses morales et intellectuelles. Le sentiment du sublime apparaît au cours du XVIIIème siècle, il provient du latin sublimis désignant l’élévation, l’idée de la suspension dans les airs. De par cela, on peut associer le sublime au vertige. Pour reprendre la définition du sublime de Jean-François de Saint-Lambert dans sa théorie des quatre genres esthétiques du paysage (dans son poème “les Saisons”, 1769), le sublime provoque étonnement et craintes. Le sublime est utilisé pour désigner des paysages comme le ciel, l’océan, le désert, des phénomènes météorologiques tels que les orages, les tempêtes et les éruptions volcaniques (Mosser, 2004). Le sentiment de sublime participe à valoriser des paysages vierges du progrès technologique, que l’on décrit alors comme sauvage (Saint-Girons, 2005). (Source)
.
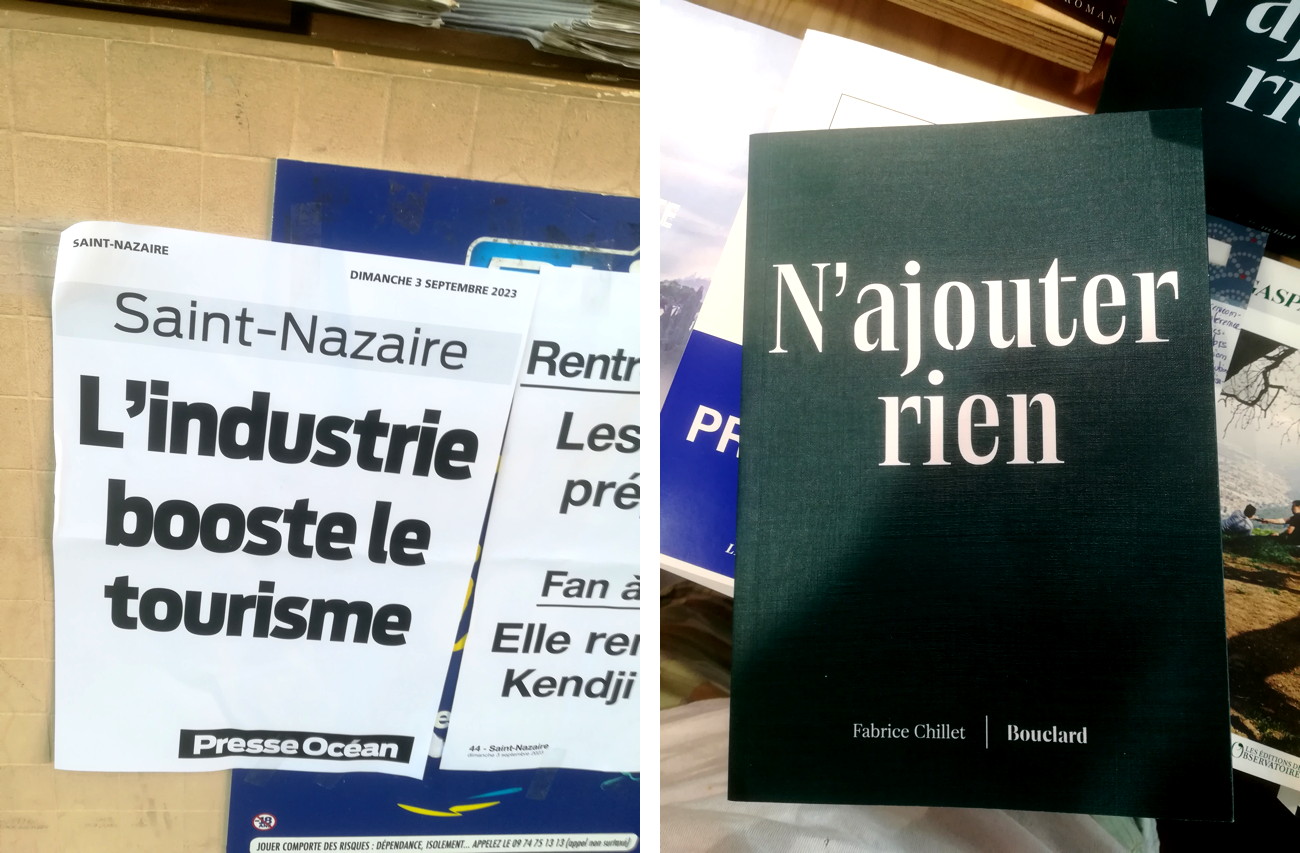
Saint-Nazaire, septembre 2023 : un rébus pris sur le vif : titre du journal du jour, et titre d’un livre dans une librairie.
.
(Les rochers à Fontainebleau)
.
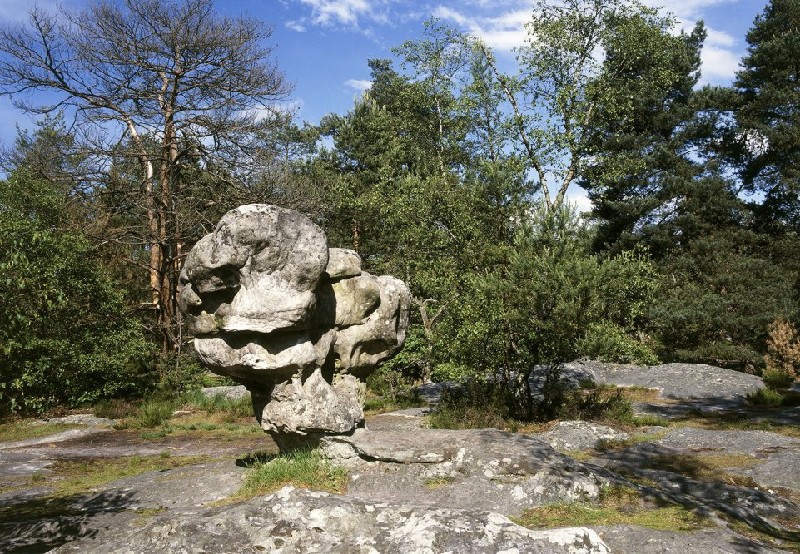

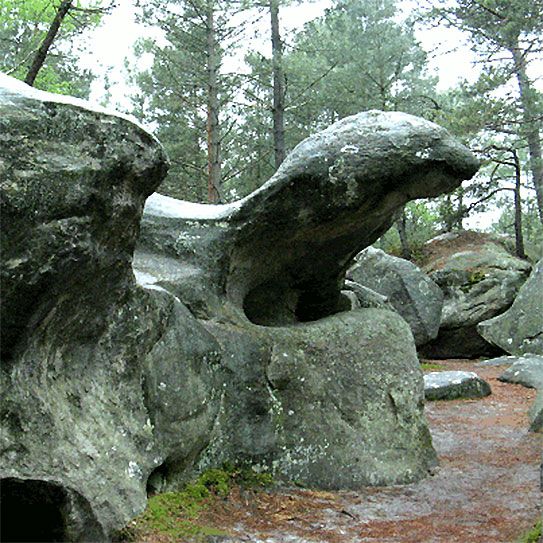


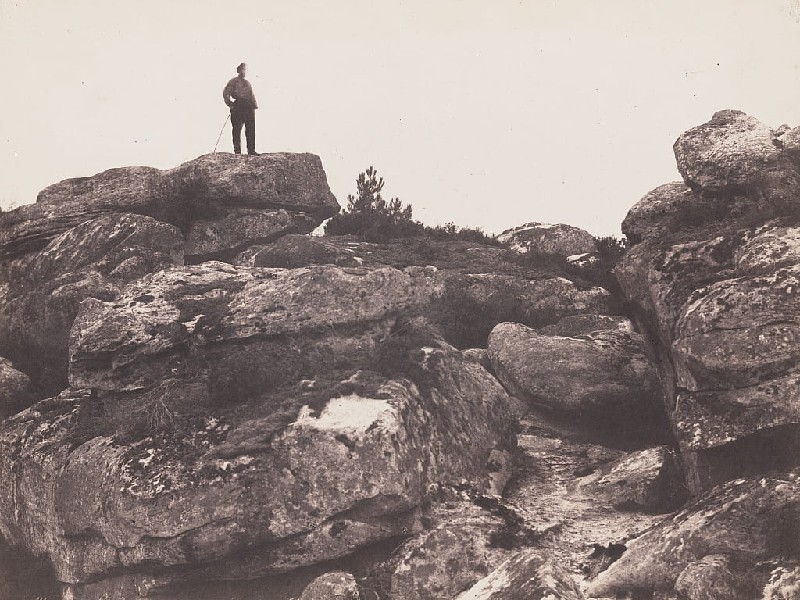
.
.
8
Annexes
.
8a
Définitions des parcs et réserves
Tentons quelques définitions :
-
Les “parcs” (nationaux PN, régionaux PNR) (complétés par les zones Natura 2000 et la biosphère de l’Unesco) sont des territoires de protection de la nature, gérés par la collectivité (territoriale ou/et État) : « territoires relativement étendus, qui présentent un ou plusieurs écosystèmes généralement peu ou pas transformés par l’exploitation et l’occupation humaine, où les espèces végétales et animales offrent un intérêt spécial du point de vue scientifique et récréatif » et qui pour cela font l’objet de mesures de protection dont la logique est celle de la conservation et non de la préservation : « la conservation de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l’atmosphère, des eaux et en général du milieu naturel ». Ce type de protection prend en compte les activités humaines : le pastoralisme ou la randonnée. Les PNR en sont une partie et sont des territoires protégés et habités dont les environnements sont considérés comme fragiles sont associés à des enjeux de développement économique « durable » : ils restent territoires de projet et d’aménagement comme d’urbanisme beaucoup plus que de protection. (Source1)
-
Les réserves (naturelles, dont les réserves biologiques intégrales) ont selon le Code de l’Environnement un cadre plus restrictif : « Espace appartenant à une zone centrale de Parc national dans lequel est décidé, sur vote du Conseil d’Administration et procédure en Conseil d’Etat, un classement ayant pour but l’exclusion de l’homme et de toutes ses activités. Seuls des scientifiques sont autorisés à y pénétrer afin de mesurer l’évolution du milieu sans perturbation d’origine anthropique. »
À l’intersection de ces problématiques, on va retrouver des axes et des faisceaux qui touchent directement les domaines de pratiques de l’art :
- comme par exemple, la question des “résidences” : “Une résidence artistique désigne l’octroi temporaire, par une institution publique ou privée, d’un espace à un artiste, afin de favoriser la création et l’exposition d’œuvres d’art, ou l’élaboration de spectacles vivants ou filmés.” (Wikipedia) ‒ “Une résidence est un lieu qui accueille un ou plusieurs artistes pour que celui-ci ou ceux-ci effectuent un travail de recherche ou de création, sans qu’il n’y ait d’obligation de résultat. La création sera facilitée grâce à la mise à disposition d’un lieu de vie et de création, des moyens financiers, techniques et humains.” (Min. de la Culture)
.
.
8b
Flaubert, la littérature retourne à la forêt, 1868
Pour ce paragraphe nous emprunterons les informations précises apportées par Sylvie Giraud dans son article “Dans les pas de Flaubert en forêt de Fontainebleau” (Flaubert, revue critique et génétique, 2019) :
‒ Avant de se mettre à écrire la troisième partie de “L’Éducation sentimentale” (1869), Flaubert a besoin d’effectuer un repérage précis pour construire un épisode de son roman. Il se rend donc sur place fin juillet 1868. C’est ainsi que l’on voit au travers des carnets qu’il rédige sur le terrain, la “montée en récit”.
Sylvie Giraud commente cela ainsi : ‒ « À la prise de notes, Flaubert pourrait se contenter du simple constat énumératif, quitte plus tard à déployer la matière au fil de la narration. Au contraire, dès le repérage il cherche le point de vue, guette le moment décisif pour saisir le motif, fait vivre les nuances, absorbe la substance des lieux, contextualise les phénomènes, scénarise bon nombre des éléments observés, comme s’il nourrissait déjà la matière romanesque de l’histoire à construire, comme si transposer des événements vécus dans une séquence fictive spécifique lui donnait déjà un sens ou une valeur. »
-
– « hte futaie – feuilles de chêne sèches par terre […] 2 gds arbres dont les troncs se touchent frères Siamois […] le vieux Pharamond […] Des gdes futaies […] Carrefour du bouquet du Roi » (Gustave Flaubert, “Carnet 12”, f° 39 et f° 38v°)
-
– « feuilles de chêne sèches par terre le soleil y fait comme des taches d’or sur un tapis brun » (Carnet 12, f° 39)
-
– « silence […] un petit cri d’oiseau très faible. le cheval souffle – » (Carnet 12, f° 39)
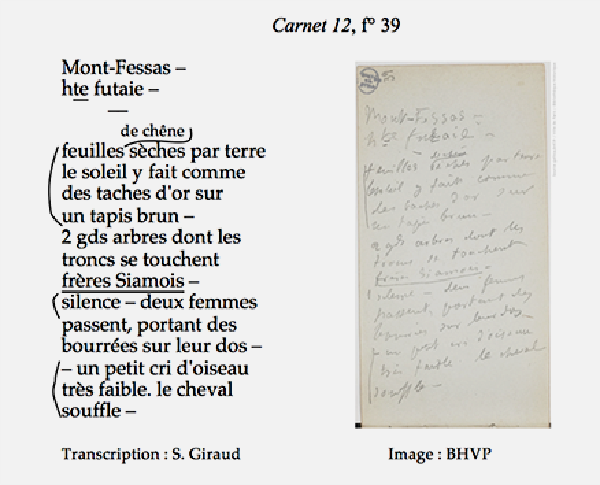
Gustave Flaubert, extrait du carnet 12.
.
‒ « Les notes du carnet soulignent la nature du terrain, identifient l’odeur provoquée par les résineux, enregistrent la vue panoramique : »
-
– « Puis on va – à pied : Le chemin monte entre des pins, avec des roches énormes – extrême odeur de résine – Les racines sur le chemin font des veines saillantes – Plateau – Au 1er plan ; roches plates – en dessous : têtes d’arbres – plaines roussies – Caverne des brigants redescente : les racines sont plus nombreuses – eau dans les trous de rocher » (Carnet 12, f° 36v° et f° 36).
-
– « La futaie de hêtres est très hte – on dirait de colonnes dont les feuillages sont les chapiteaux évasés » (Carnet 12, f° 35v° et 35).
– « Flaubert consigne le paysage extérieur avec soin, l’organisant par plans, du plus lointain au plus proche : »
- – « en face […] à gauche sur l’autre rive […] au loin […] Au 1er plan » (Carnet 12, f° 34) ;
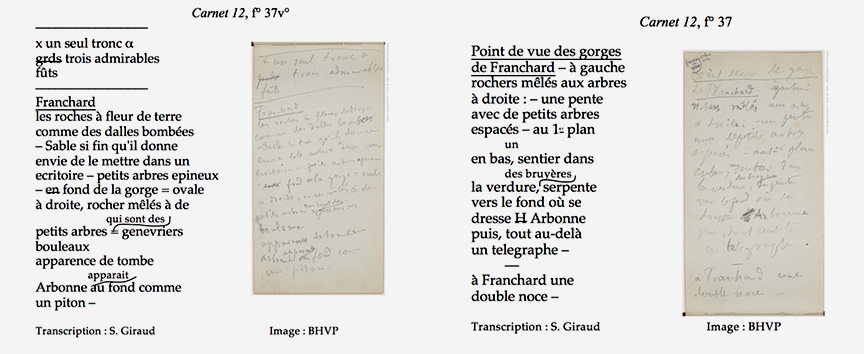
Gustave Flaubert, extrait du carnet 12.
.
– « Dans la partie sud de la forêt de Fontainebleau, les éléments aperçus et notés au fil de la route concernent essentiellement le couvert végétal, la configuration topographique, la structure géologique : »
- – faible variété des plantes : « beaucoup de bruyères en fleurs […] bruyères et fougères dont qques unes, brûlées, font comme de l’or […] à de certaines places l’herbe est rase comme un tapis de billard vert rapé » ;
- – présence de sable et de rochers : « Les ventes Heron – sables […] (dans les tranchées, le sable coupé est si fin α si dense qu’il ressemble presque à du pain) […] Le long Rocher est à gauche – lande. puis une banque semée de gros rochers […] les rochers sont très gris » ;
- – densité arboricole : « La petite haie = Futaie insignifiante. […] à notre gauche = petite futaie […] Mare aux Fées gde flaque d’eau couverte de lentisques au milieu d’une mince futaie ».
.

Alexandre Famin, “La Mare à Dagneau (?)”, “Mare aux Fées”, 1870 ou 1874. .
Sylvie Giraud en conclut que : « Les notes du carnet sont liées à deux dimensions : le cadre naturel avec son protocole prosaïque (la chose vue et éprouvée), et le cadre fictionnel au statut plus lyrique (la valeur romantique potentielle) ; ainsi, la forêt de Fontainebleau s’avère-t-elle l’enveloppe parfaite pour soumettre les éléments réels aux techniques d’écriture du courant romantique saturé de discours hyperboliques, d’images conventionnelles, de clichés plastiques, d’éléments mystérieux et fantastiques. »
.
(Source) (Sylvie Giraud, “Dans les pas de Flaubert en forêt de Fontainebleau”, in Flaubert, revue critique et génétique, 2019)
(Source) (Carnet 12 de Gustave Flaubert, folios 27 à 39, pdf).
(Source) (Le programme de recherche franco-allemand, « Flaubert et le pouvoir des images » (FLIM), a pour enjeu nouveau d’explorer les relations de Flaubert et de ses écrits à l’image)
(Source) (archives photographiques et lien entre Flaubert et George Sand, lettre, Gorges de Franchard)
(Source) (*« J’ai été deux fois à Fontainebleau, et la seconde fois, selon votre avis, j’ai vu les sables d’Arbonne. C’est tellement beau que j’ai “cuydé” en avoir le vertige. ») (Lettre à George Sand, 10-08-1868)
.
.
8c
La photographie bellifontaine ou fontaineblesque, 1849
Bernard Marbot, “Les photographes de Barbizon”, Paris, Hoëbeke/Bibliothèque nationale, 1991.
« En 1849 ou 1850 Le Gray entre dans la forêt de Fontainebleau avec l’appareil et le tripode. De même que “les hommes ont pris dans les forêts la première idée de l’architecture”, il va y recevoir la révélation de la photographie. Cette forêt que Denecourt voit parfois comme un vaste studio proposé aux artistes se présente à Le Gray comme une immense chambre noire semblable à la camera obscura transportable d’Athanase Kircher. L’effort mental qu’il consent en s’y introduisant afin d’en apprendre les mystères et d’en assimiler les rites lui est d’autant plus aisé que l’ombre et la lumière interfèrent en ces lieux aussi puissamment que dans le processus d’obtention de l’épreuve allant de la prise de vue au tirage. »
.

Charles Bodmer, 1874, Musée d’Orsay.
.

Gustave Le Gray, “Fontainebleau, chemin sablonneux montant”, vers 1856, MET Museum.
.
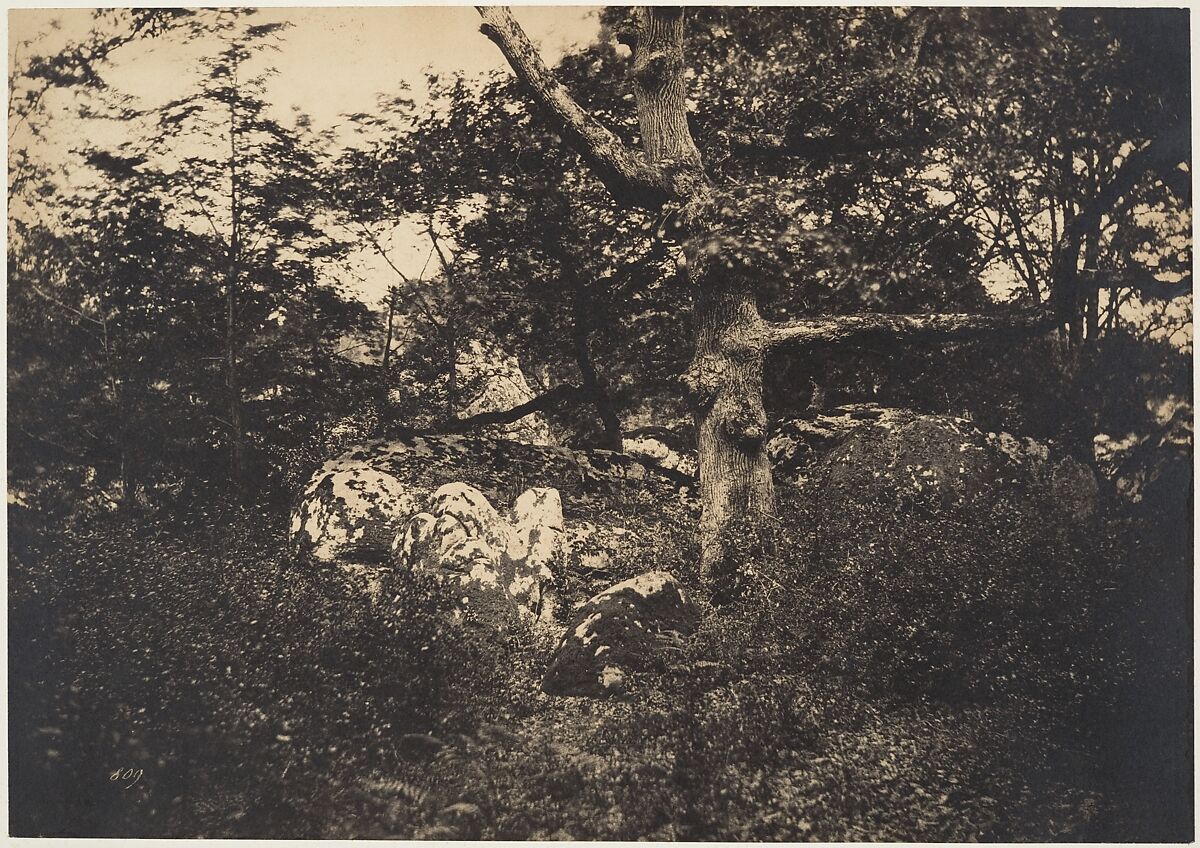
Gustave Le Gray, “Chêne dans les rochers à Fontainebleau”, 1849-1852, MET Museum.
.
(Source) (Sylvie Aubenas, “Gustave Le Gray, Les paysages : la forêt de Fontainebleau, 1852-1856”, BNF)
(Source) (MET Museum, Gustave Le Gray)
(Source) (MET Museum, Gustave Le Gray, photographies prises à Fontainebleau)
.

Achille Quinet, “Étude de ciel (Étude d’après nature N° 218), 1875.
.

Eugène Cuvelier, “Carrière de grès”, 1863.
.

Eugène Cuvelier, “Deux chênes en hiver”.
.

Eugène Cuvelier, “Tronc de pin sylvestre”, vers 1860.
.
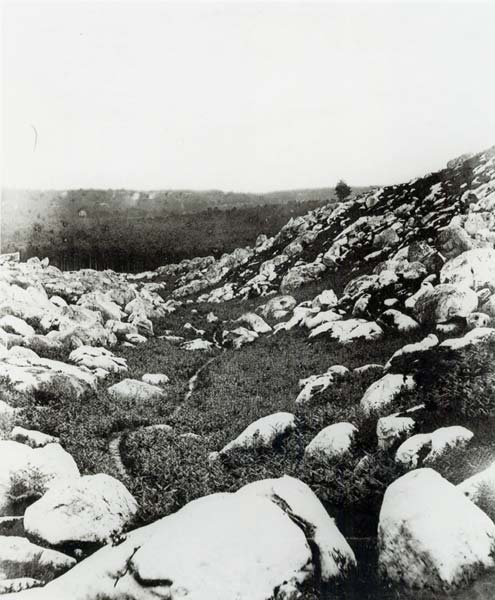
Georges Balagny, “Chaos des gorges d’Apremont”, vers 1877.
.
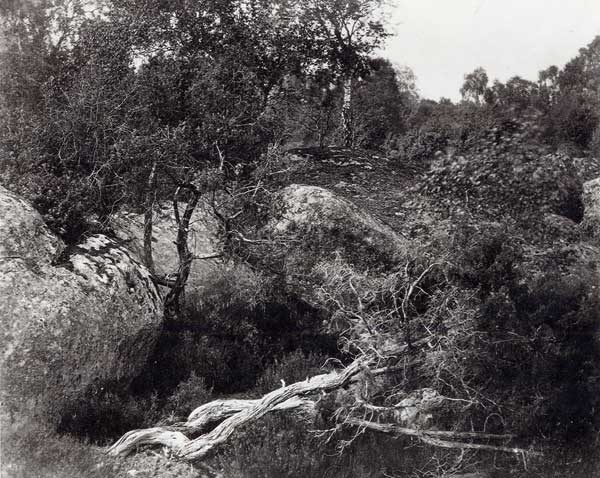
Achille Quinet, “Arbres morts et bouleaux”, vers 1868.
.

Eugène Cuvelier, “Platière d’Arbonne”.
.
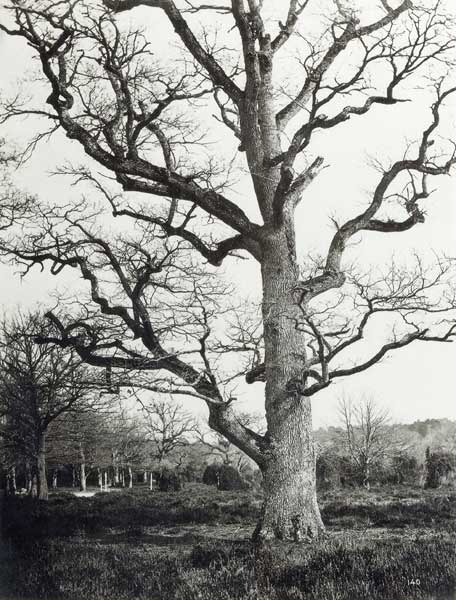
Achille Quinet, “Chêne dépouillé de sa parure”, vers 1875.
.

Achille Quinet, “Ajoncs et roseaux”, vers 1875.
.

William Drooke Harrison, “Près de la mare à Dagneau, le chêne “l’Empereur” (?)”, vers 1870.
.

Eugène Cuvelier, “Verdure”, vers 1863.
.

Eugène Cuvelier, “Arbres et roches moussues”.
.

John B. Greene, “Forêt de Fontainebleau”, vers 1852.
.

John B. Greene, “Forêt de Fontainebleau”, vers 1852.
.

John B. Greene, “Forêt de Fontainebleau”, vers 1852.
.

Gustave Le Gray, “Fontainebleau. Sous-bois au Bas-Bréau”, vers 1872.
.

Eugène Cuvelier, “Blocs de grès enchevêtrés au milieu des sables”, 1863.
.
.

(Camille Corot, “Fontainebleau, en forêt”(vers 1823-1824), Bristol Museum & Art Gallery, Gallery 2).
.
.
Menu :
chantier du P 06/2023
chantier du P 07/2023
chantier du P 08/2023
chantier du P 08/2023 - poème 1
chantier du P 08/2023 - poème 2
chantier du P 08/2023 - poème 3
chantier du P 08/2023 - résidence artistique et gentrification : Le P barbizoné
chantier du P 08/2023 - Spinoza à Bruga Braga
chantier du P 08/2023 - Le P-Bruga Braga
chantier du P 09/2023
.
.
.
.
- open summer
- chantier
- paysage
- asso
- le catalogue
- les avatars
- scène de film
- principe associatif
- la lémancolie
- psycho-géographie
- écolonomie
- attrition
- hypothèse
- jardin
- 105
- définition
- libre-lieu
- krn
- plat
- architecture
- le P
- historique
- plan
- matta-clark
- rosenberg
- heinich
- menger
- luc boltanski
- waou
- héhodrome
- LISE
- proust
- le pourpre
- PLAT
- NEM
- barbizon
- sand
- victor hugo