LE PROJET NEUF
2023-07-03/08-10 - prolégomènes III-A au ouesterne : zapper kafka à kaffa (réciétude 1)
.
Études pébipologiques.
Qu’est-ce qu’un récit-étude ?
.
chronologie des prolégomènes :
.
.
Un menu :
.
1
Un réciétude (1)
.
Cet article sur Kafka à Kaffa est devenu par digressions successives une série d’articles…
‒ précisons : il y en aura ici douze ou treize, et l’ordre du blog étant en ordre chronologique inverse, le dernier écrit se trouvera paradoxalement être le premier à lire, c’est-à-dire que la série de chroniques et de feuilletons sera peut-être lue dans le sens de “IIIl” à “IIIa” en suivant scrupuleusement l’ordonnancement visuel (et l’ordre désalphabétique des sombreros et des chapeaux de cow-boy colorés et envolés un à un différemment par un vent imaginaire), alors qu’en renversant la chronologie interne du blog et en la prenant à rebours ‒ renverser, inverser : ce qui est dans la plupart des cas une méthode toujours efficace pour résoudre un problème épineux ‒, donc, en cliquant sur le dernier sombrero (le bleu “IIIa") de la liste, on retrouvera un meilleur sens de lecture : de “IIIa” à “IIIl” ; néanmoins il sera intéressant de voir comment l’écriture et la rédaction de ces articles intégrera ces deux boucles, de “l” à “a” et de “a” à “l”, et ces deux sens de la lecture, afin que le tout reste compréhensible quel que soit ce sens ; cela vérifie l'esprit charade et anamorphique de La Pébipologie… ‒,
…une série d’articles donc, listés comme autant d’entrées et de passages décrits et commentés autour d’une hypothèse d’homophonies et d’associations périlleuses et hasardeuses (qu’on dira alla Pérec ou au voisinage de Gargas Parac le bien nommé, acrobate et “joycien soft”, qui après avoir disparu dans l’E réapparaît dans les A avant de faire un livre que de E <1>) ‒ (suivre les notes de bas de page),…
‒ au passage, voici ‒ et cela, en complément des titres et génériques déjà utilisés : “franz kafka spinoza”, “franz scalpa spinoza”, frank zappa spinola”, “kafka à kaffa” ‒ celles que vous avez évitées et qu’avec ténacité nous avons continué d’élaborer en modulant le plus possible les jeux monovocaliques :
‒ “Frank cala et caracola à Caracala”
‒ “Franz cavala au hasard et à dada le spleen osa”
‒ “À Kaffa Spino laqua le kayak à Frank”
‒ “Zappa rata, passa, sombra à Lhassa et zona”
.

.
… tout un imbroglio de bouts de phrases qui, au lieu d’analyser les récits qui en sont générés et qui ont été écrits sur ces deux dernières années, a en définitive tourné à l’avantage de l’écriture et de l’élaboration d’un nouvel épisode : l'épisode 20 du ouesterne spinoza ‒ ce qui peut paraître un véritable tour de force vu l’ampleur que prend au fur et à mesure la chose ‒. C’est ainsi un nouveau texte-épisode-feuilleton qui a pris forme, plutôt qu’une étude spécifique et circonstanciée destinée à soutenir une argumentation littéraire autour du récit général dudit ouesterne ‒ dans lequel, pour info, vous ne retrouverez aucun Kafka ni Zappa ni Kaffa mais bien : l’unique Spinoza / Spinola.
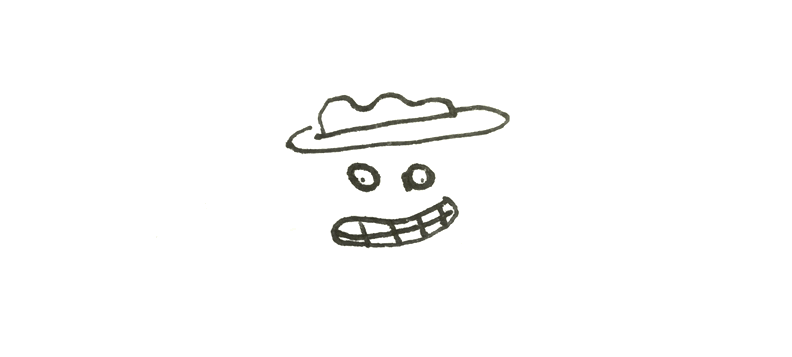
Si cela avait été réellement le cas (de faire étude) on aurait en conséquence tout fait pour essayer d’élucider et d’examiner ce dernier (= ce récit donc cette histoire) avec des méthodes davantage éprouvées pour tenter de comprendre :
- en quoi est-il récit ? et de quoi est-il le récit ?
- et qu’est-ce que “faire des histoires” ? de surcroît : “faire des histoires” à partir “de rien” ou d’aussi peu ?
afin d’étayer parallèlement un meilleur fondement concernant son origine :
- par exemple, sur : comment tout cela était-il né “pébipologiquement” à partir du site du P ?
.
2
Panorama P
.

Sur le site du P en 2020.
Ce site, celui-là même qui se présente devant nous ce site et ce P ‒ à la fois surface lunaire, bord de cratère d’un volcan gigantesque, comme également plan-plateau, d’une époque reculée et vus d’ici bosselés, mamelonnés car modelés d’innombrables reliefs-fossiles de faible élévation arrivés ou déposés là après avoir été délicatement et depuis longtemps endigués et repoussés sur le bord et par le temps, et si doucement qu’on les voit tels des affleurements vaguement ondulés et engourdis qui, entre eux et parfois, laissent s’étendre une plate-forme-amphithéâtre-arène-clairière, aplanie et large, qui s’élargit encore et encore jusqu’à englober tout le site remisant les reliefs de tout à l’heure à de passagères modulations internes et mouvantes du plan général celui-ci situé visiblement et maintenant après coup, succédant à la première vision et à la première approche, en plein milieu d’une immense sierra suspendue entre d’apparents ou d’imaginaires canyons qui ont dû autrefois en des âges très lointains faire barrages ou écrans, digues interminables et épais glaciers, telles des gorges étroites qui après avoir été disloquées se sont lentement compactées, tant et tant qu’elle, cette étendue circonscrite et néanmoins extensive, semble aujourd’hui interrompue par eux ‒ dont l’observation et la pratique plus ou moins quotidiennes ‒ impliquant d’un côté le travail journalier de cette histoire narrée, et, d’un autre, celui que requièrent ces traversées, cavalcades et excursions, en zigzaguant de bout en bout et en de multiples sens sur tout le terrain ‒ tourneront à ce nous appelons un récit-étude, abrégé en réciétude.
Mais, rassurez-vous, rien d’étrange à tout cela.
Puisque, en filigrane de cette patience et de ce retrait, que l’on peut confondre avec un presque-sommeil, on confie que : « j’ai comme vous-même j’imagine besoin de pas mal de silence et de distance » pour pouvoir faire avancer lentement quelque chose.
Alors, tout simplement, au long de ces pages et articles énigmatiques, le doigt levé comme pour montrer et désigner d’un signe telle ou telle chose <2>), on dira qu’on contourne des écueils et d’évidents obstacles, des hics et des couacs.
On dira aussi que tout bonnement on inverse ou renverse des difficultés et des impossibilités, et qu’en fait : on s’enlève délicatement des épines, comme on défait, déplie et démêle des nœuds, et qu’on “zappe”.
Idem : sur le site du P en 2020.
.
.
3
Kafka zappa Kaffa
Annoncer qu’on “zappe”, c’est dire que l’on suppose et que l’on montre ici des alternatives (qu’on appelle sapantes et zappageuses), autrement dit qui sapent de nombreux attendus et qui de surcroît zigzaguent, font tapages et zappages, et ondulent entre ce qui est connu et reconnu (car on sait à peu près ce qu’est un western, on sait à peu près qui est Spinoza, non ?), et cela afin de mieux pénétrer et entrer dans ce ouesterne qui selon toute vraisemblance, et à force de le dire et d’en parler, donne l’air de se dénouer autour d'une hypothèse uchronique impliquant une figure somme toute quichottesque, dénommée Spinoza (Spinola), et qui, tout autant, dans le même pas, propose d’ouvrir une brèche optimiste et inouïe dans notre futur sombre et miné, car, on s’en persuade, c’est sans doute l’imagination la plus extrême qui offrira des issues heureuses et qui nous sortira des ornières ‒ mais pas sûr que, dans un pareil mouvement, et que dans la foulée, les collines redeviendront verdoyantes.
Mais toute hypothèse quelle qu’elle soit reste troublante et tremblante : ça slalome, ça sinue et serpente. Ça fait bouger les lignes.
.

René Daumal, “Le Mont Analogue” (1939-1944).
Car, là, en effet, aucun confort intellectuel ne sera la règle (une règle ou une habitude visiblement assimilable à une convention qui permettrait de rester à l’abri et coupé de pareilles turbulences qu’on pourra trouver oiseuses). Car, là non plus, il ne s’agit pas de faire cas d’une convenance personnelle usant et jouant à outrance et par provocation gratuite du non-sens, de l’absurde, du flou et du vague, ou, si l’on amplifie et exagère, d’un certain “vaguement flou”, le tout allant de la sorte créer une gabégie débordante et obscure de perceptions et de réflexions, ne permettant que d’avancer à tâtons, avec, comme souvent, les mains tendues en avant ‒ alors que Spinoza nous intime à s’appuyer sur « le soleil pour s’éclairer » <3>.
.
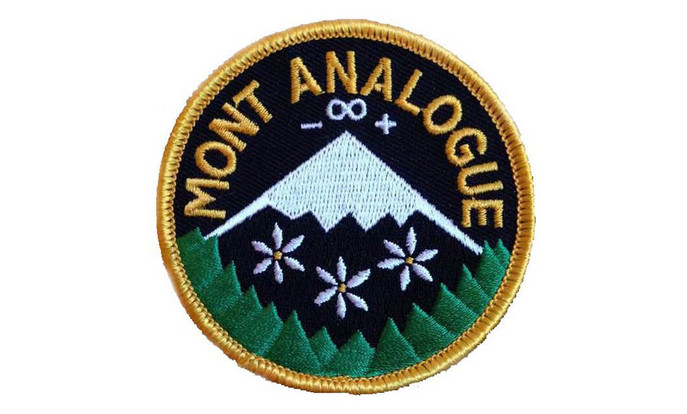
.
Car remarquons que si, en premier lieu, nous avions pu aborder dans des articles antécédents (à lire ici) les toutes premières ébauches de ce qui a permis par la suite d’élaborer les 10 épisodes du début des aventures de Spinoza au P avant qu’ils ne deviennent au fil des articles la véritable écriture d’une saga, c’est-à-dire “le” ouesterne spinoza, c’est bien plus tard, par le biais de plusieurs observations spéculatives et interrogatrices au sein de ces articles successifs que l’on vous propose maintenant, que le travail s’est trouvé prolongé dans des investigations et des recherches, toutes aussi sérieuses les unes que les autres.
C’est ainsi que, tout en déjouant la surprise, nous nous sommes lancé dans l’abord d'une série d’études appelées judicieusement “prolégomènes"<4>.
Autrement dit, ce qui par sympathie accompagne et prévient l’entrée sur un terrain apparemment vague et tourmenté.
Attention, ça souffle, tenez bien votre chapeau…
.
.
.
4
Les méthodes pébipologiques
‒ “Le cas raplapla de Francesca Zappa Spanizo Abracadabra."
(Aphorisme du “ouesterne spinoza”)
.
Ces prolégomènes, prémices et préambules contenus dans la fabrication de récits, nous ont permis d’élaborer des associations et des correspondances <5> nous autorisant ‒ à partir de jeux de langage, d’assemblages bissociatifs <6> et d’examens philologiques et iconographiques ‒ à comparer et à combiner astucieusement des pratiques :
- 1/ d’écriture, outils et processus narratifs, à celles :
- 2/ potentielles et hypothétiques, que l’on suppose avoir été menées par des personnages inventés et convoqués dans les récits (en l’occurrence, Spinoza Spinola, Gombro, Danti, Nabok, etc., figures toutes présentes à un moment ou à un autre dans le récit ouesterne), comme à celles :
- 3/ plus étranges, menées par des figures historiques que l’on déplace jusqu’au P (Spinoza donc, Gombrowicz, Dante, Nabokov, comme aussi Kafka, Zappa, etc.) et que l’on fait se croiser et dialoguer les unes avec les autres selon des curseurs énigmatiques qui les font apparaître là où on ne les attendait pas, comme si, dans cette histoire commentée par cette série d’articles, Kafka suivant Spinoza Spinola n’avait pas eu le temps de passer à Kaffa et qu’il l’avait donc “zappé”, et d’autres encore :
- 4/ davantage concrètes, imaginatives et interprétatives, et que l’on prête à notre lectorat, qu’impliquent la lecture ‒ puisque lorsqu’on lit s’ouvre un monde ignoré ;
bref, on tentera ici d’explorer tout ce qui peut donc se rassembler dans cet art délicat et fluide de mélanger les rôles et de changer les statuts, tel que, ne les perdons pas de vue, le préconisent la méthode associative de La Pébipologie et sa propre stratégie du filet, et comme aussi l’intiment les va-et-vient entre les performances d’écrire et de lire de façon orale les épisodes successifs de la saga qui se crée ‒ et sur ce point précis on se penchera sur la nouvelle initiative de la Maison d’Édith et d’Ada ‒ quand, recto tono, Évandre s’adresse à voix haute à Énée <7> <8>.
.

Évandre raconte les origines de Rome (Virgile, “L’Énéide”, Strasbourg, 1502), Jean Grüninger (1482-1531), Sébastien Brant (1458-1521), détail, gravure sur bois, Heidelberg, Universtätsbibliothek. Au moment de rentrer dans sa ville de Pallantée, Evandre raconte à Énée les origines de cette terre, peuplée d’abord de faunes. ‒ (Virgile, “L’Énéide', Livre 08) ‒ (Source)
.
Et ceci nous allons le faire :
• 1/ en convoquant dans les articles ici, Kafka et Zappa <9> <10> au côté de Spinoza Spinola, et de bien d’autres cité.e.s plus haut et dans les articles précédents ;
.

Quatre chapeauté.e.s ‒ (Eureka, Colorado, circa 1900, par William Henry Jackson) ‒ (Source).
.
• 2/ par l’utilisation, entre autres, de la méthode wittgensteinienne du canard-lapin <11> (ou zap-zap <12> <13> tel que Pline l’Ancien le rapporte dans son “Histoire Naturelle” : « dans un bloc qu’on fendit avec des coins, apparut une figure de Sylène ») (Source1 ; *Source2 <14> ;

Un canard-lapin dans le ciel : la paréidolie ange ailé / nuages.
.
• 3/ plus une autre, quelque peu absurde nous en convenons, celle de la chapologie <15> ou de la théorie pébipologique du chapeau = c’est-à-dire de l’étude analogique et iconographique des ports de chapeau par ces mêmes personnes et personnages respectifs :
.

Au sol, le chapeau de Tom Mix, l’acteur fétiche des premiers westerns et le don quichotte de l’ouest.
.
.
Eh bien passons d’abord en revue les deux derniers points que nous avons listés ci-dessus ;
• le premier, sur cette page-ci, en examinant par images ce qui fait que du P on voit la Hollande comme si Spinoza Spinola avait emprunté le Tardis du Dr. Who pour naviguer sans cesse entre les deux zones, Hollande et P, par-delà le temps et l’histoire, vérifiant ainsi que le site a bien les caractéristiques canard-lapin ;
• le second, sur cette autre page, en creusant cette histoire de chapeautage et de chapologie au-delà du simple feutre et du banal geste de glissement sur le bord du couvre-chef, puisque chaque chapeau amène indubitablement de l’eau au moulin au principe du trou et de la butte, principe qui fait partie des fondations de La Pébipologie…
.
.
.
.
————
notes
[1] — Georges Perec (aka Gargas Parac), « What a Man ! » (1980), in “Atlas de littérature potentielle, Oulipo”, éd. Gallimard, coll. Folio, 1981, pp 214-215. « What a Man ! » est un monovocalisme en « a » : la seule voyelle autorisée est le « a ». Ainsi Georges Perec signa sous le nom de Gargas Parac. Il inventa 4 à 5 pages d’une histoire de bagarre. Ce récit mini-épopée se compose en trois parties : un prologue, un flash-back et un épilogue des aventures d’Armand d’Artagnan, « crack pas bancal, as à la San A », qui, après avoir mis à l’ombre le hors-la-loi Andras Mac Adam pour l’assassinat d’un certain Max van Zapatta accumule les exploits jusqu’à ce qu’un « banal anthrax nasal » le fasse passer de vie à trépas. En résumé, « What a Man ! », qui se déroule essentiellement dans l’Arkansas et dans la pampa, est l’histoire d’un « match pas banal : Andras MacAdam, campagnard pas bavard, bravant Max Van Zapata, malabar pas marrant », un troisième protagoniste, Armand d’Artagnan, arbore lui aussi la panoplie de l’aventurier tout terrain qui curieusement, et ce qui nous arrange dans notre conte hyperbolique du “ouesterne spinoza” où l’on voit “Kafka zapper Kaffa”, adapta « Franz Kafka à l’Alhambra » : un western opérette ou de pacotille sans aucun doute. Gargas Parac semble reprendre le célèbre aphorisme de Raymond Queneau (1903-1976), « Y’a pas de la rigolade, il y a aussi de l’art » (énoncé par Gabriel dans “Zazie dans le métro” (1959), p.224), repris un peu plus tard par Jacques Jouet, « Chez Queneau la rigolade n’est pas spontanée, elle est un produit volontaire de l’art » (dans “R. Queneau, qui êtes-vous ?”, La Manufacture, Paris, 1988, p.126), Raymond Queneau qui disait de Pérec qu’il restait un “joycien soft”, plus “convivial”, et si l’on peut dire, d’une complexité plus simple. Pérec fait disparaître le E dans “La Disparition” (1969), n’utilise que des E dans “Les Revenentes” (1972) puis que des A dans “What a Man” (1980). Par ailleurs, son roman “Un cabinet d’amateur” (1979) (Source2 ; Source3) est une référence majeure de La Pébipologie ‒ (Source1 ; Source2) ; Source3) ‒ <retour>
[2] — On fait référence ici et dans tout ce passage à Julien Gracq dans son livre “La Presqu’île” (1970), chap. 1, “La Route”, pp.9-26 : « La route de loin en loin, désincarnée continuait à nous faire signe, comme ces anges énigmatiques des chemins de la Bible qui, loin devant, du seul doigt levé faisaient signe de les suivre, sans daigner même se retourner. » ‒ <retour>
[3] — Spinoza, Éthique, selon la méthode géométrique et divisée en cinq parties (1677), Première partie : De Dieu, proposition XXXVI, “Rien n’existe qui de sa nature n’enveloppe quelque effet”, appendice — traduction française de Saisset, 1849. « Or, les hommes venant à rencontrer hors d’eux et en eux-mêmes un grand nombre de moyens qui leur sont d’un grand secours pour se procurer les choses utiles, par exemple les yeux pour voir, les dents pour mâcher, les végétaux et les animaux pour se nourrir, le soleil pour s’éclairer, la mer pour nourrir les poissons, etc., ils ne considèrent plus tous les êtres de la nature que comme des moyens à leur usage […] ». (Source) ‒ <retour>
[4] — prolégomène : Longue introduction placée en tête d’un ouvrage, contenant les notions préliminaires nécessaires à la compréhension dudit ouvrage. ‒ <retour>
[5] — L’association permet de formuler des idées par une mécanique de rebond, plutôt qu’en suivant une logique linéaire. Elle consiste à associer des mots, des images ou des idées entre eux, jusqu’à en oublier l’objectif initial, pour ensuite y revenir progressivement et formuler une solution. Plus qu’un outil, c’est un principe fondateur de la créativité, sur lequel il faut s’entraîner régulièrement. (Source : Méthodologie, La Boîte à outils de la Créativité, Chapitre IX : Les techniques de rencontres forcées, Fiche 04 : L’association, Éd. Dunod, 2017) ‒ <retour>
[6] — La bissociation consiste à créer des flashs créatifs en bissociant des solutions, des idées, des mots (à ne pas confondre avec associer simplement deux éléments). La bissociation associe plutôt les fonctionnalités des objets et non les objets eux-mêmes. Créer, c’est " bissocier " selon l’approche d’Arthur Koestler (Le cri d’Archimède, 1955). La bissociation est un néologisme qui désigne un " assemblage original et pertinent d’éléments préexistants “. Elle est une manière de secouer et de mêler ce qui était séparé auparavant, de combiner deux idées, deux solutions ou deux univers parfois très étrangers a priori, afin d’en créer un troisième, inédit. ‒ <retour>
[7] — Virgile, Énéide (19 av. J.-C.), Livre VIII, 350-369, traduction Charles Nisard, 1868. « Ce bois, dit Évandre, cette colline au sommet verdoyant, un dieu (lequel ? on ne sait), mais un dieu y réside : les Arcadiens croient y avoir vu Jupiter lui-même, alors que de son bras droit il agitait souvent sa noire égide, et qu’il rassemblait les nuages. Plus loin vous voyez des murs çà et là renversés ; ce sont les restes de deux cités, monuments des anciens héros qui les ont habitées. L’une fut bâtie sur ces hauteurs par Janus, l’autre par Saturne ; celle-ci portait le nom de Saturnie, celle-là de Janicule. » Ils approchaient, s’entretenant ainsi, de l’humble demeure d’Évandre ; ils voyaient des troupeaux épars errer là où est le forum romain ; des taureaux mugissaient au milieu des splendides Carènes. Lorsqu’ils furent arrivés à la demeure d’Évandre : « Ce seuil, dit le roi arcadien, Alcide vainqueur l’a franchi ; c’est là le palais qui l’a reçu. Osez comme lui, ô mon hôte, mépriser les richesses ; et vous aussi montrez-vous digne d’un dieu, et ne regardez pas d’un œil dédaigneux notre pauvreté. » Il dit et conduit sous l’étroite porte de sa demeure le grand Énée, et l’invite à s’asseoir sur un lit de feuillage que couvre la peau d’une panthère de Libye. Cependant la nuit se précipite, et enveloppe la terre de ses sombres ailes. ». (Source) ‒ <retour>
[8] — Recto tono : « sur un ton droit, uni », manière de lire ou de réciter un texte à voix haute, sur la même note et en gardant l’accent tonique (expression spécialement utilisée dans la liturgie catholique romaine, notamment dans les monastères). (Source) ‒ <retour>
[9] — “The Chrome Plated Megaphone Of Destiny”, dans l’album The Mothers of Invention, We’re Only In It For The Money (1968), a précédé “Dio Fa” que l’on trouve dans l’album posthume de Frank Zappa “Civilisation Phase III” (1994) (le dernier qu’il ait conçu). Dans ces deux morceaux, Zappa a réalisé une version musicale de la herse, l’instrument de torture imaginé par F. Kafka dans sa nouvelle “La colonie pénitenciaire” (1914, publiée en 1919) (Source 1 : Frank Zappa lui-même sur la pochette de “We’re Only In It For The Money” dans les notes relatives à la chanson “The Chrome…") (Source 2 : Louise Morand, La morale de l’histoire… Quelques horizons esthétiques de Frank Zappa, dans revue Circuit, 14(3), 2004, pp. 73-90) : tout condamné est installé sur le lit, et la herse, dirigée par la dessinatrice, inscrit sur son corps l’article du règlement que le condamné a violé. Ce travail d’écriture, de torture, dure douze heures (Source : Nicolas Bareït, Lire Kafka après Foucault : In der Strafkolonie, Dans Revue de science criminelle et de droit pénal comparé 2016/2 (N° 2), pages 255 à 261)
https://www.erudit.org/fr/revues/circuit/2004-v14-n3-circuit3618/902328ar.pdf
https://www.cairn.info/revue-de-science-criminelle-et-de-droit-penal-compare-2016-2-page-255.htm
https://www.donlope.net/fz/lyrics/We're_Only_In_It_For_The_Money.html
https://www.donlope.net/fz/notes/We%27re_Only_In_It_For_The_Money.html
https://www.donlope.net/fz/lyrics/Lumpy_Gravy.html
https://www.donlope.net/fz/notes/Lumpy_Gravy.html
https://www.donlope.net/fz/lyrics/Cruising_With_Ruben_and_The_Jets.html
https://www.donlope.net/fz/notes/Cruising_With_Ruben_and_The_Jets.html
https://www.donlope.net/fz/lyrics/200_Motels.html
https://www.donlope.net/fz/notes/200_Motels.html
https://www.donlope.net/fz/lyrics/The_Perfect_Stranger.html
https://www.donlope.net/fz/notes/The_Perfect_Stranger.html
https://www.donlope.net/fz/lyrics/Francesco_Zappa.html
https://www.donlope.net/fz/notes/Francesco_Zappa.html
https://www.donlope.net/fz/lyrics/Jazz_From_Hell.html
https://www.donlope.net/fz/notes/Jazz_From_Hell.html
https://www.donlope.net/fz/lyrics/London_Symphony_Orchestra.html
https://www.donlope.net/fz/notes/London_Symphony_Orchestra.html
https://www.donlope.net/fz/lyrics/Civilization_Phaze_III.html
https://www.donlope.net/fz/notes/Civilization_Phaze_III.html ‒ <retour>
[10] — On trouve par ailleurs une autre allusion à cette proximité entre Franz Kafka et Frank Zappa : la citation attribuée à Zappa “Dans la lutte entre toi et le monde, parie sur le monde” est en fait de Kafka ; on la retrouve à la page 456 du tome 4 des “Œuvres complètes” de Franz Kafka dans l’édition de La Pléiade sous la forme “Dans le combat entre toi et le monde, seconde le monde”. Peut être Frank Zappa aimait-il citer ce mot. (Source). De même, il y a un doute sur cette autre citation : “Si j’en juge par vos cheveux longs, vous êtes une fille ? et Zappa répondit : Et si j’en juge par votre jambe de bois, vous êtes une table”. ‒ <retour>
[11] — Le canard-lapin a aussi été étudié en psychologie, d’abord par Joseph Jastrow en 1900, puis par Ludwig Wittgenstein qui s’en sert pour montrer l’importance de l’expérience dans la formation d’un concept en faisant remarquer que quelqu’un qui n’aurait jamais vu ou entendu parler de lapin ne pourrait pas voir la seconde image. En effet, il est certainement possible d’expliquer pour quelle raison l’individu ne peut pas appréhender dans une même figure en même temps une tête de canard et une tête de lapin. Il est possible d’en donner telle ou telle explication physiologique. Mais c’est la description du changement d’aspect, des expressions qui lui sont associées, etc., qui permet d’obtenir une conception plus ample du phénomène du « voir ». Qu’est-ce que le voir compréhensif ? Et à quels emplois linguistiques correspond ce que nous appelons « voir » dans la pratique du langage ? Quelles sont les expressions propres à ce voir ? L’image du canard-lapin a été publiée le 23 octobre 1892 dans un journal satirique munichois, le “Fliegende Blätter”, puis, re-publiée dans le journal new-yorkais “Harper’s Weekly”. Par la suite, elle a été reproduite en 1900 dans “Fact and Fable in Psychology” (fig. 19) pour illustrer l’importance du cerveau et de la culture dans la perception visuelle par le psychologue américain Joseph Jastrow que nous avons cité plus haut. Ultérieurement commenté donc par le philosophe Ludwig Wittgenstein dans ses “Investigations philosophiques” (posthume, 1953) il a été encore par l’historien de l’art Ernst Gombrich dans son livre “L’Art et l’illusion” ((sous-titré “Psychologie de la représentation picturale”) (1960), lui permettant de développer le concept de « voir-comme » (« seeing-as », « interpreting-as » ou « understanding-as ») qui sera enrichi par d’autres chercheurs à l’aide de différentes hypothèses complémentaires : le « voir-dans » ou « seeing-in » (Richard Wollheim, “Art and Its Objects”, 1980) (Tertium non datur ? rabbit or duck ?), le « make-believe » (Kendall L. Walton, “Mimesis as Make-Believe - On the Foundations of the Representational Arts”, 1993), les « seeing-with », « seeing-something » (John Searle, 1983) (“seeing-something (p)” is as “seeing-that-p” ; et : “every seeing-something is not necessarily a seeing-something-as-something”), « seeing-what » (Michael Polanyi , 1970), puis le « je-ne-sais-quoi » ou « non so che » jusqu’au « trompe-l’œil » (pour cela, on se référera également à Maurice Merleau-Ponty (“L’Œil et l’Esprit”, 1960) et Jean-Paul Sartre (“L’Imaginaire”, 1940), jusqu’à interroger toute vision synoptique). — (Source1 ; Source2 ; Source3) ‒ <retour>
[12] — Néologisme à consonance zapotèque. Zapotèque : De l’espagnol zapoteca, issu du nahuatl tzapotēcah, pluriel de Tzapotēcatl (« homme de zapote »). Les Zapotèques pensaient que leurs ancêtres étaient issus d’un arbre appelé zapote (ou Sapotillier, du nahuatl tzapotl (« fruit sucré »)). Le nom que se donnent les Zapotèques est Benezaa, Ben-Zoa ou Vinizza (« peuple des nuages »). (Wikipedia) ‒ <retour>
[13] — Une seconde interprétation est que le “zap-zap” fait partie de la Gestalt theorie. En effet la théorie de la Gestalt (de l’allemand « gestalten » mettre en forme, donner une structure signifiante) fût inventée au début du XXe siècle par plusieurs personnes dont Christian von Ehrenfels qui théorisa la forme dans l’article « Über Gestaltqualitäten ». Elle postule que la complexité visuelle de notre environnement oblige le cerveau à l’ordonner et le simplifier afin de lui donner une structure signifiante. D’après la théorie de la Gestalt nous percevons primordialement des formes globales et non des détails. Il s’agit pour notre cerveau de faire une synthèse, un assemblage qui rend l’ensemble compréhensible, rapidement. Pour cela plusieurs mécanismes cognitifs complexes traduisent ce qui est perçu, de façon physique, par l’œil. Prenons le cas des étoiles. Lorsque que nous regardons le ciel étoilé notre cerveau organise notre observation de telle manière à perçevoir des groupes, à les structurer, et donc à pouvoir en dégager des formes. L’étoile, stimulus inital, sera associée à d’autres étoiles pour s’organiser en « forme » : la constellation. Cette démarche permet une appréciation rapide par notre cerveau puis aboutit à une identification. Ainsi nous pouvons trouver et reconnaitre la grande ourse en regroupant mentalement les étoiles de la « grande casserole ». Pour le dire autrement, un ensemble ne peut se réduire à la somme des stimuli perçus. Un visage n’est pas l’addition d’un nez, d’une bouche et de deux yeux tout comme un texte n’est pas la simple addition de mots. Ce n’est pas tant chaque élément qui compte mais leurs relations les uns avec les autres mais également avec le « tout ». Chaque élément tire ses propriétés particulières de sa place et de sa fonction au sein de ce tout. Cette approche, telle que définie par le Gelstat, est systémique. C’est à dire multiple et globale. La systémie en graphisme comme en musique, c’est l’art de composer un ensemble harmonieux, homogène et signifiant. Elle consiste donc en une approche qui élargit, qui s’intéresse à l’ensemble, qui com-prend du latin cum, « avec », et prehendere, « prendre / saisir ». — (Source) ‒ <retour>»»»
[14] — Pline l’Ancien, Histoire Naturelle (Naturalis historia), 74 ap.J.C., œuvre en prose de 37 livres compilant le plus grand nombre possible d’informations et de culture générale indispensables à l’homme romain cultivé. Pline avait conscience que la vie d’un homme était éphémère et pensait que le bonheur n’existait pas. Il considérait que l’homme devait donc utiliser le temps à bon escient afin de ne pas réduire sa capacité d’apprendre. (Source) ‒ <retour>
[15] — On ne confondra pas avec ce site : http://chapologie.blogspot.com/ . ‒ <retour>
.
.
.
.
retour au premier article du ouesterne, épisode étude Kafka Zappa Spinoza
.
.
- open summer
- pébipologie
- éditions
- ouestern
- spinoza
- spinola
- kafka
- charade
- pérec
- spleen
- zappa
- cervantès
- daumal
- paréidolie
- principe associatif
- les buttes
- les avatars
- stratégie du filet
- edith
- virgile
- pline
- la chapologie
- tardis
- canard
- lapin
- gracq
- gestalt
- spleenoza
- white

